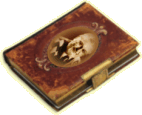Jules Verne
la jangada
Huit cent lieues sur l'Amazone
(Chapitre XVII-XX)
82 dessinsde Leon Benett et deux cartes
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
![]()
La dernière nuit.
![]() a visite de Yaquita, accompagnée de sa fille, avait été ce qu’elle était toujours, pendant ces quelques heures que les deux époux passaient chaque jour l’un près de l’autre. En présence de ces deux êtres si tendrement aimés, le cœur de Joam Dacosta avait peine à ne pas déborder. Mais le mari, le père, se contenait. C’était lui qui relevait ces deux pauvres femmes, qui leur rendait un peu de cet espoir, dont il lui restait cependant si peu. Toutes deux arrivaient avec l’intention de ranimer le moral du prisonnier. Hélas! plus que lui, elles avaient besoin d’être soutenues; mais, en le voyant si ferme, la tête si haute au milieu de tant d’épreuves, elles se reprenaient à espérer.
a visite de Yaquita, accompagnée de sa fille, avait été ce qu’elle était toujours, pendant ces quelques heures que les deux époux passaient chaque jour l’un près de l’autre. En présence de ces deux êtres si tendrement aimés, le cœur de Joam Dacosta avait peine à ne pas déborder. Mais le mari, le père, se contenait. C’était lui qui relevait ces deux pauvres femmes, qui leur rendait un peu de cet espoir, dont il lui restait cependant si peu. Toutes deux arrivaient avec l’intention de ranimer le moral du prisonnier. Hélas! plus que lui, elles avaient besoin d’être soutenues; mais, en le voyant si ferme, la tête si haute au milieu de tant d’épreuves, elles se reprenaient à espérer.
Ce jour-là encore, Joam leur avait fait entendre d’encourageantes paroles. Cette indomptable énergie, il la puisait non seulement dans le sentiment de son innocence, mais aussi dans la foi en ce Dieu qui a mis une part de sa justice au cœur des hommes. Non! Joam Dacosta ne pouvait être frappé pour le crime de Tijuco!
Presque jamais, d’ailleurs, il ne parlait du document. Qu’il fût apocryphe ou non, qu’il fût de la main de Torrès ou écrit par l’auteur réel de l’attentat, qu’il contînt ou ne contînt pas la justification tant cherchée, ce n’était pas sur cette douteuse hypothèse que Joam Dacosta prétendait s’appuyer. Non! il se regardait comme le meilleur argument de sa cause, et c’était à toute sa vie de travail et d’honnêteté qu’il avait voulu donner la tâche de plaider pour lui!
Ce soir-là donc, la mère et la fille, relevées par ces viriles paroles qui les pénétraient jusqu’au plus profond de leur être, s’étaient retirées plus confiantes qu’elles ne l’avaient été depuis l’arrestation. Le prisonnier les avait une dernière fois pressées sur son cœur avec un redoublement de tendresse. Il semblait qu’il eût ce pressentiment que le dénouement de cette affaire, quel qu’il fût, était prochain.
Joam Dacosta, demeuré seul, resta longtemps immobile. Ses bras reposaient sur une petite table et soutenaient sa tête.
Que se passait-il en lui? Était-il arrivé à cette conviction que la justice humaine, après avoir failli une première fois, prononcerait enfin son acquittement?
Oui! il espérait encore! Avec le rapport du juge Jarriquez établissant son identité, il savait que ce mémoire justificatif, qu’il avait écrit avec tant de conviction, devait être à Rio de Janeiro, entre les mains du chef suprême de la justice.
On le sait, ce mémoire, c’était l’histoire de sa vie depuis son entrée dans les bureaux de l’arrayal diamantin jusqu’au moment où la jangada s’était arrêtée aux portes de Manao.
Joam Dacosta repassait alors en son esprit toute son existence. Il revivait dans son passé, depuis l’époque à laquelle, orphelin, il était arrivé à Tijuco. Là, par son zèle, il s’était élevé dans la hiérarchie des bureaux du gouverneur général, où il avait été admis bien jeune encore. L’avenir lui souriait; il devait arriver à quelque haute position!… Puis, tout à coup, cette catastrophe: le pillage du convoi de diamants, le massacre des soldats de l’escorte, les soupçons se portant sur lui, comme sur le seul employé qui eût pu divulguer le secret du départ, son arrestation, sa comparution devant le jury, sa condamnation, malgré tous les efforts de son avocat, les dernières heures écoulées dans la cellule des condamnés à mort de la prison de Villa-Rica, son évasion accomplie dans des conditions qui dénotaient un courage surhumain, sa fuite à travers les provinces du Nord, son arrivée à la frontière péruvienne, puis l’accueil qu’avait fait au fugitif, dénué de ressources et mourant de faim, l’hospitalier fazender Magalhaës!
Le prisonnier revoyait tous ces événements, qui avaient si brutalement brisé sa vie! Et alors, abstrait dans ses pensées, perdu dans ses souvenirs, il n’entendait pas un bruit particulier qui se produisait sur le mur extérieur du vieux couvent, ni les secousses d’une corde accrochée aux barreaux de sa fenêtre, ni le grincement de l’acier mordant le fer, qui eussent attiré l’attention d’un homme moins absorbé.
Non, Joam Dacosta continuait à revivre au milieu des années de sa jeunesse, après son arrivée dans la province péruvienne. Il se revoyait à la fazenda, le commis, puis l’associé du vieux Portugais, travaillant à la prospérité de l’établissement d’Iquitos.
Ah! pourquoi, dès le début, n’avait-il pas tout dit à son bienfaiteur! Celui-là n’aurait pas douté de lui! C’était la seule faute qu’il eût à se reprocher! Pourquoi n’avait-il pas avoué ni d’où il venait, ni qui il était, – surtout au moment où Magalhaës avait mis dans sa main la main de sa fille, qui n’eût jamais voulu voir en lui l’auteur de cet épouvantable crime!
En ce moment, le bruit, à l’extérieur, fut assez fort pour attirer l’attention du prisonnier.
Joam Dacosta releva un instant la tête. Ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre, mais avec ce regard vague qui est comme inconscient, et, un instant après, son front retomba dans ses mains. Sa pensée l’avait encore ramené à Iquitos.
Là, le vieux fazender était mourant. Avant de mourir, il voulait que l’avenir de sa fille fût assuré, que son associé fût l’unique maître de cet établissement, devenu si prospère sous sa direction. Joam Dacosta devait-il parler alors?… Peut-être!… Il ne l’osa pas!… Il revit cet heureux passé près de Yaquita, la naissance de ses enfants, tout le bonheur de cette existence que troublaient seuls les souvenirs de Tijuco et les remords de n’avoir pas avoué son terrible secret!
L’enchaînement de ces faits se reproduisait ainsi dans le cerveau de Joam Dacosta avec une netteté, une vivacité surprenantes.
Il se retrouvait, maintenant, au moment où le mariage de sa fille Minha avec Manoel allait être décidé! Pouvait-il laisser s’accomplir cette union sous un faux nom, sans faire connaître à ce jeune homme les mystères de sa vie? Non!
Aussi s’était-il résolu, sur l’avis du juge Ribeiro, à venir réclamer la révision de son procès, à provoquer la réhabilitation qui lui était due. Il était parti avec tous les siens, et alors venait l’intervention de Torrès, l’odieux marché proposé par ce misérable, le refus indigné du père de livrer sa fille pour sauver son honneur et sa vie, puis la dénonciation, puis l’arrestation!…
En ce moment, la fenêtre, violemment repoussée du dehors, s’ouvrit brusquement.
Joam Dacosta se redressa; les souvenirs de son passé s’évanouirent comme une ombre.
Benito avait sauté dans la chambre, il était devant son père, et, un instant après, Manoel, franchissant la baie qui avait été dégagée de ses barreaux, apparaissait près de lui.
Joam Dacosta allait jeter un cri de surprise; Benito ne lui en laissa pas le temps.
«Mon père, dit-il, voici cette fenêtre dont la grille est brisée!… Une corde pend jusqu’au sol!… Une pirogue attend dans le canal, à cent pas d’ici!… Araujo est là pour la conduire loin de Manao, sur l’autre rive de l’Amazone, où vos traces ne pourront être retrouvées!… Mon père, il faut fuir à l’instant!… Le juge lui-même nous en a donné le conseil!
– Il le faut! ajouta Manoel.
– Fuir! moi!… Fuir une seconde fois!… Fuir encore!…
Et, les bras croisés, la tête haute, Joam Dacosta recula lentement jusqu’au fond de la chambre.
«Jamais!» dit-il d’une voix si ferme que Benito et Manoel restèrent interdits.
Les deux jeunes gens ne s’attendaient pas à cette résistance. Jamais ils n’auraient pu penser que les obstacles à cette évasion viendraient du prisonnier lui-même.
Benito s’avança vers son père, et, le regardant bien en face, il lui prit les deux mains, non pour l’entraîner, mais pour qu’il l’entendît et se laissât convaincre.
«Jamais, avez-vous dit, mon père?
– Jamais.
– Mon père, dit alors Manoel, – moi aussi j’ai le droit de vous donner ce nom –, mon père, écoutez-nous! Si nous vous disons qu’il faut fuir sans perdre un seul instant, c’est que, si vous restiez, vous seriez coupable envers les autres, envers vous-même!
– Rester, reprit Benito, c’est attendre la mort, mon père! L’ordre d’exécution peut arriver d’un moment à l’autre! Si vous croyez que la justice des hommes reviendra sur un jugement inique, si vous pensez qu’elle réhabilitera celui qu’elle a condamné il y a vingt ans, vous vous trompez! Il n’y a plus d’espoir! Il faut fuir!… Fuyez!»
Par un mouvement irrésistible, Benito avait saisi son père, et il l’entraîna vers la fenêtre.
Joam Dacosta se dégagea de l’étreinte de son fils, et recula une seconde fois.
«Fuir! répondit-il, du ton d’un homme dont la résolution est inébranlable, mais c’est me déshonorer et vous déshonorer avec moi! Ce serait comme un aveu de ma culpabilité! Puisque je suis librement venu me remettre à la disposition des juges de mon pays, je dois attendre leur décision, quelle qu’elle soit, et je l’attendrai!
– Mais les présomptions sur lesquelles vous vous appuyez ne peuvent suffire, reprit Manoel, et la preuve matérielle de votre innocence nous manque jusqu’ici! Si nous vous répétons qu’il faut fuir, c’est que le juge Jarriquez lui-même nous l’a dit! Vous n’avez plus maintenant que cette chance d’échapper à la mort!
– Je mourrai donc! répondit Joam Dacosta d’une voix, calme. Je mourrai en protestant contre le jugement qui me condamne! Une première fois, quelques heures avant l’exécution, j’ai fui! Oui! j’étais jeune alors, j’avais toute une vie devant moi pour combattre l’injustice des hommes! Mais me sauver maintenant, recommencer cette misérable existence d’un coupable qui se cache sous un faux nom, dont tous les efforts sont employés à dépister les poursuites de la police; reprendre cette vie d’anxiété que j’ai menée depuis vingt-trois ans, en vous obligeant à la partager avec moi; attendre chaque jour une dénonciation qui arriverait tôt ou tard, et une demande d’extradition qui viendrait m’atteindre jusqu’en pays étranger! est-ce que ce serait vivre! Non! jamais!
– Mon père, reprit Benito, dont la tête menaçait de s’égarer devant cette obstination, vous fuirez! Je le veux!…»
Et il avait saisi Joam Dacosta, et il cherchait, par force, à l’entraîner vers la fenêtre.
«Non!… non!…
– Vous voulez donc me rendre fou!
– Mon fils, s’écria Joam Dacosta, laisse-moi!… Une fois déjà, je me suis échappé de la prison de Villa-Rica, et l’on a dû croire que je fuyais une condamnation justement méritée! Oui! on a dû le croire! Eh bien, pour l’honneur du nom que vous portez, je ne recommencerai pas!»
Benito était tombé aux genoux de son père! Il lui tendait les mains… Il le suppliait…
«Mais cet ordre, mon père, répétait-il, cet ordre peut arriver aujourd’hui… À l’instant… et il contiendra la sentence de mort!
– L’ordre serait arrivé, que ma détermination ne changerait pas! Non, mon fils! Joam Dacosta coupable pourrait fuir! Joam Dacosta innocent ne fuira pas!»
La scène qui suivit ces paroles fut déchirante. Benito luttait contre son père. Manoel, éperdu, se tenait près de la fenêtre, prêt à enlever le prisonnier, lorsque la porte de la cellule s’ouvrit.
Sur le seuil apparut le chef de police, accompagné du gardien-chef de la prison et de quelques soldats.
Le chef de police comprit qu’une tentative d’évasion venait d’être faite, mais il comprit aussi à l’attitude du prisonnier que c’était lui qui n’avait pas voulu fuir! Il ne dit rien. La plus profonde pitié se peignit sur sa figure. Sans doute, lui aussi, comme le juge Jarriquez, il aurait voulu que Joam Dacosta se fût échappé de cette prison?
Il était trop tard!
Le chef de police, qui tenait un papier à la main, s’avança vers le prisonnier.
«Avant tout, lui dit Joam Dacosta, laissez-moi vous affirmer, monsieur, qu’il n’a tenu qu’à moi de fuir, mais que je ne l’ai pas voulu!»
Le chef de police baissa un instant la tête; puis d’une voix qu’il essayait en vain de raffermir:
«Joam Dacosta, dit-il, l’ordre vient d’arriver à l’instant du chef suprême de la justice de Rio de Janeiro.
– Ah! mon père! s’écrièrent Manoel et Benito.
– Cet ordre, demanda Joam Dacosta, qui venait de croiser les bras sur sa poitrine, cet ordre porte l’exécution de la sentence?
– Oui!
– Et ce sera?…
– Pour demain!»
Benito s’était jeté sur son père. Il voulait encore une fois l’entraîner hors de cette cellule… Il fallut que des soldats vinssent arracher le prisonnier à cette dernière étreinte.
Puis, sur un signe du chef de police, Benito et Manoel furent emmenés au-dehors. Il fallait mettre un terme à cette lamentable scène, qui avait déjà trop duré.
«Monsieur, dit alors le condamné, demain matin, avant l’heure de l’exécution, pourrai-je passer quelques instants avec le padre Passanha que je vous prie de faire prévenir?
– Il sera prévenu.
– Me sera-t-il permis de voir ma famille, d’embrasser une dernière fois ma femme et mes enfants?
– Vous les verrez.
– Je vous remercie, monsieur, répondit Joam Dacosta. Et maintenant, faites garder cette fenêtre! Il ne faut pas qu’on m’arrache d’ici malgré moi!»
Cela dit, le chef de police, après s’être incliné, se retira avec le gardien et les soldats.
Le condamné, qui n’avait plus maintenant que quelques heures à vivre, resta seul.
![]()
Fragoso.
![]() insi donc l’ordre était arrivé, et, comme le juge Jarriquez le prévoyait, c’était un ordre qui portait exécution immédiate de la sentence prononcée contre Joam Dacosta. Aucune preuve n’avait pu être produite. La justice devait avoir son cours.
insi donc l’ordre était arrivé, et, comme le juge Jarriquez le prévoyait, c’était un ordre qui portait exécution immédiate de la sentence prononcée contre Joam Dacosta. Aucune preuve n’avait pu être produite. La justice devait avoir son cours.
C’était le lendemain même, 31 août, à neuf heures du matin, que le condamné devait périr par le gibet.
La peine de mort, au Brésil, est le plus généralement commuée, à moins qu’il s’agisse de l’appliquer aux noirs; mais, cette fois, elle allait frapper un blanc.
Telles sont les dispositions pénales en matière de crimes relatifs à l’arrayal diamantin, pour lesquels, dans un intérêt public, la loi n’a voulu admettre aucun recours en grâce.
Rien ne pouvait donc plus sauver Joam Dacosta. C’était non seulement la vie, mais l’honneur qu’il allait perdre.
Or, ce 31 août, dès le matin, un homme accourait vers Manao de toute la vitesse de son cheval, et telle avait été la rapidité de sa course, qu’à un demi-mille de la ville la courageuse bête tombait, incapable de se porter plus avant.
Le cavalier n’essaya même pas de relever sa monture. Évidemment il lui avait demandé et il avait obtenu d’elle plus que le possible, et, malgré l’état d’épuisement où il se trouvait lui-même, il s’élança dans la direction de la ville.
Cet homme venait des provinces de l’est en suivant la rive gauche du fleuve. Toutes ses économies avaient été employées à l’achat de ce cheval, qui, plus rapide que ne l’eût été une pirogue obligée de remonter le courant de l’Amazone, venait de le ramener à Manao.
C’était Fragoso.
Un homme accourait vers Manao.
Le courageux garçon avait-il donc réussi dans cette entreprise dont il n’avait parlé à personne? Avait-il retrouvé la milice à laquelle appartenait Torrès? Avait-il découvert quelque secret qui pouvait encore sauver Joam Dacosta?
Il ne savait pas au juste; mais, en tout cas, il avait une extrême hâte de communiquer au juge Jarriquez ce qu’il venait d’apprendre pendant cette courte excursion.
Voici ce qui s’était passé:
Fragoso ne s’était point trompé, lorsqu’il avait reconnu en Torrès un des capitaines de cette milice qui opérait dans les provinces riveraines de la Madeira.
Il partit donc, et, en arrivant à l’embouchure de cet affluent, il apprit que le chef de ces «capitaës do mato» se trouvait alors aux environs.
Fragoso, sans perdre une heure, se mit à sa recherche, et, non sans peine, il parvint à le rejoindre.
Aux questions que Fragoso lui posa, le chef de la milice n’hésita pas à répondre. À propos de la demande très simple qui lui fut faite, il n’avait, d’ailleurs, aucun intérêt à se taire.
Et, en effet les trois seules questions que lui adressa Fragoso furent celles-ci:
«Le capitaine des bois Torrès n’appartenait-il pas, il y a quelques mois, à votre milice?
– Oui.
– À cette époque, n’avait-il pas pour camarade intime un de vos compagnons qui est mort récemment?
– En effet.
– Et cet homme se nommait?…
– Ortega.»
Voilà tout ce qu’avait appris Fragoso. Ces renseignements étaient-ils de nature à modifier la situation de Joam Dacosta? Ce n’était vraiment pas supposable.
Fragoso, le comprenant bien, insista donc près du chef de la milice pour savoir s’il connaissait cet Ortega, s’il pouvait lui apprendre d’où il venait, et lui donner quelques renseignements sur son passé. Cela ne laissait pas d’avoir une véritable importance, puisque cet Ortega, au dire de Torrès, était le véritable auteur du crime de Tijuco.
Mais, malheureusement, le chef de la milice ne put donner aucun renseignement à cet égard.
Ce qui était certain, c’est que cet Ortega appartenait depuis bien des années à la milice; qu’une étroite camaraderie s’était nouée entre Torrès et lui, qu’on les voyait toujours ensemble, et que Torrès le veillait à son chevet lorsqu’il rendit le dernier soupir.
Voilà tout ce que savait à ce sujet le chef de la milice, et il ne pouvait en dire davantage.
Fragoso dut donc se contenter de ces insignifiants détails, et il repartit aussitôt.
Mais, si le dévoué garçon n’apportait pas la preuve que cet Ortega fût l’auteur du crime de Tijuco, de la démarche qu’il venait de faire il résultait du moins ceci: c’est que Torrès avait dit la vérité, lorsqu’il affirmait qu’un de ses camarades de la milice était mort, et qu’il l’avait assisté à ses derniers moments.
Quant à cette hypothèse qu’Ortega lui eût remis le document en question, elle devenait maintenant très admissible. Rien de plus probable aussi que ce document eût rapport à l’attentat, dont Ortega était réellement l’auteur, et qu’il renfermait l’aveu de sa culpabilité, accompagné de circonstances qui ne permettraient pas de la mettre en doute.
Ainsi donc, si ce document avait pu être lu, si la clef en avait été trouvée, si le chiffre sur lequel reposait son système avait été connu, nul doute que la vérité se fût enfin fait jour!
Mais ce chiffre, Fragoso ne le savait pas! Quelques présomptions de plus, la quasi-certitude que l’aventurier n’avait rien inventé, certaines circonstances tendant à prouver que le secret de cette affaire était renfermé dans le document, voilà tout ce que le brave garçon rapportait de sa visite au chef de cette milice à laquelle avait appartenu Torrès.
Et pourtant, si peu que ce fût, il avait hâte de tout conter au juge Jarriquez. Il savait qu’il n’y avait pas une heure à perdre, et voilà pourquoi, ce matin-là, vers huit heures, il arrivait, brisé de fatigue, à un demi-mille de Manao.
Cette distance qui le séparait encore de la ville, Fragoso la franchit en quelques minutes. Une sorte de pressentiment irrésistible le poussait en avant, et il en était presque arrivé à croire que le salut de Joam Dacosta se trouvait maintenant entre ses mains.
Soudain Fragoso s’arrêta, comme si ses pieds eussent irrésistiblement pris racine dans le sol.
Il se trouvait à l’entrée de la petite place, sur laquelle s’ouvrait une des portes de la ville.
Là, au milieu d’une foule déjà compacte, la dominant d’une vingtaine de pieds, se dressait le poteau du gibet, auquel pendait une corde.
Fragoso sentit ses dernières forces l’abandonner. Il tomba. Ses yeux s’étaient involontairement fermés. Il ne voulait pas voir, et ces mots s’échappèrent de ses lèvres
«Trop tard! trop tard!…»
Mais, par un effort surhumain, il se releva. Non! il n’était pas trop tard! Le corps de Joam Dacosta ne se balançait pas au bout de cette corde!
«Le juge Jarriquez! le juge Jarriquez!» cria Fragoso.
Et, haletant, éperdu, il se jetait vers la porte de la ville, il remontait la principale rue de Manao, et tombait, à demi mort, sur le seuil de la maison du magistrat.
La porte était fermée. Fragoso eut encore la force de frapper à cette porte.
Un des serviteurs du magistrat vint ouvrir. Son maître ne voulait recevoir personne.
Malgré cette défense, Fragoso, repoussa l’homme qui lui défendait l’entrée de la maison, et d’un bond il s’élança jusqu’au cabinet du juge.
«Je reviens de la province où Torrès a fait son métier de capitaine des bois! s’écria-t-il. Monsieur le juge, Torrès a dit vrai!… Suspendez… suspendez l’exécution!
– Vous avez retrouvé cette milice? Oui! Et vous me rapportez le chiffre du document?…»
Fragoso ne répondit pas.
«Alors, laissez-moi! laissez-moi!» s’écria le juge Jarriquez, qui, en proie à un véritable accès de rage, saisit le document pour l’anéantir.
Fragoso lui prit les mains et l’arrêta.
«La vérité est là! dit-il.
– Je le sais, répondit le juge Jarriquez; mais qu’est-ce qu’une vérité qui ne peut se faire jour!
– Elle apparaîtra!… il le faut!… il le faut!
– Encore une fois, avez-vous le chiffre?…
– Non! répondit Fragoso, mais, je vous le répète, Torrès n’a pas menti!… Un de ses compagnons avec lequel il était étroitement lié est mort, il y a quelques mois, et il n’est pas douteux que cet homme lui ait remis le document qu’il venait vendre à Joam Dacosta!
– Non! répondit le juge Jarriquez, non!… cela n’est pas douteux… pour nous, mais cela n’a pas paru certain pour ceux qui disposent de la vie du condamné!… Laissez-moi!»
Fragoso, repoussé, ne voulait pas quitter la place. À son tour, il se traînait aux pieds du magistrat.
«Joam Dacosta est innocent! s’écria-t-il. Vous ne pouvez le laisser mourir! Ce n’est pas lui qui a commis le crime de Tijuco! C’est le compagnon de Torrès, l’auteur du document! C’est Ortega!…»
À ce nom, le juge Jarriquez bondit. Puis, lorsqu’une sorte de calme eut succédé dans son esprit à la tempête qui s’y déchaînait, il retira le document de sa main crispée, il l’étendit sur sa table, il s’assit, et passant la main sur ses yeux:
«Ce nom!… dit-il… Ortega!… Essayons!»
Et le voilà, procédant avec ce nouveau nom, rapporté par Fragoso, comme il avait déjà fait avec les autres noms propres vainement essayés par lui. Après l’avoir disposé au-dessus des six premières lettres du paragraphe, il obtint la formule suivante:
O r t e g a
P h y j s l
«Rien! dit-il, cela ne donne rien!»
Et, en effet, l’h placée sur l’r ne pouvait s’exprimer par un chiffre, puisque dans l’ordre alphabétique, cette lettre occupe un rang antérieur à celui de la lettre r.
Le p, l’y, le j, disposés sous les lettres o, t, e, seuls se chiffraient par 1, 4, 5.
Quant à l’s et à l’l placés à la fin de ce mot, l’intervalle qui les sépare du g et de l’a étant de douze lettres, impossible de les exprimer par un seul chiffre. Donc, ils ne correspondaient ni au g ni à l’a.
En ce moment, des cris terrifiants s’élevèrent dans la rue, des cris de désespoir.
Fragoso se précipita à l’une des fenêtres qu’il ouvrit, avant que le magistrat n’eût pu l’en empêcher.
La foule encombrait la rue. L’heure était venue à laquelle le condamné allait sortir de la prison, et un reflux de cette foule s’opérait dans la direction de la place où se dressait le gibet.
Le juge Jarriquez, effrayant à voir, tant son regard était fixe, dévorait les lignes du document.
«Les dernières lettres! murmura-t-il. Essayons encore les dernières lettres!»
C’était le suprême espoir.
Et alors, d’une main, dont le tremblement l’empêchait presque d’écrire, il disposa le nom d’Ortega au-dessus des six dernières lettres du paragraphe, ainsi qu’il venait de faire pour les six premières.
Un premier cri lui échappa. Il avait vu, tout d’abord, que ces six dernières lettres étaient inférieures dans l’ordre alphabétique à celles qui composaient le nom d’Ortega, et que, par conséquent, elles pourraient toutes se chiffrer et composer un nombre.
Et, en effet, lorsqu’il eut réduit la formule, en remontant de la lettre inférieure du document à la lettre supérieure du mot, il obtint:
O r t e g a
4 3 2 5 1 3
S u v j h d
Le nombre, ainsi composé, était 432513.
Mais ce nombre était-il enfin celui qui avait présidé à la formation du document? Ne serait-il pas aussi faux que ceux qui avaient été précédemment essayés?
En cet instant, les cris redoublèrent, des cris de pitié qui trahissaient la sympathique émotion de toute cette foule. Quelques minutes encore, c’était tout ce qui restait à vivre au condamné!
Fragoso, fou de douleur, s’élança hors de la chambre!… Il voulait revoir une dernière fois son bienfaiteur, qui allait mourir!… Il voulait se jeter au-devant du funèbre cortège, l’arrêter en criant: «Ne tuez pas ce juste! Ne le tuez pas!…»
Mais déjà le juge Jarriquez avait disposé le nombre obtenu au-dessus des premières lettres du paragraphe, en le répétant autant de fois qu’il était nécessaire, comme suit:
432513432513432513432513
Phyjslyddqfdzxgasgzzqqeh
Puis, reconstituant les lettres vraies en remontant dans l’ordre alphabétique, il lut:
Le véritable auteur du vol de…
Un hurlement de joie lui échappa! Ce nombre, 432513, c’était le nombre tant cherché! Le nom d’Ortega lui avait permis de le refaire! Il tenait enfin la clef du document, qui allait incontestablement démontrer l’innocence de Joam Dacosta, et, sans en lire davantage, il se précipita hors de son cabinet, puis dans la rue, criant
«Arrêtez! Arrêtez!»
Fendre la foule qui s’ouvrit devant ses pas, courir à la prison, que le condamné quittait à ce moment, pendant que sa femme, ses enfants, s’attachaient à lui avec la violence du désespoir, ce ne fut que l’affaire d’un instant pour le juge Jarriquez.
Arrivé devant Joam Dacosta, il ne pouvait plus parler, mais sa main agitait le document, et, enfin, ce mot s’échappait de ses lèvres:
«Innocent! innocent!»
![]()
Chapitre XIX
Le crime de Tijuco.
![]() l’arrivée du juge, tout le funèbre cortège s’était arrêté.
l’arrivée du juge, tout le funèbre cortège s’était arrêté.
Un immense écho avait répété après lui et répétait encore ce cri qui s’échappait de toutes les poitrines:
«Innocent! innocent!»
Puis, un silence complet s’établit.
On ne voulait pas perdre une seule des paroles qui allaient être prononcées.
Le juge Jarriquez s’était assis sur un banc de pierre, et là, pendant que Minha, Benito, Manoel, Fragoso l’entouraient, tandis que Joam Dacosta retenait Yaquita sur son cœur, il reconstituait tout d’abord le dernier paragraphe du document au moyen du nombre, et, à mesure que les mots se dégageaient nettement sous le chiffre qui substituait la véritable lettre à la lettre cryptologique, il les séparait, il les ponctuait, il lisait à haute voix.
Et voici ce qu’il lut au milieu de ce profond silence:
|
Le |
véritable |
auteur |
du |
vol |
des |
diamants |
et |
de |
|
43 |
251343251 |
343251 |
34 |
325 |
134 |
32513432 |
51 |
34 |
|
Ph |
yjslyddqf |
dzxgas |
gz |
zqq |
ehx |
gkfndrxu |
ju |
gi |
|
l’assassinat |
des |
soldats |
qui |
escortaient |
le |
convoi, |
|
32513432513 |
432 |
5134325 |
134 |
32513432513 |
43 |
251343 |
|
ocytdxvksbx |
hhu |
ypohdvy |
rym |
huhpuydkjox |
ph |
etozsl |
|
commis |
dans |
la |
nuit |
du |
vingt-deux |
janvier |
mil |
huit |
|
251343 |
2513 |
43 |
2513 |
43 |
251343251 |
3432513 |
432 |
5134 |
|
etnpmv |
ffov |
pd |
pajx |
hy |
ynojyggay |
meqynfu |
qln |
mvly |
|
cent |
vingt-six, |
n’est |
donc |
pas |
Joam |
Dacosta, |
injustement |
|
3251 |
34325134 |
3251 |
3432 |
513 |
4325 |
1343251 |
34325134325 |
|
fgsu |
zmqiztlb |
qgyu |
gsqe |
ubv |
nrcr |
edgruzb |
lrmxyuhqhpz |
|
condamné |
à |
mort; |
c’est |
moi, |
le |
misérable |
employé |
de |
|
13432513 |
4 |
3251 |
3432 |
513 |
43 |
251343251 |
3432513 |
43 |
|
drrgcroh |
e |
pqxu |
fivv |
rpl |
ph |
onthvddqf |
hqsntzh |
hh |
|
l’administration |
du |
district |
diamantin; |
oui, |
moi |
seul, |
|
251343251343251 |
34 |
32513432 |
513432513 |
432 |
513 |
4325 |
|
nfepmqkyuuexto |
gz |
gkyuumfv |
ijdqdpzjq |
syk |
rpl |
xhxq |
|
qui |
signe |
de |
mon |
vrai |
nom, |
Ortega. |
|
134 |
32513 |
43 |
251 |
3432 |
513 |
432513 |
|
rym |
vkloh |
hh |
oto |
zvdk |
spp |
suvjhd. |
Cette lecture n’avait pu être achevée, sans que d’interminables hurrahs se fussent élevés dans l’air.
Quoi de plus concluant, en effet, que ce dernier paragraphe qui résumait le document tout entier, qui proclamait si absolument l’innocence du fazender d’Iquitos, qui arrachait au gibet cette victime d’une effroyable erreur judiciaire!
Joam Dacosta, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses amis, ne pouvait suffire à presser les mains qui se tendaient vers lui. Quelle que fût l’énergie de son caractère, la réaction se faisait, des larmes de joie s’échappaient de ses yeux, et en même temps son cœur reconnaissant s’élevait vers cette Providence qui venait de le sauver si miraculeusement, au moment, où il allait subir la dernière expiation, vers ce Dieu qui n’avait pas voulu laisser s’accomplir ce pire des crimes, la mort d’un juste!
Oui! la justification de Joam Dacosta ne pouvait plus soulever aucun doute! Le véritable auteur de l’attentat de Tijuco avouait lui-même son crime, et il dénonçait toutes les circonstances dans lesquelles il s’était accompli! En effet, le juge Jarriquez, au moyen du nombre, venait de reconstituer toute la notice cryptogrammatique.
Or, voici ce qu’avouait Ortega.
Ce misérable était le collègue de Joam Dacosta, employé comme lui, à Tijuco, dans les bureaux du gouverneur de l’arrayal diamantin. Le jeune commis, désigné pour accompagner le convoi à Rio de Janeiro, ce fut lui. Ne reculant pas à cette horrible idée de s’enrichir par l’assassinat et le vol, il avait indiqué aux contrebandiers le jour exact où le convoi devait quitter Tijuco.
Pendant l’attaque des malfaiteurs qui attendaient le convoi au-delà de Villa-Rica, il feignit de se défendre avec les soldats de l’escorte; puis, s’étant jeté parmi les morts, il fut emporté par ses complices, et c’est ainsi que le soldat, qui survécut seul à ce massacre, put affirmer qu’Ortega avait péri dans la lutte.
Mais le vol ne devait pas profiter au criminel, et, peu de temps après, il était dépouillé à son tour par ceux qui l’avaient aidé à commettre le crime.
Resté sans ressources, ne pouvant plus rentrer à Tijuco, Ortega s’enfuit dans les provinces du nord du Brésil, vers ces districts du Haut-Amazone où se trouvait la milice des «capitaës do mato». Il fallait vivre. Ortega se fit admettre dans cette peu honorable troupe. Là, on ne demandait ni qui on était, ni d’où l’on venait. Ortega se fit donc capitaine des bois, et, pendant de longues années, il exerça ce métier de chasseur d’hommes.
Sur ces entrefaites, Torrès, l’aventurier, dépourvu de tout moyen d’existence, devint son compagnon. Ortega et lui se lièrent intimement. Mais, ainsi que l’avait dit Torrès, le remords vint peu à peu troubler la vie du misérable. Le souvenir de son crime lui fit horreur. Il savait qu’un autre avait été condamné à sa place! Il savait que cet autre, c’était son collègue Joam Dacosta! Il savait enfin que, si cet innocent avait pu échapper au dernier supplice, il ne cessait pas d’être sous le coup d’une condamnation capitale!
Or, le hasard fit que, pendant une expédition de la milice, entreprise, il y avait quelques mois, au-delà de la frontière péruvienne, Ortega arriva aux environs d’Iquitos, et que là, dans Joam Garral, qui ne le reconnut pas, il retrouva Joam Dacosta.
Ce fut alors qu’il résolut de réparer, en la mesure du possible, l’injustice dont son ancien collègue était victime. Il consigna dans un document tous les faits relatifs à l’attentat de Tijuco; mais il le fit sous la forme mystérieuse que l’on sait, son intention étant de le faire parvenir au fazender d’Iquitos avec le chiffre qui permettait de le lire.
La mort n’allait pas le laisser achever cette œuvre de réparation. Blessé grièvement dans une rencontre avec les noirs de la Madeira, Ortega se sentit perdu. Son camarade Torrès était alors près de lui. Il crut pouvoir confier à cet ami le secret qui avait si lourdement pesé sur toute son existence. Il lui remit le document écrit tout entier de sa main, en lui faisant jurer de le faire parvenir à Joam Dacosta, dont il lui donna le nom et l’adresse, et de ses lèvres s’échappa, avec son dernier soupir, ce nombre 432513, sans lequel le document devait rester absolument indéchiffrable.
Ortega mort, on sait comment l’indigne Torrès s’acquitta de sa mission, comment il résolut d’utiliser à son profit le secret dont il était possesseur, comment il tenta d’en faire l’objet d’un odieux chantage.
Torrès devait violemment périr avant d’avoir accompli son œuvre, et emporter son secret avec lui. Mais ce nom d’Ortega, rapporté par Fragoso, et qui était comme la signature du document, ce nom avait enfin permis de le reconstituer, grâce à la sagacité du juge Jarriquez.
Oui! c’était là la preuve matérielle tant cherchée, c’était l’incontestable témoignage de l’innocence de Joam Dacosta, rendu à la vie, rendu à l’honneur!
Les hurrahs redoublèrent lorsque le digne magistrat eut, à haute voix et pour l’édification de tous, tiré du document cette terrible histoire.
Et, dès ce moment, le juge Jarriquez, possesseur de l’indubitable preuve, d’accord avec le chef de la police, ne voulut pas que Joam Dacosta, en attendant les nouvelles instructions qui allaient être demandées à Rio de Janeiro, eût d’autre prison que sa propre demeure.
Cela ne pouvait faire difficulté, et ce fut au milieu du concours de la population de Manao que Joam Dacosta, accompagné de tous les siens, se vit porté plutôt que conduit jusqu’à la maison du magistrat comme un triomphateur.
En ce moment, l’honnête fazender d’Iquitos était bien payé de tout ce qu’il avait souffert pendant de si longues années d’exil, et, s’il en était heureux, pour sa famille plus encore que pour lui, il était non moins fier pour son pays que cette suprême injustice n’eût pas été définitivement consommée!
Et, dans tout cela, que devenait Fragoso?
Eh bien! l’aimable garçon était couvert de caresses! Benito, Manoel, Minha l’en accablaient, et Lina ne les lui épargnait pas! Il ne savait à qui entendre, et il se défendait de son mieux! Il n’en méritait pas tant! Le hasard seul avait tout fait! Lui devait-on même un remerciement, parce qu’il avait reconnu en Torrès un capitaine des bois? Non, assurément. Quant à l’idée qu’il avait eue d’aller rechercher la milice à laquelle Torrès avait appartenu, il ne semblait pas qu’elle pût améliorer la situation, et, quant à ce nom d’Ortega, il n’en connaissait même pas la valeur!
Brave Fragoso! Qu’il le voulût ou non, il n’en avait pas moins sauvé Joam Dacosta!
Mais, en cela, quelle étonnante succession d’événements divers, qui avaient tous tendu au même but: la délivrance de Fragoso, au moment où il allait mourir d’épuisement dans la forêt d’Iquitos, l’accueil hospitalier qu’il avait reçu à la fazenda, la rencontre de Torrès à la frontière brésilienne, son embarquement sur la jangada, et, enfin, cette circonstance que Fragoso l’avait déjà vu quelque part!
«Eh bien, oui! finit par s’écrier Fragoso, mais ce n’est pas à moi qu’il faut rapporter tout ce bonheur, c’est à Lina!
– À moi! répondit la jeune mulâtresse.
– Eh, sans doute! sans la liane, sans l’idée de la liane, est-ce que j’aurais jamais pu faire tant d’heureux!»
Si Fragoso et Lina furent fêtés, choyés par toute cette honnête famille, par les nouveaux amis que tant d’épreuves leur avaient faits à Manao, il est inutile d’y insister.
Mais le juge Jarriquez, n’avait-il pas sa part, lui aussi, dans cette réhabilitation de l’innocent? Si, malgré toute la finesse de ses talents d’analyste, il n’avait pu lire ce document, absolument indéchiffrable pour quiconque n’en possédait pas la clef, n’avait-il pas du moins reconnu sur quel système cryptographique il reposait? Sans lui, qui aurait pu, avec ce nom seul d’Ortega, reconstituer le nombre que l’auteur du crime et Torrès, morts tous les deux, étaient seuls à connaître?
Aussi les remerciements ne lui manquèrent-ils pas!
Il va sans dire que, le jour même, partait pour Rio de Janeiro un rapport détaillé sur toute cette affaire, auquel était joint le document original, avec le chiffre qui permettait de le lire. Il fallait attendre que de nouvelles instructions fussent envoyées du ministère au juge de droit, et nul doute qu’elles n’ordonnassent l’élargissement immédiat du prisonnier.
C’était quelques jours à passer encore à Manao; puis, Joam Dacosta et les siens, libres de toute contrainte, dégagés de toute inquiétude, prendraient congé de leur hôte, se rembarqueraient, et continueraient à descendre l’Amazone jusqu’au Para, où le voyage devait se terminer par la double union de Minha et de Manoel, de Lina et de Fragoso, conformément au programme arrêté avant le départ.
Quatre jours après, le 4 septembre, arrivait l’ordre de mise en liberté. Le document avait été reconnu authentique. L’écriture en était bien celle de cet Ortega, l’ancien employé du district diamantin, et il n’était pas douteux que l’aveu de son crime, avec les plus minutieux détails qu’il en donnait, n’eût été entièrement écrit de sa main.
L’innocence du condamné de Villa-Rica était enfin admise. La réhabilitation de Joam Dacosta était judiciairement reconnue.
Le jour même, le juge Jarriquez dînait avec la famille à bord de la jangada, et, le soir venu, toutes les mains pressaient les siennes. Ce furent de touchants adieux; mais ils comportaient l’engagement de se revoir à Manao, au retour, et, plus tard, à la fazenda d’Iquitos.
Le lendemain matin, 5 septembre, au lever du soleil, le signal du départ fut donné. Joam Dacosta, Yaquita, leur fille, leurs fils, tous étaient sur le pont de l’énorme train. La jangada, démarrée, commença à prendre le fil du courant, et, lorsqu’elle disparut au tournant du rio Negro, les hurrahs de toute la population, pressée sur la rive, retentissaient encore.
![]()
Chapitre XX
Le Bas-Amazone.
![]() ue dire maintenant de cette seconde partie du voyage qui allait s’accomplir sur le cours du grand fleuve? Ce ne fut qu’une suite de jours heureux pour l’honnête famille. Joam Dacosta revivait d’une vie nouvelle, qui rayonnait sur tous les siens.
ue dire maintenant de cette seconde partie du voyage qui allait s’accomplir sur le cours du grand fleuve? Ce ne fut qu’une suite de jours heureux pour l’honnête famille. Joam Dacosta revivait d’une vie nouvelle, qui rayonnait sur tous les siens.
La jangada dériva plus rapidement alors sur ces eaux encore gonflées par la crue. Elle laissa sur la gauche le petit village de Don Jose de Maturi, et, sur la droite, l’embouchure de cette Madeira, qui doit son nom à la flottille d’épaves végétales, à ces trains de troncs dénudés ou verdoyants qu’elle apporte du fond de la Bolivie. Elle passa au milieu de l’archipel Caniny, dont les îlots sont de véritables caisses à palmiers, devant le hameau de Serpa, qui, successivement transporté d’une rive à l’autre, a définitivement assis sur la gauche du fleuve ses maisonnettes, dont le seuil repose sur le tapis jaune de la grève. Le village de Silves, bâti sur la gauche de l’Amazone, la bourgade de Villa-Bella, qui est le grand marché de guarana de toute la province, restèrent bientôt en arrière du long train de bois. Ainsi fut-il du village de Faro et de sa célèbre rivière de Nhamundas, sur laquelle, en 1539, Orellana prétendit avoir été attaqué par des femmes guerrières qu’on n’a jamais revues depuis cette époque, légende qui a suffi pour justifier le nom immortel du fleuve des Amazones.
Là finit la vaste province du Rio Negro. Là commence la juridiction du Para, et, ce jour même, 22 septembre, la famille, émerveillée des magnificences d’une vallée sans égale, entrait dans cette portion de l’empire brésilien, qui n’a d’autre borne à l’est que l’Atlantique.
«Que cela est magnifique! disait sans cesse la jeune fille.
– Que c’est long! murmurait Manoel.
– Que c’est beau! répétait Lina.
– Quand serons-nous donc arrivés!» murmurait Fragoso.
Le moyen de s’entendre, s’il vous plaît, en un tel désaccord de points de vue! Mais, enfin, le temps s’écoulait gaiement, et Benito, ni patient, ni impatient, lui, avait recouvré toute sa bonne humeur d’autrefois.
Bientôt la jangada se glissa entre d’interminables plantations de cacaotiers d’un vert sombre, sur lequel tranchait le jaune des chaumes ou le rouge des tuiles, qui coiffaient les buttes des exploitants des deux rives, depuis Obidos jusqu’à la bourgade de Monte-Alegre.
Puis s’ouvrit l’embouchure du rio Trombetas, baignant de ses eaux noires les maisons d’Obidos, une vraie petite ville et même une «citade», avec de larges rues bordées de jolies habitations, important entrepôt du produit des cacaotiers, qui ne se trouve plus qu’à cent quatre-vingts grands milles de Bélem.
On vit alors le confluent de Tapajoz, aux eaux d’un Vert gris, descendues du sud-ouest; puis Santarem, riche bourgade, où l’on ne compte pas moins de cinq mille habitants, Indiens pour la plupart, et dont les premières maisons reposaient sur de vastes grèves de sable blanc.
Depuis son départ de Manao, la jangada ne s’arrêtait plus en descendant le cours moins encombré de l’Amazone. Elle dérivait jour et nuit sous l’œil vigilant de son adroit pilote. Plus de haltes, ni pour l’agrément des passagers, ni pour les besoins du commerce. On allait toujours, et le but approchait rapidement.
À partir d’Alemquer, située sur la rive gauche, un nouvel horizon se dessina aux regards. Au lieu des rideaux de forêts qui l’avaient fermé jusqu’alors, ce furent, au premier plan, des collines, dont l’œil pouvait suivre les molles ondulations, et, en arrière, la cime indécise de véritables montagnes, se dentelant sur le fond lointain du ciel.
Ni Yaquita, ni sa fille, ni Lina, ni la vieille Cybèle n’avaient encore rien vu de pareil.
Mais, dans cette juridiction du Para, Manoel était chez lui. Il pouvait donner un nom à cette double chaîne, qui rétrécissait peu à peu la vallée du grand fleuve.
«À droite, dit-il, c’est la sierra de Paruacarta, qui s’arrondit en demi-cercle vers le sud! À gauche, c’est la sierra de Curuva, dont nous aurons bientôt dépassé les derniers contreforts!
– Alors on approche? répétait Fragoso.
– On approche!» répondait Manoel.
Et les deux fiancés se comprenaient sans doute, car un même petit hochement de tête, on ne peut plus significatif, accompagnait la demande et la réponse.
Enfin, malgré les marées qui, depuis Obidos, commençaient à se faire sentir et retardaient quelque peu la dérive de la jangada, la bourgade de Monte-Alegre fut dépassée, puis celle de Praynha de Onteiro, puis l’embouchure du Xingu, fréquentée par ces Indiens Yurumas, dont la principale industrie consiste à préparer les têtes de leurs ennemis pour les cabinets d’histoire naturelle.
Sur quelle largeur superbe se développait alors l’Amazone, et comme on pressentait déjà que ce roi des fleuves allait bientôt s’évaser comme une mer! Des herbes, hautes de huit à dix pieds, hérissaient ses plages, en les bordant d’une forêt de roseaux. Porto de Mos, Boa-Vista, Gurupa dont la prospérité est en décroissance, ne furent bientôt plus que des points laissés en arrière.
Là, le fleuve se divisait en deux bras importants qu’il tendait vers l’Atlantique: l’un courait au nord-est, l’autre s’enfonçait vers l’est, et, entre eux, se développait la grande île de Marajo. C’est toute une province que cette île. Elle ne mesure pas moins de cent quatre-vingts lieues de tour. Diversement coupée de marais et de rios, toute en savanes à l’est, toute en forêts à l’ouest, elle offre de véritables avantages pour l’élevage des bestiaux qu’elle compte par milliers.
Cet immense barrage de Marajo est l’obstacle naturel qui a forcé l’Amazone à se dédoubler avant d’aller précipiter ses torrents d’eaux à la mer. À suivre le bras supérieur, la jangada, après avoir dépassé les îles Caviana et Mexiana, aurait trouvé une embouchure large de cinquante lieues; mais elle eût aussi rencontré la barre de «prororoca», ce terrible mascaret, qui, pendant les trois jours précédant la nouvelle ou la pleine lune, n’emploie que deux minutes, au lieu de six heures, à faire marner le fleuve de douze à quinze pieds au-dessus de son étiage.
C’est donc là un véritable raz de marée, redoutable entre tous. Très heureusement, le bras inférieur, connu sous le nom de canal des Brèves, qui est le bras naturel du Para, n’est pas soumis aux éventualités de ce terrible phénomène, mais bien à des marées d’une marche plus régulière. Le pilote Araujo le connaissait parfaitement. Il s’y engagea donc, au milieu de forêts magnifiques, longeant çà et là quelques îles couvertes de gros palmiers muritis, et le temps était si beau qu’on n’avait même pas à redouter ces coups de tempête qui balayent parfois tout ce canal des Brèves.
La jangada passa, quelques jours après, devant le village de ce nom, qui bien que bâti sur des terrains inondés pendant plusieurs mois de l’année, est devenu, depuis 1845, une importante ville de cent maisons. Au milieu de cette contrée fréquentée par les Tapuyas, ces Indiens du Bas-Amazone se confondent de plus en plus avec les populations blanches, et leur race finira par s’y absorber.
Cependant la jangada descendait toujours. Ici, elle rasait, au risque de s’y accrocher, ces griffes de mangliers, dont les racines s’étendaient sur les eaux comme les pattes de gigantesques crustacés; là, le tronc lisse des palétuviers au feuillage vert pale, servait de point d’appui aux longues gaffes de l’équipe, qui la renvoyaient au fil du courant.
Puis ce fut l’embouchure du Tocantins, dont les eaux, dues aux divers rios de la province de Goyaz, se mêlent à celles de l’Amazone par une large embouchure; puis le Moju, puis la bourgade de Santa-Ana.
Tout ce panorama des deux rives se déplaçait majestueusement, sans aucun temps d’arrêt, comme si quelque ingénieux mécanisme l’eût obligé à se dérouler d’aval en amont.
Déjà de nombreuses embarcations qui descendaient le fleuve, ubas, égaritéas, vigilindas, pirogues de toutes formes, petits et moyens caboteurs des parages inférieurs de l’Amazone et du littoral de l’Atlantique, faisaient cortège à la jangada, semblables aux chaloupes de quelque monstrueux vaisseau de guerre.
Enfin apparut sur la gauche Santa-Maria de Bélem do Para, la «ville», comme on dit dans le pays, avec les pittoresques rangées de ses maisons blanches à plusieurs étages, ses convents enfouis sous les palmiers, les clochers de sa cathédrale et de Nostra-Señora de Merced, la flottille de ses goélettes, bricks et trois-mâts, qui la relient commercialement avec l’ancien monde.
Le cœur des passagers de la jangada leur battait fort. Ils touchaient enfin au terme de ce voyage qu’ils avaient cru ne pouvoir plus atteindre. Lorsque l’arrestation de Joam Dacosta les retenait encore à Manao, c’est-à-dire à mi-chemin de leur itinéraire, pouvaient-ils espérer de jamais voir la capitale de cette province du Para?
Ce fut dans cette journée du 15 octobre, – quatre mois et demi après avoir quitté la fazenda d’Iquitos –, que Bélem leur apparut à un brusque tournant du fleuve.
L’arrivée de la jangada était signalée depuis plusieurs jours. Toute la ville connaissait l’histoire de Joam Dacosta. On l’attendait, cet honnête homme! On réservait le plus sympathique accueil aux siens et à lui!
Aussi des centaines d’embarcations vinrent-elles au-devant du fazender, et bientôt la jangada fut envahie par tous ceux qui voulaient fêter le retour de leur compatriote, après un si long exil. Des milliers de curieux, – il serait plus juste de dire des milliers d’amis –, se pressaient sur le village flottant, bien avant qu’il eût atteint son poste d’amarrage; mais il était assez vaste et assez solide pour porter toute une population.
Et parmi ceux qui s’empressaient ainsi, une des premières pirogues avait amené Mme Valdez. La mère de Manoel pouvait enfin presser dans ses bras la nouvelle fille que son fils lui avait choisie. Si la bonne dame n’avait pu se rendre à Iquitos, n’était-ce pas comme un morceau de la fazenda que l’Amazone lui apportait avec sa nouvelle famille?
Avant le soir, le pilote Araujo avait solidement amarré la jangada au fond d’une anse, derrière la pointe de l’arsenal. Là devait être son dernier lieu de mouillage, sa dernière halte, après huit cents lieues de dérive sur la grande artère brésilienne. Là, les carbets des Indiens, les cases des noirs, les magasins qui renfermaient une cargaison précieuse, seraient peu à peu démolis; puis, l’habitation principale, enfouie sous sa verdoyante tapisserie de feuillage et de fleurs, disparaîtrait à son tour; puis, enfin, la petite chapelle, dont la modeste cloche répondait alors aux éclatantes sonneries des églises de Bélem.
Mais, auparavant, une cérémonie allait s’accomplir sur la jangada même: le mariage de Manoel et de Minha, le mariage de Lina et de Fragoso. Au padre Passanha appartenait de célébrer cette double union, qui promettait d’être si heureuse. Ce serait dans la petite chapelle que les époux recevraient de ses mains la bénédiction nuptiale. Si, trop étroite, elle ne pouvait contenir que les seuls membres de la famille Dacosta, l’immense jangada n’était-elle pas là pour recevoir tous ceux qui voulaient assister à cette cérémonie, et si elle-même ne suffisait pas encore, tant l’affluence devait être grande, le fleuve n’offrait-il pas les gradins de son immense berge à cette foule sympathique, désireuse de fêter celui qu’une éclatante réparation venait de faire le héros du jour?
Ce fut le lendemain, 16 octobre, que les deux mariages furent célébrés en grande pompe.
Dès les dix heures du matin, par une journée magnifique, la jangada recevait la foule des assistants. Sur la rive, on pouvait voir presque toute la population de Bélem qui se pressait dans ses habits de fête. À la surface du fleuve, les embarcations, chargées de visiteurs, se tenaient en abord de l’énorme train de bois, et les eaux de l’Amazone disparaissaient littéralement sous cette flottille jusqu’à la rive gauche du fleuve.
Lorsque la cloche de la chapelle tinta son premier coup, ce fut comme un signal de joie pour les oreilles et pour les yeux. En un instant, les églises de Bélem répondirent au clocher de la jangada. Les bâtiments du port se pavoisèrent jusqu’en tête des mâts, et les couleurs brésiliennes furent saluées par les pavillons nationaux des autres pays. Les décharges de mousqueterie éclatèrent de toutes parts, et ce n’était pas sans peine que ces joyeuses détonations pouvaient rivaliser avec les violents hurrahs qui s’échappaient par milliers dans les airs!
La famille Dacosta sortit alors de l’habitation, et se dirigea à travers la foule vers la petite chapelle.
Joam Dacosta fut accueilli par des applaudissements frénétiques. Il donnait le bras à Mme Valdez. Yaquita était conduite par le gouverneur de Bélem, qui, accompagné des camarades du jeune médecin militaire, avait voulu honorer de sa présence la cérémonie du mariage. Lui, Manoel, marchait près de Minha, charmante dans sa fraîche toilette de mariée; puis venait Fragoso, tenant par la main Lina toute rayonnante; suivaient enfin Benito, la vieille Cybèle, les serviteurs de l’honnête famille, entre la double rangée du personnel de la jangada.
Le padre Passanha attendait les deux couples à l’entrée de la chapelle. La cérémonie s’accomplit simplement, et les mêmes mains qui avaient autrefois béni Joam et Yaquita, se tendirent, cette fois encore, pour donner la bénédiction nuptiale à leurs enfants.
Tant de bonheur ne devait pas être altéré par le chagrin des longues séparations.
En effet, Manoel Valdez n’allait pas tarder à donner sa démission pour rejoindre toute la famille à Iquitos, où il trouverait à exercer utilement sa profession comme médecin civil.
Naturellement, le couple Fragoso ne pouvait hésiter a suivre ceux qui étaient pour lui plutôt des amis que des maîtres.
Mme Valdez n’avait pas voulu séparer tout cet honnête petit monde; mais elle y avait mis une condition: c’était qu’on vînt souvent la voir à Bélem.
Rien ne serait plus facile. Le grand fleuve n’était-il pas là comme un lien de communication qui ne devait plus se rompre entre Iquitos et Bélem? En effet, dans quelques jours, le premier paquebot allait commencer son service régulier et rapide, et il ne mettrait qu’une semaine à remonter cette Amazone que la jangada avait mis tant de mois à descendre.
L’importante opération commerciale, bien menée par Benito, s’acheva dans les meilleures conditions, et bientôt de ce qu’avait été cette jangada, – c’est-à-dire un train de bois formé de toute une forêt d’Iquitos –, il ne resta plus rien.
Puis, un mois après, le fazender, sa femme, son fils, Manoel et Minha Valdez, Lina et Fragoso, repartirent par l’un des paquebots de l’Amazone pour revenir au vaste établissement d’Iquitos, dont Benito allait prendre la direction.
Joam Dacosta y rentra la tête haute, cette fois, et ce fut toute une famille d’heureux qu’il ramena au-delà de la frontière brésilienne!
Quant à Fragoso, vingt fois par jour on l’entendait répéter:
«Hein! sans la liane!»
Et il finit même par donner ce joli nom à la jeune mulâtresse, qui le justifiait bien par sa tendresse pour ce brave garçon.
«À une lettre près, disait-il! Lina, Liane, n’est-ce pas la même chose?»
FIN