
Jules Verne
Martin Paz 1
nouvelle historique
L'Amérique du Sud. Mœurs péruviennes
Illustrations: Jules-Descartes Férat
© Andrzej
Zydorczak
![]()
![]() e soleil
venait de disparaître au delà des pics neigeux des Cordillères; mais sous
ce beau ciel péruvien, à travers le voile transparent des nuits,
l’atmosphère s’imprégnait d’une lumineuse fraîcheur. C’était l’heure à
laquelle on pouvait vivre de la vie européenne et chercher en
dehors des verandahs quelque souffle
bienfaisant.
e soleil
venait de disparaître au delà des pics neigeux des Cordillères; mais sous
ce beau ciel péruvien, à travers le voile transparent des nuits,
l’atmosphère s’imprégnait d’une lumineuse fraîcheur. C’était l’heure à
laquelle on pouvait vivre de la vie européenne et chercher en
dehors des verandahs quelque souffle
bienfaisant.
Tandis que les premières étoiles se levaient à l’horizon, de nombreux promeneurs allaient par les rues de Lima, enveloppés de leur manteau léger et causant gravement des affaires les plus futiles. Il y avait un grand mouvement de population sur la Plaza-Mayor, ce forum de l’ancienne Cité des rois. Les artisans profitaient de la fraîcheur pour vaquer à leurs travaux journaliers, et ils circulaient activement au milieu de la foule, criant à grand bruit l’excellence de leur marchandise. Les femmes, soigneusement encapuchonnées dans la mante qui leur masquait le visage, ondoyaient à travers les groupes de fumeurs. Quelques señoras, en toilette de bal, coiffées seulement de leur abondante chevelure relevée de fleurs naturelles, se prélassaient dans de larges calèches. Les Indiens passaient sans lever les yeux, se sachant trop bas pour être aperçus, ne trahissant ni par un geste ni par un mot la sourde envie qui les dévorait, et ils contrastaient ainsi avec ces métis rebutés comme eux, mais dont lesprotestations étaient plus bruyantes.
Quant aux Espagnols, ces fiers descendants de Pizarre, ils marchaient tête haute, comme au temps où leurs ancêtres fondaient la Cité des rois. Leur mépris traditionnel enveloppait tout à la fois et les Indiens qu’ils avaient vaincus, et les métis, nés de leurs relations avec tes indigènes du Nouveau-Monde. Les Indiens, eux, comme toutes les classes réduites à la servitude, ne songeant qu’à briser leurs fers, confondaient dans une même aversion les vainqueurs de l’ancien empire des Incas, et les métis, sorte de bourgeoisie, pleine d’une morgue insolente.
Mais ces métis, Espagnols par le mépris dont ils accablaient les Indiens, Indiens par la haine qu’ils avaient vouée aux Espagnols, se consumaient entre ces deux sentiments également vivaces.
C’était le groupe de ces jeunes gens qui s’agitait près de la jolie fontaine qui s’élève au milieu de la Plaza-Mayor. Drapés dans leur puncho, pièce de coton taillée en carré long et percée d’une ouverture qui donne passage à la tète, vêtus de larges pantalons rayés de mille couleurs, coiffés de chapeaux à vastes bords en paille de Guayaquil, ils parlaient, criaient et gesticulaient.
«Tu as raison, André,» disait. un petit homme fort obséquieux, que l’on nommait Millaflores.
Ce Millaflores était le parasite d’André Certa, jeune métis, fils d’un riche marchand qui avait été tué dans une des dernières émeutes du conspirateur Lafuente. André Certa avait hérité d’une grande fortune, et il la faisait habilement valoir au profit de ses amis, auxquels il ne demandait que d’humbles condescendances en échange de ses poignées d’or.
«A quoi bon ces changements de pouvoir, ces pronunciamentos éternels qui bouleversent le Pérou? reprit André à haute voix. Que ce soit Gambarra ou Santa-Cruz qui gouverne, il n’importe, si l’égalité ne règne pas ici!
– Bien parlé, bien parlé! s’écria le petit Millaflores, qui, même sous un gouvernement égalitaire, n’eut jamais pu être l’égal d’un homme d’esprit.
– Comment! reprit André Certa, moi, fils d’un négociant, je ne puis me faire traîner que dans une calèche attelée de mules? Est-ce que mes navires n’ont pas amené la richesse et la prospérité dans ce pays? Est-ce que l’utile aristocratie des piastres ne vaut pas tous les vains titres de l’Espagne?
– C’est une honte! répondit un jeune métis. Et tenez! Voilà don Fernand, qui passe dans sa voiture à deux chevaux! Don Fernand d’Aguillo! C’est à peine s’il a de quoi nourrir son cocher, et il vient se pavaner fièrement sur la place! Bon! En voilà un autre! le marquis don Végal!»
Un magnifique carrosse débouchait, en ce moment, sur la Plaza-Mayor. C’était celui du marquis don Végal, chevalier d’Alcantara, de Malte et de Charles III. Mais ce grand seigneur ne venait là que par ennui, et non par ostentation. De tristes pensées se concentraient sous son front péniblement courbé, et il n’entendit même pas les envieuses réflexions des métis, quand ses quatre chevaux se frayèrent un passage à travers la foule.
«Je hais cet homme! dit André Certa.
– Tu ne le haïras pas longtemps! lui répondit un des jeunes cavaliers.
– Non, car tous ces nobles étalent les dernières splendeurs de leur luxe, et je puis dire où vont leur argenterie et leurs bijoux de famille!
– Oui! Tu en sais quelque chose, toi qui fréquentes la maison du juif Samuel!
– Et là, sur les livres de compte du vieux juif s’inscrivent les créances aristocratiques, et dans son coffre-fort s’entassent les débris de ces grandes fortunes! Et le jour où tous ces Espagnols seront gueux comme leur César de Bazan, nous aurons beau jeu!
– Toi surtout, André, lorsque tu seras monté sur tes millions, répondit Millaflores! Et tu vas encore doubler ta fortune!… Ah çà! Quand épouses-tu cette belle jeune fille du vieux Samuel, qui est Liménienne jusque dans le bout des ongles et qui n’a évidemment de juif que son nom de Sarah?
– Dans un mois, répondit André Certa, et dans un mois il n’y aura pas de fortune au Pérou qui puisse lutter avec la mienne!
– Mais pourquoi, demanda un des jeunes métis, ne pas avoir épousé une Espagnole de haut parage?
– Je méprise ces sortes de gens autant que jeles hais!»
André Certa ne voulait pas avouer qu’il avait été pitoyablement éconduit de plusieurs nobles familles dans lesquelles il avait tenté de s’introduire.
En ce moment, André Certa fut vivement coudoyé par un homme de haute taille, aux cheveux grisonnants, mais dont les membres trapus attestaient la force musculaire.
Cet homme, un Indien des montagnes, était vêtu d’une veste brune qui laissait passer une chemise de grosse toile à large col et s’ouvrait sur sa poitrine velue; sa culotte courte, rayée de bandes vertes, se rattachait par des jarretières rouges à des bas d’une couleur terreuse; il avait aux pieds des sandales faites de cuir de bœuf, et sous son chapeau pointu brillaient de larges boucles d’oreilles.
Après avoir heurté André Certa, il le regarda fixement.
«Misérable Indien!» s’écria le métis en levant la main.
Ses compagnons leretinrent, et Millaflores s’écria:
«André! André! prends garde!
– Un vil esclave, oser me coudoyer!
– C’est un fou! c’est le Sambo!»
Le Sambo continua de fixer des yeux le métis qu’il avait heurté avec intention. Celui-ci, dont la colère débordait, saisit un poignard passé à sa ceinture, et il allait se précipiter sur son agresseur, quand un cri guttural, semblable à celui du linot du Pérou, retentit au milieu du tumulte des promeneurs. Le Sambo disparut.
«Brutal et lâche! s’écria André Certa.
– Contiens-toi, fit doucement Millaflores, et quittons la Plaza-Mayor. Les Liméniennes sont trop hautaines ici!»
Le groupe des jeunes gens se dirigea alors vers le fond de la place. La nuit était venue, et les Liméniennes méritaient bien leur nom de «tapadas»,2 car on ne distinguait plus leur figure sous la mante qui les couvrait étroitement.
La Plaza-Mayor était encore en pleine animation. Les cris et le tumulte redoublaient. Les gardes à cheval, postés devant le portique central du palais du vice-roi, situé au nord de la place, avaient peine à demeurer immobiles au milieu de cette foule remuante. Les industries les plus variées semblaient s’être donné rendez-vous sur cette place, qui n’était plus qu’un immense étalage d’objets de toutes sortes. Le rez-de-chaussée du palais du vice-roi et le soubassement de la cathédrale, occupés par des boutiques, faisaient de cet ensemble un véritable bazar ouvert à toutes les productions tropicales.
Cette place était donc bruyante; mais quand l’Angelus vint à sonner au clocher de la cathédrale, tout ce bruit s’apaisa soudain. Aux grandes clameurs succéda le chuchotement de la prière. Les femmes s’arrêtèrent dans leur promenade et portèrent la main à leur rosaire.
Tandis que tous s’arrêtaient et se courbaient, une vieille duègne qui accompagnait une jeune fille cherchait à se frayer passage au milieu de la foule. De là, des qualifications malsonnantes à l’adresse de ces deux femmes qui troublaient la prière. La jeune fille voulut s’arrêter, mais la duègne l’entraîna plus vivement.
«Voyez-vous cette fille de Satan, dit-on près d’elle.
– Qu’est-ce que cette danseuse damnée?
– C’est encore une de ces femmes de «Carcaman!»3
La jeune fille s’arrêta enfin, toute confuse.
Soudain, un muletier la prit par l’épaule et voulut la forcer de s’agenouiller; mais il avait à peine porté la main sur elle, qu’un bras vigoureux le terrassait. Cette scène, rapide comme l’éclair, fut suivie d’un moment de confusion.
«Fuyez, mademoiselle!» dit une voix douce et respectueuse à l’oreille de la jeune fille.
Celle-ci se retourna, pâle de frayeur, et vit un jeune Indien de haute taille, qui, les bras croisés, attendait son adversaire de pied ferme.
«Sur mon âme, nous sommes perdues!» s’écria la duègne.
Et elle entraîna la jeune fille.
Le muletier s’était redressé, tout meurtri de sa chute; mais, jugeant prudent de ne pas demander sa revanche à un adversaire aussi résolûment campé que le jeune Indien, il rejoignit ses mules et s’en alla en grommelant d’inutiles menaces.
![]()
II
![]() a ville de Lima est blottie dans la vallée de la Rimac, à
neuf lieues
de son embouchure. Au nord et à
l’est commencent les premières ondulations de terrain qui font partie de
la grande chaîne des Andes. La vallée de Lurigancho, formée par les
montagnes de San-Cristoval et des Amancaës, qui s’élèvent derrière Lima,
vient se terminer à ses faubourgs. La ville s’étale sur une seule rive du
fleuve. L’autre est occupée par le faubourg de San-Lazaro et se relie par
un pont à cinq arches, dont les piles en amont opposent au courant leur
arête triangulaire. Celles d’aval offrent aux promeneurs des bancs sur
lesquels les élégants viennent s’étendre pendant les soirs d’été, et d’où ils peuvent contempler une jolie
cascade.
a ville de Lima est blottie dans la vallée de la Rimac, à
neuf lieues
de son embouchure. Au nord et à
l’est commencent les premières ondulations de terrain qui font partie de
la grande chaîne des Andes. La vallée de Lurigancho, formée par les
montagnes de San-Cristoval et des Amancaës, qui s’élèvent derrière Lima,
vient se terminer à ses faubourgs. La ville s’étale sur une seule rive du
fleuve. L’autre est occupée par le faubourg de San-Lazaro et se relie par
un pont à cinq arches, dont les piles en amont opposent au courant leur
arête triangulaire. Celles d’aval offrent aux promeneurs des bancs sur
lesquels les élégants viennent s’étendre pendant les soirs d’été, et d’où ils peuvent contempler une jolie
cascade.
La ville a deux milles de long de l’est à l’ouest, et seulement un mille un quart de large du pont jusqu’aux murs. Ceux-ci, hauts de douze pieds, épais de dix a leur base, construits en «adobes», sortes de briques séchées au soleil et faites d’une terre glaise mêlée à une grande quantité de paille hachée, sont propres, dès lors, à résister aux tremblements de terre. L’enceinte, percée de sept portes et de trois poternes, se termine, à son extrémité sud-est, par la petite citadelle de Sainte-Catherine.
Telle est l’ancienne Cité des rois, fondée en 1534, par Pizarre, le jour de l’Epiphanie. Elle a été et est encore le théâtre de révolutions toujours renaissantes. Lima était jadis le principal entrepôt de l’Amérique sur l’océan Pacifique, grâce à son port du Callao, qui fut construit en 1779, d’une singulière façon. On fit échouer sur le rivage un vieux vaisseau de premier rang, rempli de pierres, de sable, de débris de toute espèce, et des pilotis de mangliers, envoyés de Guayaquil, et inaltérables à l’eau, furent enfoncés autour de cette carcasse, qui devint l’inébranlable base sur laquelle s’éleva le môle du Callao.
Le climat, plus tempéré, plus doux que celui de Carthagène ou Bahia, situées sur le côté opposé de l’Amérique, fait de Lima l’une des plus agréables villes du Nouveau-Monde. Le vent a deux directions qui ne varient pas: ou il souffle du sud-ouest et se rafraîchit en traversant l’océan Pacifique, ou il vient du sud-est, tout imprégné de la fraîcheur qu’il a puisée sur le sommet glacé des Cordillères.
Les nuits sont belles et pures sous les latitudes des tropiques; elles distillent cette bienfaisante rosée qui féconde un sol exposé aux rayons d’un ciel sans nuages. Aussi, le soir venu, les habitants de Lima prolongent-ils leurs réceptions nocturnes dans les maisons rafraîchies par l’ombre; bientôt les rues sont désertes, et c’est à peine si quelque hôtellerie est encore hantée par les buveurs d’eau-de-vie ou de bière.
Ce soir-là, la jeune fille, suivie de la duègne, arriva sans rencontre fâcheuse au pont de la Rimac, prêtant l’oreille au moindre bruit, que son émotion dénaturait, et n’entendantque les clochettes d’un attelage de mules, ou le sifflement d’un Indien.
Cette jeune fille, nommée Sarah, rentrait chez le juif Samuel, son père. Elle était vêtue d’une jupe de couleur foncée, plissée de plis à demi élastiques, et fort étroite du bas, ce qui l’obligeait à faire de petits pas et lui donnait cette grâce délicate, particulière aux Liméniennes; cette jupe, garnie de dentelles et de fleurs, était en partie recouverte par une mante de soie, qui se relevait par-dessus la tête et la recouvrait d’un capuchon; des bas d’une grande finesse et de petits souliers de satin apparaissaient sous le gracieux vêtement; des bracelets d’un grand prix s’enroulaient aux bras de la jeune fille, dont toute la personne était imprégnée de ce charme qu’exprime si bien le «donayre» en Espagnol.
Millaflores avait bien dit. La fiancée d’André Certa ne devait avoir de juif que le nom, car elle était le type le plus fidèle de ces admirables señoras dont la beauté est au-dessus de toute louange.
La duègne, vieille juive, sur le visage de laquelle se montraient l’avarice et la cupidité, était une dévouée servante de Samuel, qui la payait à sa valeur.
Au moment où les deux femmes entraient dans le faubourg de San-Lazaro, un home, vêtu d’une robe de moine, la tête recouverte de sa cagoule, passa près d’elles en les regardant avec attention. Cet homme, de grosse taille, avait une de ces excellentes figures qui respirent le calme et la bonté. C’était le père Joachim de Camarones, et, en passant, il jeta un sourire d’intelligence à Sarah, qui regarda aussitôt sa suivante, après avoir fait au moine un gracieux signe de la main.
«Eh bien, señora? dit aigrement la vieille. Ce n’est pas assez d’avoir été insultée par ces fils du Christ! il faut encore que vous saluiez un prêtre? Est-ce que nous vous verrons un jour, le rosaire à la main, suivre les cérémonies d’église?»
Les cérémonies d’église sont la grande affaire des Liméniennes.
«Vous faites d’étranges suppositions, répliqua la jeune fille en rougissant.
– Étranges comme votre conduite! Que dirait mon maître Samuel, s’il apprenait ce qui s’est passé ce soir?
– Est-ce parce qu’un muletier brutal m’a insultée que je suis coupable?
– Je m’entends, señora, fit la vieille en branlant la tête, et ne veux point parler du muletier.
– Alors ce jeune homme a mal agi en me défendant contre les injures de la populace?
– Est-ce la première fois que cet Indien se trouve sur votre passage?» demanda la duègne.
Le visage de la jeune fille était heureusement abrité par sa mante, car l’obscurité n’aurait pas suffi à dérober son trouble au regard inquisiteur de la vieillesuivante.
«Mais laissons l’Indien où il est, reprit celle-ci. C’est mon affaire de veiller sur lui. Ce dont je me plains, c’est que, pour ne point déranger ces chrétiens, vous ayez voulu demeurer à leur oraison. N’avez-vous pas eu quelque envie de vous agenouiller comme eux? Ah! señora, votre père me chasserait à l’instant, s’il apprenait que j’eusse souffert une pareille apostasie!»
Mais la jeune fille ne l’écoutait plus. La remarque de la vieille au sujet du jeune Indien l’avait ramenée à des pensées plus douces. Il lui semblait que l’intervention du jeune homme avait été providentielle, et plusieurs fois elle se retourna pour voir s’il ne la suivait pas dans l’ombre. Sarah avait dans le cœur une certaine hardiesse qui lui seyait à merveille. Superbe comme une Espagnole, si elle avait fixé ses regards sur cet homme, c’est que cet homme était fier et n’avait pas mendié un coup d’œil pour prix de sa protection.
En s’imaginant que l’Indien ne l’avait pas quittée des yeux, Sarah ne se trompait guère. Martin Paz, après avoir secouru la jeune fille, voulut assurer sa retraite. Aussi, lorsque les promeneurs se furent dispersés, il se mit à la suivre, sans être aperçu d’elle.
C’était un beau jeune homme, ce Martin Paz, et qui portait avec noblesse le costume national de l‘Indien des montagnes; de son chapeau de paille à larges bords s’échappait une belle chevelure noire, dont les boucles s’harmoniaient avec le ton cuivré de sa figure. Ses yeux brillaient avec une douceur infinie, et son nez surmontait une jolie bouche, ce qui est rare chez les hommes de sa race. C’était un de ces courageux descendants de Manco-Capac, et ses veines devaient être remplies de ce sang plein d’ardeur qui pousse à l’accomplissement des grandes choses.
Martin Paz était fièrement drapé dans son puncho aux couleurs éclatantes; à sa ceinture était passé un de ces poignards malais, terribles dans une main exercée, car ils semblent rivés au bras qui les manie. Dans le nord de l’Amérique, sur les bords du lac Ontario, cet Indien eût été chef de ces tribus errantes, qui livrèrent aux Anglais tant de combats héroïques.
Martin Paz savait que Sarah était fille du riche Samuel et fiancée à l’opulent métis André Certa; il savait que par sa naissance, sa position et sa richesse, elle ne pouvait lui appartenir, mais il oubliait toutes ces impossibilités pour ne sentir que son propre entraînement.
Plongé dans ses réflexions, Martin Paz hâtait samarche, quand il fut rejoint par deux Indiens qui l’arrêtèrent.
«Martin Paz, lui dit l’un d’eux, tu doisce soir même revoir nos frères dans les montagnes?
– Je les reverrai, répondit froidement l’Indien.
– La goëlette l’Annonciacion s’est montrée à la hauteur du Callao, a louvoyé quelques instants, puis, protégée par la pointe, a bientôt disparu. Sans doute, elle se sera approchée de terre vers l’embouchure de la Rimac, et il sera bon que nos canots d’écorce aillent l’alléger de ses marchandises. Il faudra que tu sois là!
– Martin Paz sait ce qu’il doit faire, et il le fera.
– C’est au nom du Sambo quenous te parlons ici.
– Et moi, c’est en mon nom que je vous parle!
– Ne crains-tu pas qu’il trouve inexplicable ta présence à cette heure dans le faubourg de San-Lazaro?
– Je suis là où il me plaît d’être.
– Devant la maison du juif?
– Ceux de mes frères qui letrouveront mauvais me rencontreront cette nuit dans la montagne.»
Les yeux de ces trois hommes étincelèrent, et ce fut tout. Les Indiens regagnèrent la berge de la Rimac, et le bruit de leurs pas se perdit dans l’obscurité.
Martin Paz s’était vivement l’approché de la maison du juif. Cette maison, comme toutes celles de Lima, n’avait que deux étages; le rez-de-chaussée, construit en briques, était surmonté de murs formés de cannes liées ensemble et recouvertes de plâtre. Toute cette partie du bâtiment, propre à résister aux tremblements de terre, imitait, par une habile peinture, les briques des premières assises; le toit, carré, était couvert de fleurs et formait une terrasse pleine de parfums.
Une vaste porte cochère, placée entre deux pavillons, donnait accès dans une cour; mais, suivant la coutume, ces pavillons n’avaient aucune fenêtre percée sur la rue.
Onze heures sonnaient à l’église paroissiale, quand Martin Paz s’arrêta devant la demeure de Sarah. Un profond silence régnait aux alentours.
Pourquoi l’Indien demeurait-il immobile devant ces murs? C’est qu’une ombre blanche avait apparu sur la terrasse au milieu de ces fleurs auxquelles la nuit ne laissait plus qu’une forme vague, sans leur rien enlever de leurs parfums.
Martin Paz leva ses deux mains involontairement et les joignit avec adoration.
Soudain l’ombre blanche s’affaissa, comme effrayée…
Martin Paz se retourna et se trouva face à face avec André Certa.
«Depuis quand les Indiens passent-ils ainsi la nuit en contemplation? demanda André Certa avec colère.
– Depuis que les Indiens foulent aux pieds le propre sol de leurs ancêtres,» répondit Martin Paz.
André Certa fit un pas vers son rival, immobile.
«Misérable! me laisseras-tu la place libre?
– Non,» dit Martin Paz, et deux poignards brillèrent au bras droit des deux adversaires. Ils étaient d’égale taille, et ils semblaient d’égale force.
André Certa leva rapidement son bras, qu’il laissa retomber plus rapidement encore. Son poignard avait rencontré le poignard malais de l’Indien, et il roula aussitôt à terre, frappé à l’épaule.
«A l’aide! à moi!» cria-t-il.
La porte de la maison du juif s’ouvrit. Des métis accoururent d’une maison voisine. Les uns poursuivirent l’Indien, qui prit rapidement le large; les autres relevèrent le blessé.
«Quel est cet homme? dit l’und’eux. Si c’est un marin, à l’hôpital du Saint-Esprit. Si c’est un Indien, à l’hôpital de Sainte-Anne.»
Un vieillard s’approcha du blessé, et à peine l’eut-il vu, qu’il s’écria:
«Que l’on transporte ce jeune homme chez moi. Voilà un étrange malheur!»
Ce vieillard était le juif Samuel, et il venait de reconnaître dans le blessé le fiancé de sa fille.
Cependant, Martin Paz, grâce à l’obscurité et à la rapidité de sa course, espérait échapper à ceux qui le poursuivaient. Il y allait de sa vie. S’il avait pu gagner la campagne, il eut été en sûreté; mais les portes de la ville, fermées à onze heures du soir, ne se rouvraient que vers les quatre heures du matin.
Il arriva sur le pont de pierre qu’il avait déjà traversé. En ce moment, les Indiens et quelques soldats, qui s’étaient joints à eux, le pressaient de près. Par malheur, une patrouille débouchait à l’extrémité opposée. Martin Paz, ne pouvant ni avancer, ni revenir sur ses pas, franchit le parapet et s’élança dans le courant rapide qui se brisait sur un lit de pierres.
Les deux troupes coururent vers les berges inférieures du pont, pour saisir le fugitif au moment où il prendrait terre.
Mais ce fut en vain. Martin Paz ne reparut pas.
![]()
III
![]() ndré
Certa, une fois introduit dans la maison de Samuel et couché dans un lit
préparé en toute hâte, reprit ses sens et serra la main du vieux juif. Le
médecin, averti par un des domestiques, était promptement accouru. La
blessure lui parut être sans gravité; l’épaule du métis se trouvait
traversée de telle façon que l’acier avait seulement glissé entre les
chairs. Dans quelques jours, André Certa devait se trouver sur
pied.
ndré
Certa, une fois introduit dans la maison de Samuel et couché dans un lit
préparé en toute hâte, reprit ses sens et serra la main du vieux juif. Le
médecin, averti par un des domestiques, était promptement accouru. La
blessure lui parut être sans gravité; l’épaule du métis se trouvait
traversée de telle façon que l’acier avait seulement glissé entre les
chairs. Dans quelques jours, André Certa devait se trouver sur
pied.
Lorsque Samuel et André Certa furent seuls, ce dernier lui dit:
«Vous voudrez bien faire murer la porte qui conduit à votre terrasse, maître Samuel.
– Que craignez-vous donc? demanda le juif.
– Je crains que Sarah ne retourne s’y offrir aux contemplations des Indiens! Ce n’est point un voleur qui m’a attaqué, c’est un rival, auquel je n’ai échappé que par miracle!
– Ah! par les saintes Tables, s’écria le juif, vous vous trompez! Sarah sera une épouse accomplie, et je n’oublie rien pour qu’elle vous fasse honneur.»
André Certa se leva à demi sur son coude.
«Maître Samuel, une chose dont vous ne vous souvenez pas assez, c’est que je vous paye la main de Sarah cent mille piastres.
– André Certa, répondit le juif avec un ricanement cupide, je m’en souviens tellement que je suis prêt à échanger ce reçu contre des espèces sonnantes.»
Et ce disant, Samuel tira de son portefeuille un papier qu’André Certa repoussa de la main.
«Le marché n’existe pas entre nous, tant que Sarah ne sera pas ma femme, et elle ne le sera jamais, s’il me faut la disputer à un pareil rival! Vous savez, maître Samuel, quel est mon but. En épousant Sarah, je veux devenir l’égal de toute cette noblesse qui n’a pour moi que des regards de mépris!
– Et vous le pourrez, André Certa, car, une fois marié, vous verrez nos plus fiers Espagnols se presser dans vos salons!
– Où Sarah a-t-elle été ce soir?
– Au temple israélite, avec la vieille Ammon.
– A quoi bon faire suivre à Sarah vos rites religieux?
– Je suis juif, répliqua Samuel, et Sarah serait-elle ma fille, si elle n’accomplissait pas les devoirs de ma religion?»
C’était un homme vil que le juif Samuel. Trafiquant de tout et partout, il descendait en droite ligne de ce Judas qui livra son maître pour trente deniers. Son installation à Lima datait de dix ans. Par goût et par calcul, il avait choisi sa demeure à l’extrémité du faubourg de San-Lazaro, et il se mit dès lors à l’affût de véreuses spéculations. Puis, peu à peu, il afficha un grand luxe; sa maison fut somptueusement entretenue, et ses nombreux domestiques, ses brillants équipages lui firent attribuer des revenus immenses.
Lorsque Samuel vint se fixer à Lima, Sarah avait huit ans. Déjà gracieuse et charmante, elle plaisait à tous et semblait l’idole du juif. Quelques années plus tard, sa beauté attirait tous les regards, et l’on comprend que le métis André Certa devint épris de la jeune juive. Ce qui eût paru inexplicable, c’était les cent mille piastres, prix de la main de Sarah; mais ce marché était secret. D’ailleurs, ii fallait bien que ce Samuel trafiquât des sentiments comme des produits indigènes. Banquier, prêteur, marchand, armateur, il avait le talent de faire affaire avec tout le monde. La goëlette l’Annonciacion, qui cherchait à atterrir cette nuit-là vers l’embouchure de la Rimac, appartenait au juif Samuel.
Au milieu de ce mouvement d’affaires, par un entêtement traditionnel, cet homme accomplissait les rites de sa religion avec une superstition minutieuse, et sa fille avait été soigneusement instruite des pratiques israélites.
Aussi, lorsque, dans cette conversation, le métis lui eut laissé voir son déplaisir à ce sujet, le vieillard demeura-t-il muet et pensif. Ce fut André Certa qui rompit le silence, en lui disant:
«Oubliez-vous donc que le motif pour lequel j’épouse Sarah l’obligera à se convertir au catholicisme?
– Vous avez raison, répondit tristement Samuel; mais, de par la Bible, Sarah sera juive tant qu’elle sera ma fille!»
En ce moment, la porte de la chambre s’ouvrit, et le majordome entra.
«Le meurtrier est-il arrêté? demanda Samuel.
– Tout nous porte à croire qu’il est mort! répondit le majordome.
– Mort! fit André Certa avec un mouvement de joie.
– Pris entre nous et une troupe de soldats, il s’est vu forcé de franchir le parapet du pont et de se précipiter dans la Rimac.
– Mais qui vous prouve qu’il n’a pu gagner l’une des rives? demanda Samuel.
– La fonte des neiges a rendu le courant torrentiel en cet endroit, répondit le majordome. D’ailleurs, nous nous sommes postés des deux côtés du fleuve, et le fugitif n’a pas reparu. J’ai laissé des sentinelles qui passeront la nuit à surveiller les rives de la Rimac.
– Bien, dit le vieillard, il s’est fait justice lui-même! L’avez-vous reconnu, dans sa fuite?
– Parfaitement. C’était Martin Paz, l’Indien des montagnes.
– Est-ce que cet homme épiait Sarah depuis quelque temps? demanda le juif.
– Je ne sais, répondit le majordome.
– Faites venir la vieille Ammon.»
Le majordome se retira.
«Ces Indiens, fit le vieillard, ont entre eux des affiliations secrètes. Il faut savoir si les poursuites de cet homme remontent à une époque éloignée.»
La duègne entra et demeura debout devant son maître.
«Ma fille, demanda Samuel, ne sait rien de ce qui s’est passé ce soir?
– Je l’ignore, répondit la duègne, mais quand les cris de vos serviteurs m’ont réveillée, j’ai couru à la chambre de la señora, et je l’ai trouvée presque sans mouvement.
– Continue, dit Samuel.
– A mes demandes pressantes sur la cause de son agitation, la señora n’a rien voulu répondre; elle s’est mise au lit sans accepter mes services, et j’ai dû me retirer.
– Est-ce que cet Indien se trouvait souvent sur sa route?
– Je ne sais trop, maître! Cependant, je l’ai rencontré souvent dans les rues de San-Lazaro, et, ce soir, il a secouru la señora sur la Plaza-Mayor.
– Secourue! et comment?»
La vieille raconta la scène qui s’était passée.
«Ah! ma fille voulait s’agenouiller parmi ces chrétiens! s’écria le juif avec colère, et je ne sais rien de tout cela! Tu veux donc que je te chasse?
– Maître, pardonnez-moi!
– Va-t’en!» répondit durement le vieillard.
La vieille sortit toute confuse.
«Vous voyez qu’il faut nous marier promptement! dit alors André Certa. Mais j’ai besoin de repos, maintenant, et je vous prierai de me laisser seul.»
Sur ces paroles, le vieillard se retira lentement. Toutefois, avant de regagner son lit, il voulut s’assurer de l’état de sa fille, et il entra doucement dans sa chambre. Sarah dormait d’un sommeil agité, au milieu des riches soieries drapées autour d’elle. Une veilleuse d’albâtre, suspendue aux arabesques du plafond, versait sa douce lumière, et la fenêtre entr’ouverte laissait passer, au travers des stores abaissés, la fraîcheur du ciel, tout imprégnée du parfum pénétrant des aloès et des magnolias. Le luxe créole éclatait dans les mille objets d’art que le bon goût avait dispersés sur les étagères précieusement sculptées de la chambre, et, sous les vagues lueurs de la nuit, on eût dit que l’âme de la jeune fille se jouait parmi ces merveilles.
Le vieillard s’approcha du lit de Sarah et se pencha sur elle pour épier son sommeil. La jeune juive semblait tourmentée par une pensée douloureuse, et, une fois, le nom de Martin Paz s’échappa de ses lèvres.
Samuel regagna sa chambre.
Aux premiers rayons du soleil, Sarah se leva en toute hâte. Liberta, Indien noir attaché à son service, accourut près d’elle, et, suivant ses ordres, il sella une mule pour sa maîtresse, un cheval pour lui.
Sarah avait coutume de faire de matinales promenades, suivie de ce serviteur, qui lui était tout dévoué.
Elle revêtit une jupe de couleur brune et une mante de cachemire à gros glands; elle s’abrita sous les larges bords d’un chapeau de paille, laissant flotter sur son dos ses longues tresses noires, et, pour mieux dissimuler ses préoccupations, elle roula entre ses lèvres une cigarette de tabac parfume.
Une fois en selle, Sarah sortit de la ville et se mit à courir par la campagne en se dirigeant vers le Callao. Le port était en grande animation; les gardes-côtes avaient eu à batailler pendant la nuit avec la goëlette Annonciacion, dont les manœuvres indécises trahissaient quelque intention frauduleuse. L’Annonciacion avait semblé attendre quelques embarcations suspectes vers l’embouchure de la Rimac; mais avant que celles-ci l’eussent accostée, elle avait pu fuir et échapper aux chaloupes du port.
Divers bruits circulaient sur la destination de cette goëlette. Selon les uns, chargée de troupes colombiennes, elle cherchait à s’emparer des principaux bâtiments du Callao et à venger l’affront fait aux soldats de Bolivar, qui avaient été honteusement chassés du Pérou.
Selon d’autres, la goëlette se livrait simplement à la contrebande des lainages d’Europe.
Sans se préoccuper de ces nouvelles plus ou moins vraies, Sarah, dont la promenade au port n’avait été qu’un prétexte, revint vers Lima, qu’elle atteignit près des bords de la Rimac.
Elle remonta le fleuve jusqu’au pont. Là, des rassemblements de soldats et de métis se tenaient sur divers points de la rive.
Liberta avait appris à la jeune fille les événements de la nuit. Suivant son ordre, il interrogea quelques soldats penchés sur le parapet, et il apprit que, non-seulement Martin Paz s’était noyé, mais qu’on n’avait pas même retrouvé son corps.
Il fallut à Sarah, prête à défaillir, toute sa force d’âme pour ne pas s’abandonner à sa douleur.
Parmi les gens qui erraient sur les rives, elle remarqua un Indien aux traits farouches: c’était le Sambo, qui semblait en proie au désespoir.
Sarah, en passant près du vieux montagnard, entendit ces mots:
«Malheur! malheur! Ils ont tué le fils du Sambo! Ils ont tué mon fils!»
La jeune fille se redressa, fit signe à Liberta de la suivre. Cette fois, sans s’inquiéter d’être aperçue, elle se rendit à l’église de Sainte-Anne, laissa sa monture à l’Indien, entra dans le temple catholique, fit demander le père Joachim, et, s’agenouillant sur les dalles de pierre, elle pria pour l’âme de Martin Paz.
![]()
IV
![]() out autre
que Martin Paz eût péri dans les eaux de la Rimac. Pour échapper à la
mort, il lui avait fallu sa force surprenante, son insurmontable volonté,
et surtout ce sang-froid qui est un des privilèges des libres Indiens du
Nouveau-Monde.
out autre
que Martin Paz eût péri dans les eaux de la Rimac. Pour échapper à la
mort, il lui avait fallu sa force surprenante, son insurmontable volonté,
et surtout ce sang-froid qui est un des privilèges des libres Indiens du
Nouveau-Monde.
Martin Paz savait que les soldats concentreraient leurs efforts pour le saisir au-dessous du pont, où le courant semblait impossible à vaincre; mais, par les élans d’une coupe vigoureuse, il parvint à le refouler. Trouvant alors moins de résistance dans les couches d’eau inférieures, il put gagner la rive et se blottir derrière une touffe de mangliers.
Mais que devenir? Les soldats pouvaient se raviser et remonter le cours du fleuve. Martin Paz serait infailliblement capturé. Sa décision fut rapidement prise: il résolut de rentrer dans la ville et de s’y cacher.
Pour éviter quelques indigènes attardés, Martin Paz dut suivre une des plus larges rues. Mais il lui sembla qu’il était épié. Il n’y avait pas à hésiter. Une maison, encore brillamment éclairée, s’offrit à ses yeux; la porte cochère était ouverte pour donner passage aux équipages qui sortaient de la cour et ramenaient à leurs demeures les sommités de l’aristocratie espagnole.
Martin Paz, sans être vu, se glissa dans cette habitation, et les portes furent presque aussitôt fermées sur lui. Il franchit alors prestement un riche escalier en bois de cèdre, orné de tentures de prix; les salons étaient encore éclairés, mais absolument vides; il les traversa avec la vitesse de l’éclair et se cacha enfin dans une sombre chambre.
Bientôt les derniers lustres furent éteints, et la maison redevint silencieuse.
Martin Paz s’occupa alors de reconnaître la place. Les fenêtres de cette chambre donnaient sur un jardin intérieur; il lui sembla donc que la fuite était praticable, et il allait s’élancer, quand il entendit ces paroles:
«Señor, vous avez oublié de voler les diamants que j’avais laissés sur cette table!»
Martin Paz se retourna. Un homme de physionomie fière lui montrait un écrin du doigt.
Martin Paz, ainsi insulté, se rapprocha de l’Espagnol, dont le sang-froid semblait être inaltérable, et, tirant un poignard qu’il tourna contre lui-même:
«Señor, dit-il d’une voix sourde, si vous répétez de semblables paroles, je me tue à vos pieds!»
L’Espagnol, étonné, considéra plus attentivement l’Indien, et il sentit une sorte de sympathie lui monter au cœur. Il alla vers la fenêtre, la ferma doucement, et, revenant vers l’Indien, dont le poignard était tombe à terre:
«Qui êtes-vous? lui demanda-t-il.
– L’Indien Martin Paz… Je suis poursuivi par les soldats, pour m’être défendu contre un métis qui m’attaquait et l’avoir jeté à terre d’un coup de poignard! Ce métis est le fiancé d’une jeune fille que j’aime! Maintenant, señor, vous pouvez me livrer à mes ennemis, si vous le jugez convenable!
– Monsieur, répondit simplement l’Espagnol, je pars demain pour les bains de Chorillos. S’il vous plaît de m’y accompagner, vous serez momentanément à l’abri de toutes poursuites, et vous n’aurez jamais à vous plaindre de l’hospitalité du marquis don Végal!»
Martin Paz s’inclina froidement.
«Vous pouvez jusqu’à demain vous jeter sur ce lit de repos, reprit don Végal. Il n’est personne au monde qui puisse soupçonner votre retraite.»
L’Espagnol sortit de la chambre et laissa l’Indien ému d’une si généreuse confiance; puis, Martin Paz, s’abandonnant à la protection du marquis, s’endormit paisiblement.
Le lendemain, au lever du soleil, le marquis donna les derniers ordres pour son départ et fit prier le juif Samuel de venir chez lui; mais, auparavant, il se rendit à la première messe du matin.
C’était une pratique généralement observée par toute l’aristocratie péruvienne. Dès sa fondation, Lima avait été essentiellement catholique; outre ses nombreuses églises, elle comptait encore vingt-deux couvents, dix-sept monastères et quatre maisons de retraite pour les femmes qui ne prononçaient pas de vœux. Chacun de ces établissements possédait une chapelle particulière, si bien qu’il existait à Lima plus de cent maisons affectées au culte, où huit cents prêtres séculiers ou réguliers, trois cents religieuses, frères lais et sœurs, accomplissaient les cérémonies de la religion.
Don Végal, en entrant à Sainte-Anne, remarqua d’abord une jeune fille agenouillée, tout en prières et en pleurs. Elle paraissait éprouver une douleur telle que le marquis ne put la considérer sans émotion, et il se disposait à lui adresser quelques bienveillantes paroles, lorsque le père Joachim arriva et lui dit à voix basse:
«Don Végal, par grâce! n’approchez pas!»
Puis le prêtre fit un signe à Sarah, qui le suivit dans une chapelle sombre et déserte.
Don Végal se dirigea vers l’autel et entendit la messe; puis, en revenant, il songea involontairement à cette jeune fille, dont l’image restait profondément gravée dans son esprit.
Don Végal trouva au salon le juif Samuel, qui s’était rendu à ses ordres. Samuel semblait avoir oublié les événements de la nuit. L’espoir du gain animait son visage.
«Que veut Votre Seigneurie? demanda-t-il à l’Espagnol.
– Il me faut trente mille piastres avant une heure.
– Trente mille piastres!… Et qui les possède?… Par le saint roi David, señor, je suis plus empêché de les trouver que Votre Grâce ne se l’imagine!
– Voici quelques écrins d’une grande valeur, reprit don Végal, sans s’arrêter aux paroles du juif. En outre, je puis vous vendre à bas prix une terre considérable auprès de Cusco…
– Ah! señor, s’écria Samuel, les terres nous ruinent! Nous n’avons plus assez de bras pour les cultiver. Les Indiens se retirent dans les montagnes, et les récoltes ne payent même plus ce qu’elles coûtent!
– Combien estimez-vous ces diamants?» demanda le marquis.
Samuel tira de sa poche une petite balance de précision et se mit à peser les pierres avec une minutieuse attention. Tout en agissant ainsi, il parlait, et, selon son habitude, dépréciait le gage qui lui était offert.
«Les diamants!… mauvais placement!… Que rapportent-ils?… Autant vaut enterrer son argent!… Vous remarquerez, señor, que l’eau de celui-ci n’est pas d’une limpidité parfaite… Savez-vous que je ne trouve point à revendre aisément ces coûteuses parures? Il me faut expédier ces marchandises-là jusqu’aux provinces de l’Union!… Les Américains me les achètent, sans doute, mais pour les céder à ces fils d’Albion. Ils veulent, dès lors, et c’est fort juste, gagner une commission honnête, si bien que cela retombe sur mon dos… Je pense que dix mille piastres contenteront Votre Seigneurie!… C’est peu, sans doute, mais…
– Ai-je dit, reprit l’Espagnol avec un profond air de mépris, ai-je dit que dix mille piastres ne me suffisaient pas?
– Señor, je ne pourrais mettre un demi-réal de plus!
– Emportez ces écrins et faites-moi tenir la somme à l’instant même. Pour me compléter les trente mille piastres dont j’ai besoin, vous prendrez une hypothèque suffisante sur cette maison… Vous semble-t-elle solide?
– Eh! señor, dans cette ville sujette aux tremblements de terre, on ne sait ni qui vit ni qui meurt, ni qui se tient debout ni qui tombe!»
Et, ce disant, Samuel se laissait aller plusieurs fois sur les talons pour éprouver la solidité des parquets.
«Enfin, pour obliger Votre Seigneurie, dit-il, j’en passerai par où elle voudra, bien que, dans ce moment, je tienne à ne pas me dégarnir d’espèces sonnantes, car je marie ma fille au cavalier André Certa… Vous le connaissez, señor?
– Je ne le connais pas, et je vous prie de m’envoyer à l’instant la somme dont nous sommes convenus. Emportez ces écrins!
– En voulez-vous un reçu?» demanda le juif.
Don Végal ne lui répondit pas et passa dans la chambre voisine.
«Orgueilleux Espagnol! marmotta Samuel entre ses dents, je veux écraser ton insolence comme je dissiperai ta richesse! De par Salomon! je suis un habile homme, puisque mes intérêts vont de pair avec mes sentiments!»
Don Végal, en quittant le juif, avait trouvé Martin Paz dans un accablement profond.
«Qu’avez-vous? lui demanda-t-il avec affection.
– Señor, c’est la fille de ce juif que j’aime!
– Une juive!» fit don Végal avec un sentiment répulsif qu’il ne put maîtriser.
Mais, voyant la tristesse de l’Indien, il ajouta:
«Partons, ami, nous reparlerons de toutes ces choses!»
Une heure plus tard, Martin Paz, revêtu d’habits étrangers, sortait de la ville, accompagnant don Végal, qui n’emmenait aucun de ses gens avec lui.
Les bains de mer de Chorillos sont situés à deux lieues de Lima. Cette paroisse indienne possède une jolie église. Pendant les saisons chaudes, elle est le rendez-vous de l’élégante société liménienne. Les jeux publics, interdits à Lima, sont ouverts à Chorillos pendant tout l’été. Les señoras y déploient une ardeur inimaginable, et, en pariant contre ces jolies partners, plus d’un riche cavalier a vu sa fortune se dissiper en quelques nuits.
Chorillos était encore peu fréquenté. Aussi don Végal et Martin Paz, retirés dans un cottage bâti sur le bord de la mer, purent-ils vivre en paix en contemplant les vastes plaines du Pacifique.
Le marquis don Végal, qui appartenait à l’une des plus anciennes familles espagnoles du Pérou, voyait finir en lui la superbe lignée dont il s’enorgueillissait à bon droit. Aussi son visage laissait-il apercevoir les traces d’une profonde tristesse. Après s’être mêlé pendant quelque temps aux affaires politiques, il avait ressenti un inexprimable dégoût pour ces révolutions incessantes, faites au profit d’ambitions personnelles, et il s’était retiré dans une sorte de solitude, que seuls les devoirs d’une stricte politesse interrompaient à de rares intervalles.
Son immense fortune s’en allait de jour en jour. L’abandon auquel ses domaines étaient livrés par le manque de bras l’obligeait à des emprunts onéreux; mais la perspective d’une ruine prochaine ne l’effrayait pas. L’insouciance naturelle à la race espagnole, jointe à l’ennui d’une existence inutile, l’avait rendu fort insensible aux menaces de l’avenir. Époux autrefois d’une femme adorée, père d’une charmante petite fille, il s’était vu ravir, par une catastrophe horrible, ces deux objets de son amour!… Depuis lors, aucun lien d’affection ne l’attachait plus au monde, et il laissait sa vie aller au gré des événements.
Don Végal croyait donc son cœur bien mort, lorsqu’il le sentit palpiter de nouveau au contact de Martin Paz. Cette nature ardente réveilla le feu sous la cendre; la fière prestance de l’Indien allait à l’hidalgo chevaleresque; puis, lassé des nobles Espagnols, dans lesquels il n’avait plus confiance, dégoûté des métis égoïstes qui voulaient se grandir à sa taille, le marquis eut plaisir à se rattacher à cette race primitive, qui disputa si vaillamment le sol américain aux soldats de Pizarre.
L’Indien passait pour mort à Lima, suivant les nouvelles que le marquis avait reçues; mais don Végal, regardant l’attachement de Martin Paz pour une juive comme pire que la mort même, résolut de le sauver doublement, en laissant marier la fille de Samuel à André Certa.
Aussi, tandis que Martin Paz sentait une tristesse infinie lui envahir le cœur, le marquis évitait toute allusion au passé et entretenait le jeune Indien de sujets indifférents.
Un jour, cependant, don Végal, attristé de ses préoccupations, lui dit:
«Pourquoi, mon ami, renier par un sentiment vulgaire la noblesse de votre nature? N’avez-vous pas pour ancêtre ce hardi Manco-Capac, que son patriotisme a placé au rang des héros? Quel beau rôle aurait à jouer un homme qui ne se laisserait pas abattre par une passion indigne! N’avez-vous donc pas à cœur de reconquérir un jour votre indépendance?
«Nous y travaillons, señor, dit l’Indien, et le jour où mes frères se lèveront en masse n’est peut-être pas éloigné.
– Je vous entends! Vous parlez de cette guerre sourde que vos frères préparent dans leurs montagnes! A un signal, ils descendront sur la ville, les armes a la main…, et ils seront vaincus, comme ils l’ont toujours été! Voyez donc enfin combien vos intérêts disparaissent au milieu de ces révolutions perpétuelles dont le Pérou est le théâtre, révolutions qui perdront Indiens et Espagnols au profit des métis!
– Nous sauverons notre pays! s’écria Martin Paz.
– Oui, vous le sauverez, si vous comprenez votre rôle! répondit don Végal. Écoutez-moi, vous que j’aime comme un fils! Je le dis avec douleur, mais, nous autres Espagnols, fils dégénérés d’une puissante race, nous n’avons plus l’énergie nécessaire pour relever un État. C’est donc à vous de triompher de ce malheureux américanisme, qui tend à rejeter au dehors tout colon étranger! Oui, sachez-le! Il n’y a qu’une immigration européenne qui puisse sauver le vieil empire péruvien. Au lieu de cette guerre intestine que vous préparez et qui tend à exclure toutes les castes, à l’exception d’une seule, tendez donc franchement la main aux populations travailleuses de l’ancien Monde!
– Les Indiens, señor, verront toujours un ennemi dans les étrangers, quels qu’ils soient, et ils ne souffriront jamais que l’on respire impunément l’air de leurs montagnes. L’espèce de domination que j’exerce sur eux sera sans effet le jour où je ne jurerai pas la mort de leurs oppresseurs. – Et d’ailleurs, que suis-je maintenant? ajouta Martin Paz avec une grande tristesse. Un fugitif qui n’aurait pas trois heures à vivre dans les rues de Lima!
– Ami, il faut me promettre de n’y pas retourner…
– Eh! puis-je vous le promettre, don Végal? Je ne parlerais pas selon mon cœur!»
Don Végal demeura silencieux. La passion du jeune Indien s’accroissait de jour en jour. Le marquis tremblait de le voir courir à une mort certaine, s’il reparaissait à Lima…Il hâtait de tous ses vœux, il eût voulu hâter de tous ses efforts le mariage de la juive!
Pour s’assurer par lui-même de l’état des choses, il quitta Chorillos un matin et revint à la ville. Là, il apprit que, remis de sa blessure, André Certa était sur pied, et que son prochain mariage faisait l’objet de toutes les conversations.
Don Végal voulut connaître cette jeune fille, aimée de Martin Paz. Il se rendit, le soir, sur la Plaza-Mayor, où la foule était toujours nombreuse. Là, il fit la rencontre du père Joachim, son vieil ami. Quel fut l’étonnement du prêtre, quand don Végal lui apprit l’existence de Martin Paz, et avec quel empressement il promit de veiller sur le jeune Indien et de faire parvenir au marquis les nouvelles qui l’intéresseraient!
Tout à coup, les regards de don Végal se portèrent sur une jeune fille enveloppée d’une mante noire, qui était assise dans le fond d’une calèche.
«Quelle est cette belle personne? demanda-t-il au père Joachim.
– C’est la fiancée d’André Certa, la fille du juif Samuel.
– Elle! la fille du juif!»
Le marquis contint à peine son étonnement, et, serrant la main du père Joachim, il reprit le chemin de Chorillos.
Sa surprise s’expliquait, puisqu’il venait de reconnaître, dans la prétendue juive, cette jeune fille qu’il avait vue prier à l’église Sainte-Anne.
![]()
V
![]() epuis que
les troupes colombiennes, mises par Bolivar aux ordres du général
Santa-Cruz, avaient été chassées du bas Pérou, ce pays, jusqu’alors agité
par les révoltes militaires, avait repris quelque calme et quelque
tranquillité. En effet, les ambitions particulières ne tendaient plus à
se faire jour, et le président Gambarra paraissait inébranlable dans son
palais de la Plaza-Mayor. De ce côté, il n’y avait donc rien à craindre;
mais le danger véritable, imminent, ne venait pas de ces rébellions,
aussi promptement éteintes qu’allumées, et qui semblaient flatter le goût
des Américains pour les parades militaires.
epuis que
les troupes colombiennes, mises par Bolivar aux ordres du général
Santa-Cruz, avaient été chassées du bas Pérou, ce pays, jusqu’alors agité
par les révoltes militaires, avait repris quelque calme et quelque
tranquillité. En effet, les ambitions particulières ne tendaient plus à
se faire jour, et le président Gambarra paraissait inébranlable dans son
palais de la Plaza-Mayor. De ce côté, il n’y avait donc rien à craindre;
mais le danger véritable, imminent, ne venait pas de ces rébellions,
aussi promptement éteintes qu’allumées, et qui semblaient flatter le goût
des Américains pour les parades militaires.
Or, ce péril échappait aux regards des Espagnols, trop haut placés pour le voir, et à l’attention des métis, qui ne voulaient jamais regarder au-dessous d’eux.
Et cependant, il y avait une agitation inaccoutumée parmi les Indiens de la ville, qui se mêlaient souvent aux habitants des montagnes. Ces gens semblaient avoir secoué leur apathie naturelle. Au lieu de se rouler dans leur puncho, les pieds tournés au soleil, ils se répandaient dans la campagne, s’arrêtaient les uns les autres, se reconnaissaient à des signes particuliers, et hantaient les hôtelleries les moins achalandées, dans lesquelles ils pouvaient sans danger s’entretenir.
Ce mouvement pouvait être observé principalement sur une des places écartées de la ville. A l’angle de cette place s’élevait une maison, formée d’un rez-de-chaussée seulement, et dont l’apparence assez misérable choquait les regards.
C’était une taverne de dernier ordre, tenue par une vieille Indienne, qui offrait aux plus infimes chalands sa bière de maïs fermenté et une boisson faite avec la canne à sucre.
Le rassemblement des Indiens sur cette place n’avait lieu qu’à de certaines heures, lorsqu’une longue perche se dressait sur le toit de l’auberge, comme un signal. Alors les indigènes de toute profession, conducteurs de convoi, muletiers, charretiers, entraient un à un et disparaissaient aussitôt dans la grande salle. L ‘hôtesse semblait fort affairée, et, laissant à sa servante le soin de la boutique, courait servir elle-même ses pratiques accoutumées.
Quelques jours après la disparition de Martin Paz, il y eut une assemblée nombreuse dans la salle de l’auberge. C’est à peine si dans les ténèbres, obscurcies par la fumée du tabac, l’on pouvait distinguer les habitués de cette taverne. Une cinquantaine d’Indiens étaient rangés autour d’une longue table: les uns chiquaient une sorte de feuille de thé, mêlée à un petit morceau de terre odorante; les autres buvaient à même de grands pots de maïs fermenté; mais ces occupations ne les distrayaient aucunement, et ils écoutaient avec attention la parole d’un Indien.
C’était le Sambo, dont les regards avaient une étrange fixité.
Après avoir minutieusement examiné ses auditeurs, le Sambo reprit la parole:
«Les fils du Soleil peuvent causer de leurs affaires. Il n’est pas d’oreille perfide qui puisse les entendre. Sur la place, quelques-uns de nos amis, déguisés en chanteurs des rues, attirent les passants autour d’eux, et nous Jouissons d’une liberté entière.»
En effet, les sons d’une mandoline retentissaient au dehors.
Les Indiens de l’auberge, se sachant en sûreté, prêtèrent donc une attention extrême aux paroles du Sambo, en qui ils mettaient toute leur confiance.
«Quelles nouvelles de Martin Paz le Sambo peut-il nous donner? demanda un Indien.
– Aucune. Est-il mort, ou non ?… C’est ce que le Grand-Esprit peut seul savoir. J’attends quelques-uns de nos frères, qui ont descendu le fleuve jusqu’à son embouchure. Peut-être auront-ils trouvé le corps de Martin Paz!
C’était un bon chef! dit Manangani, farouche Indien, fort redouté. Mais pourquoi n’était-il pas à son poste, le jour où la goëlette nous apportait des armes ?»
Le Sambo ne répondit pas et baissa la tête.
«Mes frères, reprit Manangani, ne savent-ils pas qu’il y a eu échange de coups de fusil entre l’Annonciacion et les gardes-côtes, et que la prise de ce bâtiment eût fait échouer tous nos plans?»
Un murmure approbateur accueillit les paroles de l’Indien.
«Ceux de mes frères qui voudront attendre pour juger seront les bienvenus! reprit le Sambo. Qui sait si mon fils, Martin Paz, ne reparaîtra pas quelque jour!… Écoutez maintenant: les armes qui nous ont été envoyées de Sechura sont en notre pouvoir; elles sont cachées dans les montagnes des Cordillères, et prêtes à faire leur office, quand vous serez préparés à faire votre devoir!
– Et qui nous retarde? s’écria un jeune Indien. Nous avons aiguisé nos couteaux, et nous attendons.
– Laissez venir l’heure, répondit le Sambo. Mes frères savent-ils quel ennemi leur bras doit frapper d’abord?
– Ce sont ces métis qui nous traitent en esclaves, dit un des assistants, ces insolents qui nous frappent de la main et du fouet, comme les mules rétives!
– Non pas, répondit un autre, ce sont les accapareurs de toutes les richesses du sol!
– Vous vous trompez, et vos premiers coups doivent porter ailleurs! reprit le Sambo en s’animant. Ces hommes ne sont pas ceux qui ont osé, il y a trois cents ans, mettre le pied sur la terre de vos ancêtres! Ces richards ne sont pas ceux qui ont traîné dans la tombe les fils de Manco-Capac. Non! ce sont ces orgueilleux Espagnols, les vrais vainqueurs dont vous êtes les vrais esclaves! S’ils n’ont plus la richesse, ils ont l’autorité, et, en dépit de l’émancipation péruvienne, ils foulent aux pieds nos droits naturels! Oublions donc ce que nous sommes, pour nous souvenir de ce que nos pères ont été!
– Oui! oui!» s’écria l’assemblée avec des trépignements d’approbation.
Après quelques moments de silence, le Sambo s’assura, en interrogeant divers conjurés, que leurs amis de Cusco et de toute la Bolivie étaient prêts à frapper comme un seul homme.
Puis, reprenant avec feu:
«Et nos frères des montagnes, brave Manangani, s’ils ont tous dans le cœur une haine égale à la tienne, un courage égal au tien, ne tomberont-ils pas sur Lima, comme une avalanche du haut des Cordillères?
– Le Sambo ne se plaindra pas de leur hardiesse au jour marqué, répondit Manangani. Que le Sambo sorte de la ville, il n’ira pas loin sans voir surgir autour de lui des Indiens ardents à la vengeance! Dans les gorges de San-Cristoval et des Amancaës, plus d’un est couché dans son puncho, le poignard à la ceinture, attendant qu’une carabine soit confiée à sa main! Eux aussi n’ont pas oublié qu’ils ont à venger sur les Espagnols la défaite de Manco-Capac.
– Bien, Manangani! reprit le Sambo. C’est le Dieu de la haine qui parle par ta bouche! Mes frères sauront avant peu celui que leurs chefs auront choisi. Le président Gambarra ne cherche qu’à se consolider au pouvoir, Bolivar est loin, Santa-Cruz est chassé. Nous pouvons agir à coup sûr. Dans quelques jours, la fête des Amancaës appellera nos oppresseurs au plaisir. Donc, que chacun soit prêt à se mettre en marche, et que la nouvelle en arrive jusqu’aux villages les plus reculés de la Bolivie!»
En ce moment, trois Indiens pénétrèrent dans la grande salle. Le Sambo marcha vivement à eux:
«Eh bien? leur demanda-t-il.
– Le corps de Martin Paz n’a pu être retrouvé, répondit un de ces Indiens. Nous avons sondé la rivière dans tous les sens, nos plus habiles plongeurs l’ont explorée avec soin, et nous pensons que le fils du Sambo ne peut avoir péri dans les eaux de la Rimac.
– L’ont-ils donc tué! Qu’est-il devenu? Oh! malheur à eux, s’ils ont tué mon fils!… Que mes frères se séparent en silence! Que chacun retourne à son poste, regarde, veille et attende!»
Les Indiens sortirent et se dispersèrent. Le Sambo demeura seul avec Manangani, qui lui demanda:
«Le Sambo sait-il quel sentiment conduisait, ce soir-là, son fils au quartier de San-Lazaro? Le Sambo est-il sûr de son fils?»
Un éclair jaillit des yeux de l’Indien. Manangani recula.
Mais l’Indien se contint et dit:
«Si Martin Paz trahissait ses frères, je tuerais d’abord tous ceux auxquels il a donné son amitié, toutes celles auxquelles il a donné son amour. Puis, je le tuerais lui-même, et je me tuerais ensuite, pour ne rien laisser sous le soleil d’une race déshonorée!»
En ce moment, l’hôtesse ouvrit la porte de la salle, s’avança vers le Sambo et lui remit un billet à son adresse.
«Qui vous a donné cela? dit-il.
– Je ne sais, répondit l’hôtesse. Ce papier aura été oublié à dessein par un buveur, car je l’ai trouvé sur une table.
– Il n’est venu que des Indiens ici?
– Il n’est venu que des Indiens.»
L’hôtesse sortit. Le Sambo déploya le billet et lut à haute voix:
«Une jeune fille a prié pour Martin Paz, car elle n’oublie pas l’Indien qui a risqué sa vie pour elle! Si le Sambo a quelque nouvelle de son fils, ou quelque espoir de le retrouver, qu’il entoure son bras d’un foulard rouge. Il y a des yeux qui levaient passer tous les jours.»
Le Sambo froissa le billet.
«Le malheureux, dit-il, s’est laissé prendre aux yeux d’une femme!
– Quelle est cette femme? demanda Manangani.
– Ce n’est pas une Indienne, répondit le Sambo, en regardant le billet. C’est quelque jeune fille élégante… Ah! Martin Paz, je ne te reconnais plus!
– Ferez-vous ce que cette femme vous prie de faire?
– Non pas, répondit violemment l’Indien. Qu’elle perde tout espoir de jamais revoir mon fils, et qu’elle en meure!»
Et le Sambo déchira le billet avec rage.
«C’est un Indien qui a dû apporter ce billet, fit observer Manangani.
– Oh! il ne peut être des nôtres! Il aura su que je venais souvent à cette auberge, mais je n’y remettrai plus les pieds. Que mon frère retourne aux montagnes, je reste à veiller sur la ville. Nous verrons si la fête des Amancaës sera joyeuse pour les oppresseurs ou pour les opprimés!»
Les deux Indiens se séparèrent.
Le plan était bien conçu et l’heure de son exécution bien choisie. Le Pérou, presque dépeuplé alors, ne comptait qu’un petit nombre d’Espagnols et de métis. L’invasion des Indiens, accourant des forêts du Brésil aussi bien que des montagnes du Chili et des plaines de la Plata, devait couvrir d’une armée redoutable le théâtre de la rébellion. Une fois les grandes villes, telles que Lima, Cusco, Puno, détruites de fond en comble, il n’était pas à croire que les troupes colombiennes, chassées depuis peu par le gouvernement péruvien, vinssent au secours de leurs ennemis en péril.
Ce bouleversement social devait donc réussir, si le secret demeurait enseveli dans le cœur des Indiens, et, certes, il n’y avait pas de traîtres parmi eux.
Mais ils ignoraient qu’un homme avait obtenu une audience particulière du président Gambarra; ils ignoraient que cet homme lui apprenait que la goëlette l’Annonciacion avait débarqué des armes de toutes sortes dans des pirogues indiennes à l’embouchure de la Rimac. Et cet homme venait réclamer une forte indemnité pour le service qu’il rendait au gouvernement péruvien, en dénonçant ces faits.
Or, cet homme jouait un double jeu. Après avoir loué son navire aux agents du Sambo pour un prix considérable, il venait vendre au président le secret des conjures.
On reconnaît, à ces traits, le juif Samuel.
![]()
VI
![]() ndré
Certa, entièrement rétabli, et croyant à la mort de Martin Paz, pressait
son mariage. Il lui tardait de promener à travers les rues de Lima la
jeune et belle juive.
ndré
Certa, entièrement rétabli, et croyant à la mort de Martin Paz, pressait
son mariage. Il lui tardait de promener à travers les rues de Lima la
jeune et belle juive.
Sarah, cependant, lui témoignait toujours une hautaine indifférence; mais il n’y prenait pas garde, car il ne la considérait que comme un objet de haut prix qu’il avait payé cent mille piastres.
Il faut dire ici qu’André Certa se défiait du juif, et à bon droit. Si le contrat était peu honorable, les contractants l’étaient encore moins. Aussi le métis voulut-il avoir avec Samuel une entrevue secrète, et l’emmena-t-il un jour à Chorillos. Le métis n’était pas d’ailleurs fâché de tenter les chances du jeu avant ses noces.
Les jeux s’étaient ouverts, dans cette station de bains, quelques jours après l’arrivée du marquis don Végal, et, depuis cette époque, il y avait un perpétuel mouvement sur la route de Lima. Tel venait à pied, qui s’en retournait en équipage; tel autre allait perdre les derniers débris de sa fortune.
Don Végal et Martin Paz ne prenaient aucune part à ces plaisirs, et les insomnies du jeune Indien avaient de plus nobles causes.
Après ses promenades du soir avec le marquis, Martin Paz rentrait dans sa chambre, et, s’accoudant sur la fenêtre, il passait de longues heures à songer.
Don Végal se souvenait toujours de la fille de Samuel, qu’il avait vue prier au temple catholique; mais il n’avait osé confier ce secret à Martin Paz, bien qu’il l’instruisît peu à peu des vérités chrétiennes. Il aurait craint de ranimer dans son cœur les sentiments qu’il voulait y éteindre, car l’Indien proscrit devait renoncer à toute espérance d’obtenir Sarah. Cependant, la police avait fini par abandonner l’affaire de Martin Paz, et, avec le temps et l’influence de son protecteur, l’Indien pouvait un jour prendre rang dans la société péruvienne.
Mais il arriva que, désespéré, Martin Paz résolut de savoir ce que devenait la jeune juive. Grâce à ses vêtements espagnols, il pouvait se glisser dans une salle de jeu et y écouter les propos des habitués. André Certa était un homme assez considérable pour que son mariage, s’il était prochain, fût l’objet de leurs conversations.
Un soir donc, au lieu de tourner ses pas du côté de la pleine mer, l’Indien prit par les hautes roches sur lesquelles reposent les principales habitations de Chorillos, et il entra dans une maison précédée d’un large escalier de pierre.
C’était la maison des jeux. La journée avait été rude pour plus d’un Liménien. Quelques-uns, brisés par les fatigues de la nuit précédente, reposaient à terre, enveloppés dans leur puncho.
D’autres joueurs étaient assis devant un large tapis vert, divisé en quatre tableaux par deux lignes qui se coupaient au centre à angles droits; sur chacun des compartiments se trouvaient les premières lettres des mots azar et suerte (hasard et sort), A et S. Les joueurs pontaient sur l’une ou l’autre de ces lettres; le banquier tenait les enjeux et jetait sur la table deux dés, dont les points combinés faisaient gagner l’A ou l’S.
En ce moment, les parties du «monté» étaient animées. Un métis poursuivait la chance défavorable avec une ardeur fébrile.
«Deux mille piastres!» s’écria-t-il.
Le banquier agita ses dés, et le joueur éclata en imprécations.
«Quatre mille piastres!» dit-il de nouveau.
Il les perdit encore.
Martin Paz, protégé par l’ombre du salon, put regarder le joueur en face. C’était André Certa.
Debout, près de lui, se tenait le juif Samuel.
«Assez joué, señor, lui dit Samuel. La veine n’est pas pour vous aujourd’hui!
– Que vous importe!» répondit brusquement le métis.
Samuel se pencha à son oreille.
«S’il ne m’importe pas à moi, dit-il, il vous importe de rompre avec ces habitudes pendant les derniers jours qui précèdent votre mariage!
– Huit mille piastres!» répondit André Certa, en pontant sur l’S.
L’A sortit. Le métis laissa échapper un blasphème. Le banquier reprit:
«Faites vos jeux!»
André Certa, tirant des billets de sa poche, allait hasarder une somme considérable; il la déposa même sur un des tableaux, et le banquier remuait déjà ses dés, quand un signe de Samuel l’arrêta court. Le juif se pencha de nouveau à l’oreille du métis et lui dit:
«S’il ne vous reste rien pour conclure notre marché, ce soir tout sera rompu!»
André Certa leva les épaules, fit un geste de rage; puis, reprenant son argent, il sortit.
«Continuez maintenant, dit Samuel au banquier. Vous ruinerez ce señor après son mariage!»
Le banquier s’inclina avec soumission, car le juif était le fondateur et le propriétaire des jeux de Chorillos. Partout où il y avait un réal à gagner, on rencontrait cet homme.
Samuel suivit le métis, et, le trouvant sur le perron de pierre, il lui dit:
«J’ai les choses les plus graves à vous apprendre. Où pouvons-nous causer en sûreté?
– Où vous voudrez! répondit brusquement André Certa.
– Señor, que votre mauvaise humeur ne perde pas votre avenir ! Je ne me fie ni aux chambres les mieux closes, ni aux plaines les plus désertes pour vous livrer mon secret. Si vous me le payez cher, c’est qu’il vaut la peine d’être bien gardé!»
En parlant ainsi, ces deux hommes étaient arrivés sur la plage, devant les cabanes destinées aux baigneurs. Ils ne se savaient pas vus et écoutés par Martin Paz, qui se glissait comme un serpent dans l’ombre.
«Prenons un canot, dit André Certa, et allons en pleine mer.»
André Certa détacha du rivage une petite embarcation et jeta quelque monnaie à son gardien. Samuel s’embarqua avec lui, et le métis poussa au large.
Mais, en voyant le canot s’éloigner, Martin Paz, caché dans l’anfractuosité d’une roche, s’était déshabillé à la hâte, et, ne gardant qu’un poignard passé à sa ceinture, il nagea vigoureusement vers le canot.
Le soleil venait d’éteindre ses derniers rayons dans les flots du Pacifique, et de silencieuses ténèbres enveloppaient le ciel et la mer.
Martin Paz n’avait seulement pas songé que des requins de la plus dangereuse espèce sillonnaient ces funestes parages. Il s’arrêta non loin de l’embarcation du métis et à portée de la voix.
«Mais quelle preuve de l’identité de la fille apporterai-je au père? demandait André Certa au juif.
– Vous lui rappellerez les circonstances dans lesquelles il a perdu cette enfant.
– Quelles sont ces circonstances?
– Les voici.»
Martin Paz, se tenant à peine au-dessus des flots, écoutait, mais sans pouvoir comprendre.
«Le père de Sarah, dit le juif, habitait Concepcion, au Chili. C’était le grand seigneur que vous connaissez déjà. Seulement sa fortune rivalisait encore avec sa noblesse. Obligé de venir à Lima pour des affaires d’intérêt, il partit seul, laissant à Concepcion sa femme et sa petite fille, âgée de quinze mois. Le climat du Pérou lui convint sous tous les rapports, et il manda à la marquise de venir le rejoindre. Elle s’embarqua sur le San-Jose, de Valparaiso, avec quelques domestiques de confiance. Je me rendais au Pérou par le même navire. Le San-Jose devait relâcher à Lima; mais, à la hauteur de Juan-Fernandez, il fut assailli par un ouragan terrible, qui le désempara et le coucha sur le côté. Les gens de l’équipage et les passagers se réfugièrent dans la chaloupe; mais, à la vue de la mer en fureur, la marquise refusa d’y mettre le pied; elle serra son enfant dans ses bras et demeura sur le navire. J’y restai avec elle. La chaloupe s’éloigna et fut engloutie à cent brasses du San-Jose, avec tout son équipage. Nous demeurâmes seuls. La tempête se déchaînait avec une extrême violence. Comme ma fortune n’était pas à bord, je ne me désespérais pas autrement. Le San-Jose, ayant cinq pieds d’eau dans la cale, dériva sur les rochers de la côte, où il se brisa entièrement. La jeune femme fut jetée à la mer avec sa fille. Heureusement pour moi, je pus saisir l’enfant, dont la mère périt sous mes yeux, et gagner le rivage.
– Tous ces détails sont exacts?
– Parfaitement exacts. Le père ne les démentira pas. Ah! j’avais fait une bonne journée, señor, puisqu’elle va me valoir les cent mille piastres que vous allez me compter!
– Qu’est-ce que cela veut dire? se demandait Martin Paz.
– Voici mon portefeuille avec les cent mille piastres, répondit André Certa.
– Merci! señor, dit Samuel en saisissant le trésor. Prenez vous-même ce reçu en échange. Je m’y engage à vous restituer le double de cette somme, si vous ne faites pas partie d’une des premières familles de l’Espagne!»
Mais l’Indien n’avait pas entendu cette dernière phrase. Il avait dû plonger pour éviter l’approche de l’embarcation, et ses yeux purent voir alors une masse informe glisser rapidement vers lui.
C’était une tintorea, requin de la plus cruelle espèce.
Martin Paz vit l’animal s’approcher de lui, et plongea, mais bientôt il dut venir respirer à la surface de l’eau. Un coup de queue de la tintorea frappa Martin Paz, qui sentit les visqueuses écailles du monstre froisser sa poitrine. Le requin, pour happer sa proie, se retourna sur le dos, entr’ouvrant sa mâchoire armée d’un triple rang de dents; mais, Martin Paz ayant vu briller le ventre blanc de l’animal, le frappa de son poignard.
Soudain, il se trouva dans des eaux rouges de sang. Il plongea de nouveau, revint à dix brasses de là, et, n’apercevant plus l’embarcation du métis, il regagna la côte en quelques brassées, ayant oublié déjà qu’il venait d’échapper à une mort terrible.
Le lendemain, Martin Paz avait quitté Chorillos, et don Végal, bourrelé d’inquiétudes, revenait en toute hâte à Lima pour tâcher de l’y rejoindre.
![]()
VII
![]() ’était un
véritable événement que le mariage d’André Certa avec la fille du riche
Samuel. Les señoras n’avaient plus un moment de repos; elles s’épuisaient
à inventer quelque joli corsage ou quelque coiffure nouvelle, et se
fatiguaient à essayer les toilettes les plus variées.
’était un
véritable événement que le mariage d’André Certa avec la fille du riche
Samuel. Les señoras n’avaient plus un moment de repos; elles s’épuisaient
à inventer quelque joli corsage ou quelque coiffure nouvelle, et se
fatiguaient à essayer les toilettes les plus variées.
De nombreux préparatifs se faisaient aussi dans la maison de Samuel, qui voulait donner un grand retentissement au mariage de Sarah. Les fresques qui paraient sa demeure, selon la coutume espagnole, avaient été somptueusement restaurées; les tentures les plus riches retombaient en larges plis aux fenêtres et aux portes de l’habitation; les meubles sculptés, en bois précieux ou odoriférants, s’entassaient dans de vastes salons imprégnés d’une bienfaisante fraîcheur; les arbustes rares, les productions des terres chaudes serpentaient le long des balustrades et des terrasses.
La jeune fille, cependant, n’avait plus d’espoir, puisque le Sambo n’en avait pas, et le Sambo n’espérait plus, puisqu’il ne portait pas à son bras le signe de l’espérance! Liberta avait épié les démarches du vieil Indien… il n’avait rien pu découvrir.
Ah! si la pauvre Sarah eût pu suivre les mouvements de son cœur, elle se fût réfugiée dans un couvent pour y finir sa vie! Poussée par un irrésistible attrait vers les dogmes du catholicisme, secrètement convertie par les soins du père Joachim, elle s’était ralliée à cette religion qui sympathisait si bien avec les croyances de son cœur.
Le père Joachim, afin d’éviter tout scandale, et, d’ailleurs, lisant plus son bréviaire que le cœur humain, avait laissé Sarah croire à la mort de Martin Paz. La conversion de la jeune fille lui importait avant tout, et, la voyant assurée par son union avec André Certa, il tâchait de l’habituer à ce mariage, dont il était loin de soupçonner les conditions.
Enfin ce jour, si joyeux pour les uns, si triste pour les autres, était arrivé. André Certa avait convié la ville entière à la soirée nuptiale, mais ses invitations furent sans résultat vis-à-vis des familles nobles, qui s’excusèrent par des motifs plus ou moins plausibles.
Cependant l’heure était venue, à laquelle le contrat devait être signé, et la jeune fille ne paraissait pas…
Le juif Samuel était en proie à un secret mécontentement. André Certa fronçait le sourcil d’une façon peu patiente. Une sorte d’embarras se peignait sur le visage des invités, tandis que des milliers de bougies, répétées par les glaces, remplissaient les salons d’éclatantes lumières.
Au dehors, dans la rue, un homme errait dans une anxiété mortelle: c’était le marquis don Végal.
![]()
VIII
![]() arah, cependant, en proie aux plus vives angoisses, était demeurée
seule. Elle ne pouvait s’arracher de sa chambre. Un instant, suffoquée
par l’émotion, elle s’appuya au balcon qui donnait sur les jardins
intérieurs.
arah, cependant, en proie aux plus vives angoisses, était demeurée
seule. Elle ne pouvait s’arracher de sa chambre. Un instant, suffoquée
par l’émotion, elle s’appuya au balcon qui donnait sur les jardins
intérieurs.
Soudain, elle aperçut un homme qui se glissait entre les allées de magnolias. Elle reconnut Liberta, son serviteur. Liberta semblait épier quelque invisible ennemi, tantôt s’abritant derrière une statue, tantôt se couchant à terre.
Tout à coup Sarah pâlit. Liberta était aux prises avec un homme de grande taille qui l’avait terrassé, et quelques soupirs étouffés prouvaient qu’une main robuste pressait les lèvres du nègre.
La jeune fille allait crier, lorsqu’elle vit se redresser les deux hommes. Le nègre regardait son adversaire.
«Vous! vous! c’est vous!» dit-il.
Et il suivit cet homme, qui, avant que Sarah eût pu jeter un seul cri, lui apparut ainsi qu’un fantôme de l’autre monde. Et, comme le nègre terrassé sous le genou de l’Indien, la jeune fille, courbée sous le regard de Martin Paz, ne put à son tour laisser échapper que ces mots:
«Vous! vous! c’est vous!»
Martin Paz fixa son regard sur elle et lui dit:
«La fiancée entend-elle les bruits de la fête? Les invités se pressent dans les salons pour voir rayonner le bonheur sur son visage! Est-ce donc une victime, préparée pour le sacrifice, qui va s’offrir à leurs yeux? Est-ce avec ces traits pâlis par la douleur que la jeune fille peut se présenter à son fiancé?»
Pendant que Martin Paz parlait, Sarah l’entendait à peine.
Le jeune Indien reprit alors:
«Puisque la jeune fille est en pleurs, qu’elle regarde plus loin que la maison de son père, plus loin que la ville où elle souffre!»
Sarah releva la tête. Martin Paz s’était redressé de toute sa hauteur, et, le bras étendu vers le sommet des Cordillères, il montrait à la jeune fille le chemin de la liberté.
Sarah se sentit entraînée par une puissance insurmontable. Déjà le bruit de quelques voix arrivait jusqu’à elle. On s’approchait de sa chambre. Son père allait y entrer sans doute; son fiancé l’accompagnait peut-être! Martin Paz éteignit subitement la lampe suspendue au-dessus de sa tête… Un sifflement, rappelant celui qui s’était fait entendre sur la Plaza-Mayor, perça les ténèbres de la nuit.
La porte s’ouvrit brusquement. Samuel et André Certa entrèrent. L’obscurité était profonde. Quelques serviteurs accoururent avec des flambeaux… La chambre était vide!
«Mort et furie! s’écria le métis.
– Où est-elle? dit Samuel.
– Vous en êtes responsable envers moi,» lui répondit brutalement André Certa.
A ces paroles, le juif sentit une sueur froide le glacer jusqu’aux os.
«A moi!» s’écria-t-il.
Et, suivi de ses domestiques, il s’élança hors de la maison.
Cependant, Martin Paz fuyait rapidement à travers les rues de la ville. A deux cents pas de la demeure du juif, il trouva quelques Indiens qui s’étaient rassemblés au sifflement poussé par lui.
«A nos montagnes! s’écria-t-il.
– A la maison du marquis don Végal!» dit une voix derrière lui.
Martin Paz se retourna.
L’Espagnol était à ses côtés.
«Ne me confierez-vous pas cette jeune fille?» lui demanda don Végal.
L’Indien courba la tête, et d’une voix sourde:
«A la demeure du marquis don Végal!» répondit-il.
Martin Paz, subissant l’ascendant du marquis, lui avait confié la jeune fille. Il savait qu’elle était en sûreté dans sa maison, et, comprenant à quoi l’honneur l’engageait, il ne voulut point passer la nuit sous le toit de don Végal.
Il sortit donc; sa tête était brûlante, et la fièvre faisait bouillir son sang dans ses veines…
Mais, il n’avait pas fait cent pas que cinq ou six hommes se jetèrent sur lui et, malgré sa défense opiniâtre, parvinrent à le garrotter. Martin Paz poussa un rugissement de désespoir. Il se crut au pouvoir de ses ennemis.
Quelques instants après, il était déposé dans une chambre, et on lui enlevait le bandeau qui lui couvrait les yeux. Il regarda autour de lui et se vit dans la salle basse de cette taverne où ses frères avaient organisé leur première révolte.
Le Sambo, qui avait assisté à l’enlèvement de la jeune fille, était là. Manangani et d’autres l’entouraient. Un éclair de haine jaillit des yeux de Martin Paz.
«Mon fils n’a donc pas pitié de mes larmes, dit le Sambo, puisqu’il me laisse si longtemps croire à sa mort?
– Est-ce à la veille d’une révolte, demanda Manangani, que Martin Paz, notre chef, devait se trouver dans le camp de nos ennemis?»
Martin Paz ne répondit ni à son père ni à l’Indien.
«Ainsi, nos intérêts les plus graves ont été sacrifiés à une femme?»
Et, en parlant ainsi, Manangani s’était rapproché de Martin Paz, un poignard à la main. Martin Paz ne le regarda même pas.
«Parlons d’abord, dit le Sambo. Nous agirons plus tard. Si mon fils manque à ses frères, je saurai maintenant sur qui venger sa trahison. Qu’il prenne garde! la fille du juif Samuel n’est pas si bien cachée qu’elle puisse nous échapper! Mon fils réfléchira, d’ailleurs. Frappé d’une condamnation à mort, il n’a plus dans cette ville une pierre pour reposer sa tête. Si, au contraire, il délivre son pays, c’est pour lui l’honneur et la liberté!»
Martin Paz demeura silencieux, mais un combat terrible se livrait en lui. Le Sambo venait de faire vibrer les cordes de cette fière nature.
Martin Paz était indispensable aux projets des révoltés; il jouissait d’une autorité suprême sur les Indiens de la ville; il les manœuvrait à sa guise, et, rien que d’un signe, il les eût entraînés à la mort.
Les liens qui l’enchaînaient furent détachés par l’ordre du Sambo. Martin Paz se releva.
«Mon fils, lui dit l’Indien, qui l’observait avec attention, demain, pendant la fête des Amancaës, nos frères tomberont comme une’ avalanche sur les Liméniens désarmés. Voici le chemin des Cordillères, voici le chemin de la ville. Tu es libre.
– Aux montagnes! s’écria Martin Paz. Aux montagnes, et malheur à nos ennemis!»
Et le soleil levant éclaira de ses premiers rayons le conciliabule des chefs indiens au sein des Cordillères.
![]()
IX
![]() e jour de
la grande fête des Amancaës, le 24 juin, était arrivé. Les habitants, à
pied, à cheval, en voiture, se rendaient sur un plateau célèbre, situé à
une demi-lieue de la ville. Métis et Indiens s’entremêlaient dans la fête
commune; ils marchaient gaiement par groupes de parents ou d’amis. Chaque
groupe portait ses provisions, précedé d’un joueur de guitare, qui
chantait les airs les plus populaires. Ces promeneurs s’avançaient par
les champs de maïs et d’alfala, à travers les bosquets de bananiers, et
ils traversaient ces belles allées plantées de saules, pour retrouver les
bois de citronniers et d’orangers, dont les parfums se confondaient avec
les sauvages odeurs de la montagne. Tout le long de la route, des
cabarets ambulants offraient l’eau-de-vie et la bière, dont les copieuses
libations excitaient aux rires et aux clameurs. Les cavaliers faisaient
caracoler leurs chevaux au milieu de la foule et luttaient de vitesse,
d’adresse et d’habileté.
e jour de
la grande fête des Amancaës, le 24 juin, était arrivé. Les habitants, à
pied, à cheval, en voiture, se rendaient sur un plateau célèbre, situé à
une demi-lieue de la ville. Métis et Indiens s’entremêlaient dans la fête
commune; ils marchaient gaiement par groupes de parents ou d’amis. Chaque
groupe portait ses provisions, précedé d’un joueur de guitare, qui
chantait les airs les plus populaires. Ces promeneurs s’avançaient par
les champs de maïs et d’alfala, à travers les bosquets de bananiers, et
ils traversaient ces belles allées plantées de saules, pour retrouver les
bois de citronniers et d’orangers, dont les parfums se confondaient avec
les sauvages odeurs de la montagne. Tout le long de la route, des
cabarets ambulants offraient l’eau-de-vie et la bière, dont les copieuses
libations excitaient aux rires et aux clameurs. Les cavaliers faisaient
caracoler leurs chevaux au milieu de la foule et luttaient de vitesse,
d’adresse et d’habileté.
Il régnait dans cette fête, qui tire son nom des petites fleurs de la montagne, une fougue et une liberté inconcevables; et, cependant, jamais une rixe n’éclatait entre les mille cris de la joie publique. A peine si quelques lanciers à cheval, ornés de leurs cuirasses étincelantes, maintenaient çà et là l’ordre parmi la population.
Et quand toute cette foule arriva enfin sur le plateau des Amancaës, une immense clameur d’admiration fut répétée par les profondeurs de la montagne.
Aux pieds des spectateurs s’étendait l’ancienne Cité des rois, qui dressait hardiment vers le ciel ses tours et ses clochers pleins d’étourdissants carillons. San-Pedro, Saint-Augustin, la cathédrale appelaient le regard sur leurs toitures resplendissantes des rayons du soleil; San-Domingo, la riche église dont la madone n’est jamais vêtue deux jours de suite des mêmes draperies, élevait plus haut que ses voisines sa flèche évidée. Sur la droite, l’océan Pacifique faisait onduler ses vastes plaines bleues au souffle de la brise, et l’œil, en revenant du Callao à Lima, se promenait sur tous ces monuments funéraires qui contenaient les restes de la grande dynastie des Incas. A l’horizon, le cap Morro-Solar encadrait les splendeurs de ce tableau.
Mais, pendant que les Liméniens admiraient ces pittoresques points de vue, un drame sanglant se préparait sur les sommets glacés des Cordillères.
En effet, pendant que la ville était presque désertée par ses habitants ordinaires, un grand nombre d’Indiens erraient dans les rues. Ces hommes, qui d’ordinaire prenaient une part active aux jeux des Amancaës, se promenaient alors silencieusement avec de singulières préoccupations. Souvent, quelque chef affairé leur jetait un ordre secret et reprenait sa route, et tous se réunissaient peu à peu dans les riches quartiers de la ville.
Cependant le soleil commençait à baisser à l’horizon. C’était l’heure à laquelle l’aristocratie liménienne allait à son tour aux Amancaës. Les plus riches toilettes resplendissaient dans les équipages qui défilaient à droite et à gauche sous les arbres de la route. Ce fut alors une inextricable mêlée de piétons, de voitures et de cavaliers.
Cinq heures sonnèrent à la tour de la cathédrale.
Un cri immense retentit dans la ville. De toutes les places, de toutes les rues, de toutes les maisons, s’élancèrent des Indiens, les armes à la main. Les beaux quartiers furent bientôt encombrés de ces révoltés, dont quelques-uns secouaient au-dessus de leur tête des torches enbrasées.
«Mort aux Espagnols! Mort aux oppresseurs!» tel était le mot d’ordre.
Aussitôt, le sommet des collines se couvrit d’autres Indiens qui rejoignirent leurs frères de la ville.
On se figure l’aspect que Lima présentait en ce moment. Les révoltés s’étaient répandus dans tous les quartiers. A la tête d’une des colonnes, Martin Paz agitait le drapeau noir, et, tandis que les Indiens attaquaient les maisons désignées à la ruine, il abordait la Plaza-Mayor avec sa troupe. Près de lui, Manangani poussait des hurlements féroces.
Là, les soldats du gouvernement, prévenus de la révolte, étaient rangés en bataille devant le palais du président. Une fusillade effroyable accueillit les insurgés à leur entrée sur la place. Surpris d’abord par cette décharge inattendue, qui coucha bon nombre des leurs sur le terrain, ils s’élancèrent contre les troupes avec un emportement insurmontable. Il s’ensuivit une horrible mêlée, où les hommes se prirent corps à corps. Martin Paz et Manangani firent des prodiges de valeur, et ils n’échappèrent que par miracle à la mort.
Il leur fallait à tout prix enlever le palais et s’y retrancher.
«En avant !» cria Martin Paz, et sa voix entraîna les siens à l’assaut.
Bien qu’ils fussent écrasés de toutes parts, les Indiens parvinrent à faire reculer le cordon de troupes enroulé autour du palais. Déjà Manangani s’élançait sur les premières marches du perron, quand il s’arrêta soudain. Les rangs des soldats ouverts avaient démasqué deux pièces de canon, prêtes à mitrailler les assiégeants.
Il n’y avait pas une seconde à perdre. Il fallait sauter sur la batterie avant qu’elle eût éclaté.
«A nous deux!» s’écria Manangani, en s’adressant à Martin Paz.
Mais Martin Paz venait de se baisser et n’écoutait plus, car un nègre lui glissait ces mots à l’oreille:
«On pille la maison de don Végal. On l’assassine peut-être!»
A ces paroles, Martin Paz recula. Manangani voulut l’entraîner, mais à ce moment les canons éclataient, et la mitraille balayait les Indiens.
«A moi!» cria Martin Paz, et, quelques dévoués compagnons se joignant à lui, il put se faire jour à travers les soldats.
Cette fuite eut toutes les conséquences d’une trahison. Les Indiens se crurent abandonnés par leur chef. Manangani essaya vainement de les ramener au combat. Une épaisse fusillade les enveloppa. Dès lors il ne fut plus possible de les rallier. La confusion fut à son comble et la déroute complète. Les flammes qui s’élevaient de certains quartiers attirèrent quelques fuyards au pillage; mais les soldats les poursuivirent l’épée dans les reins, et ils en tuèrent un grand nombre.
Pendant ce temps, Martin Paz avait gagné la maison de don Végal, qui était le théâtre d’une lutte acharnée, dirigée par le Sambo lui-même. Le vieil Indien avait un double intérêt à se trouver là: tout en combattant l’Espagnol, il voulait s’emparer de Sarah, gage de la fidélité de son fils.
La porte et les murailles de la cour, renversées, laissaient voir don Végal, l’épée à la main, entouré de ses serviteurs et tenant tête à une masse envahissante. La fierté de cet homme et son courage avaient quelque chose de sublime. Il s’offrait le premier aux coups, et son bras redoutable l’avait entouré de cadavres.
Mais que faire contre cette foule d’Indiens, qui s’augmentait alors de tous les vaincus de la Plaza-Mayor? Don Végal sentait faiblir ses défenseurs, et il n’avait plus qu’à se faire tuer, lorsque Martin Paz, rapide comme la foudre, chargea les agresseurs par derrière, les força de se retourner contre lui, et, au milieu des balles, il arriva jusqu’à don Végal, auquel il fit un rempart de son corps.
«Bien, mon fils, bien!» dit don Végal à Martin Paz, en lui étreignant la main.
Mais le jeune Indien était sombre.
«Bien, Martin Paz!» s’écria une autre voix, qui lui alla jusqu’à l’âme.
Il reconnut Sarah, et son bras traça un vaste cercle de sang autour de lui.
Cependant, la troupe du Sambo pliait à son tour. Vingt fois, ce nouveau Brutus avait dirigé ses coups contre son fils, sans pouvoir l’atteindre, et vingt fois Martin Paz avait détourné son arme prête à frapper son père.
Soudain, Manangani, couvert de sang, parut auprès du Sambo.
«Tu as juré, lui dit-il, de venger la trahison d’un infâme sur ses proches, sur ses amis, sur lui-même! Il est temps! Voici les soldats qui arrivent! Le métis André Certa est avec eux!
– Viens donc, Manangani, dit le Sambo avec un rire féroce, viens donc!»
Et tous deux, abandonnant la maison de don Végal, coururent vers la troupe qui arrivait au pas de course. On les coucha en joue, mais, sans être intimidé, le Sambo alla droit au métis.
«Vous êtes André Certa, lui dit-il. Eh bien, votre fiancée est dans la maison de don Végal, et Martin Paz va l’entraîner dans les montagnes!»
Cela dit, les Indiens disparurent.
Ainsi, le Sambo avait mis face à face les deux mortels ennemis, et, trompés par la présence de Martin Paz, les soldats s’élancèrent contre la maison du marquis.
André Certa était ivre de fureur. Dès qu’il aperçut Martin Paz, il se précipita sur lui.
«A nous deux!» hurla le jeune Indien, et, quittant l’escalier de pierre qu’il avait si vaillamment défendu, il rejoignit le métis.
Ils étaient là, pied contre pied, poitrine contre poitrine, leurs visages se touchant, leurs regards se confondant. dans un seul éclair. Amis et ennemis ne pouvaient les approcher. Ils s’étreignirent alors, et, dans cette terrible étreinte, la respiration leur manqua. Mais André Certa se redressa contre Martin Paz, dont le poignard s’était échappé. Le métis leva son bras, que l’Indien parvint à saisir avant qu’il eût frappé. André Certa voulut en vain se dégager. Martin Paz, retournant le poignard contre le métis, le lui plongea tout entier dans le cœur.
Puis il se jeta dans les bras de don Végal.
«Aux montagnes, mon fils, s’écria le marquis, fuis aux montagnes! maintenant je te l’ordonne!»
En ce moment, le juif Samuel apparut et se précipita sur le cadavre d’André Certa, auquel il arracha un portefeuille. Mais il avait été vu de Martin Paz, qui, le lui reprenant à son tour, l’ouvrit, le feuilleta, poussa un cri de joie, et, s’élançant vers le marquis, lui remit un papier où se trouvaient ces lignes:
«Reçu du señor André Certa la somme de 100,000 piastre que je m’engage à lui restituer, si Sarah, qui j’ai sauvée lors de naufrage du San-Jose, n’est pas la fille et l’unique héritière de maquis don Végal.
SAMUEL.»
«Ma fille!» s’écria l’Espagnol, et il s’élança vers la chambre de Sarah…
La jeune fille n’y était plus, et le père Joachim, baigné dans son sang, ne put articuler que ces mots:
«Le Sambo!… Enlevée!… Rivière de Madeira!…»
![]()
X
![]() n route!» s’écria
Martin Paz.
n route!» s’écria
Martin Paz.
Et, sans prononcer un seul mot, don Végal suivit l’Indien. Sa fille!… Il lui fallait retrouver sa fille!
Des mules furent amenées; les deux hommes les enfourchèrent; de grandes guêtres furent attachées par des courroies au-dessus de leurs genoux, et de larges chapeaux de paille leur abritèrent la tête. Des pistolets remplissaient les fontes de leur selle; une carabine était pendue à leur côté. Martin Paz avait enroulé autour de lui son lazo, dont une extrémité se fixait au harnachement de sa mule.
Martin Paz connaissait les plaines et les montagnes qu’ils allaient franchir. Il savait dans quel pays perdu le Sambo entraînait sa fiancée. Sa fiancée! Oserait-il donner ce nom à la fille du marquis don Végal.
L’Espagnol et l’Indien, n’ayant qu’une idée, qu’un but, s’enfoncèrent bientôt dans les gorges des Cordillères, plantées de cocotiers et de pins. Les cèdres, les cotonniers, les aloès restaient derrière eux, avec les plaines couvertes de maïs et de luzerne. Quelques cactus épineux piquaient parfois leurs mules et les faisaient hésiter sur le penchant des précipices.
C’était une rude tâche que de traverser les montagnes à cette époque. La fonte des neiges sous le soleil de juin faisait jaillir des cataractes, et souvent des masses effroyables, se détachant du sommet des pics, allaient s’engouffrer dans les abîmes sans fond.
Mais le père et le fiancé couraient jour et nuit sans se reposer un instant.
Ils parvinrent au sommet des Andes, à quatorze mille pieds au-dessus du niveau de la mer. Là, plus d’arbres, plus de végétation. Souvent, ils étaient enveloppés par ces formidables orages des Cordillères, qui soulèvent des tourbillons de neige au-dessus des cimes les plus élevées. Don Végal s’arrêtait parfois malgré lui, mais Martin Paz le soutenait et l’abritait contre les immenses entassements de neige.
A ce point, le plus élevé des Andes, en proie à cet état maladif qui dépouille l’homme le plus intrépide de son courage, il leur fallut une volonté surhumaine pour résister à la fatigue.
Sur le versant oriental des Cordillères, ils retrouvèrent les traces des Indiens et purent enfin redescendre la chaîne des montagnes.
Ils atteignirent les immenses forêts vierges qui hérissent les plaines situées entre le Pérou et le Brésil, et là, au milieu de ces bois inextricables, Martin Paz fut bien servi par sa sagacité indienne.
Un feu à moitié éteint, des empreintes de pas, la cassure des petites branches, la nature des vestiges, tout était pour lui un sujet d’études.
Don Végal craignait que sa malheureuse fille n’eût été entraînée à pied à travers les pierres et les ronces; mais l’Indien lui montra quelques cailloux incrustés en terre, qui indiquai du pied d’un animal; au-dessus, des branchages avaient été repoussés dans la même direction et ne pouvaient être atteints que par une personne à cheval. Don Végal se reprenait à espérer. Martin Paz était si confiant, si habile, qu’il n’y avait pour lui ni obstacles infranchissables, ni insurmontables périls!
Un soir, Martin Paz et don Végal furent contraints par la fatigue de s’arrêter. Ils étaient arrivés sur le bord d’une rivière. C’étaient les premiers courants de la Madeira, que l’Indien reconnut parfaitement. D’immenses mangliers se penchaient au-dessus des eaux et s’unissaient aux arbres de l’autre rive par des lianes capricieuses.
Les ravisseurs avaient-ils remonté les rives ou descendu le cours du fleuve? l’avaient-ils traversé en droite ligne? Telles étaient les questions que se posait Martin Paz. En suivant avec une peine infinie quelques empreintes fugitives, il fut amené à longer les berges jusqu’à une clairière un peu moins sombre. Là, quelques piétinements indiquaient qu’une troupe d’hommes avait franchi le fleuve à cet endroit.
Martin Paz cherchait à s’orienter, quand il vit une sorte de masse noire remuer près d’un taillis. Il prépara vivement son lazo et se tint prêt à une attaque; mais, s’étant avancé de quelques pas, il aperçut une mule couchée à terre, en proie aux dernières convulsions. La pauvre bête expirante avait dû être frappée loin de l’endroit où elle s’était traînée, en laissant de longues traces de sang que Martin Paz retrouva. Il ne douta plus que les Indiens, ne pouvant lui faire traverser le fleuve, ne l’eussent tuée d’un coup de poignard. Il ne conçut donc plus de doute sur la direction de ses ennemis et revint près de son compagnon.
«Demain peut-être nous serons arrivés, lui dit-il.
– Partons à l’instant, répondit l’Espagnol.
– Mais il faut traverser ce fleuve!
– Nous le traverserons à la nage!»
Tous deux se dépouillèrent de leurs habits, que Martin Paz réunit en paquet sur sa tête, et ils se glissèrent silencieusement dans l’eau, de peur d’éveiller quelques-uns de ces dangereux caïmans, si nombreux dans les riviêres du Brésil et du Pérou.
Ils arrivèrent à l’autre rive. Le premier soin de Martin Paz fut de rechercher les traces des Indiens, mais il eut beau examiner les feuilles, les cailloux, il ne put rien découvrir. Comme le courant assez rapide les avait entraînés à la dérive, don Végal et l’Indien remontèrent la berge du fleuve, et, là, ils retrouvèrent des empreintes auxquelles ils ne pouvaient se tromper.
C’était là que le Sambo avait traversé la Madeira avec sa troupe, qui s’était augmentée sur son passage. En effet, les Indiens des plaines et des montagnes, qui attendaient avec impatience le triomphe de la révolte, apprenant qu’ils avaient été trahis, poussèrent des rugissements de rage, et, voyant qu’ils avaient une victime à sacrifier, suivirent la troupe du vieil Indien.
La jeune fille n’avait plus le sentiment de ce qui se passait autour d’elle. Elle allait, parce que des mains la poussaient en avant. On l’eût abandonnée au milieu de ces solitudes, qu’elle n’aurait pas fait un pas pour échapper à la mort. Parfois le souvenir du jeune Indien passait devant ses yeux; puis, elle retombait comme une masse inerte sur le cou de sa mule. Lorsque, au delà du fleuve, elle dut suivre à pied ses ravisseurs, deux Indiens la traînèrent rapidement, et une trace de sang manqua son passage.
Mais le Sambo s’inquiétait peu que ce sang trahît sa direction. Il approchait de son but, et bientôt les cataractes du fleuve firent entendre leurs assourdissantes rumeurs.
La troupe d’Indiens arriva à une sorte de bourgade composée d’une centaine de huttes faites de joncs entrelacés et de terre. A son approche, une multitude de femmes et d’enfants s’élancèrent avec de grands cris de joie; mais cette joie se changea en fureur quand ils apprirent la défection de Martin Paz.
Sarah, immobile devant ses ennemis, les regardait d’un œil éteint. Toutes ces hideuses figures grimaçaient autour d’elle, et les menaces les plus terribles étaient proférées à ses oreilles!
«Où est mon époux? disait l’une. C’est toi qui l’as fait tuer!
– Et mon frère, qui ne reviendra plus à sa cabane, qu’en as-tu fait?
– A mort! Que chacune de nous ait un morceau de sa chair! A mort!»
Et ces femmes, brandissant des couteaux, agitant des tisons enflammés, soulevant des pierres énormes, s’approchaient de la jeune fille.
«Arrière! s’écria le Sambo, et que tous attendent la décision des chefs!»
Les femmes obéirent aux paroles du vieil Indien, en jetant d’effroyables regards à la jeune fille. Sarah, couverte de sang, était étendue sur les cailloux de la rive.
Au-dessous de cette bourgade, la Madeira, resserrée dans un lit profond, précipitait ses masses d’eau, avec une rapidité foudroyante, de plus de cent pieds de hauteur, et ce fut dans ces cataractes que les chefs condamnèrent Sarah à trouver la mort.
Aux premiers rayons du soleil, elle devait être attachée dans un canot d’écorce et abandonnée au courant de la Madeira.
Ainsi le décida le conseil, et s’il avait retardé jusqu’au lendemain le supplice de la victime, c’était pour lui donner une nuit d’angoisses et de terreurs.
Lorsque la sentence fut connue, des hurlements de joie l’accueillirent, et un délire furieux s’empara de tous les Indiens.
Ce fut une nuit d’orgie. L’eau-de-vie fermenta dans ces têtes exaltées. Des danseurs échevelés entourèrent la jeune fille. Des Indiens couraient à travers les champs incultes, brandissant des branches de pin enflammées.
Ce fut ainsi jusqu’au lever du soleil, et pis encore, quand ses premiers rayons vinrent éclairer la scène.
La jeune fille fut détachée du poteau, et cent bras voulurent à la fois la traîner au supplice. Quand le nom de Martin Paz s’échappait de ses lèvres, des cris de haine et de vengeance lui répondaient aussitôt. Il fallut gravir par des sentiers abrupts l’immense entassement de rochers qui conduisaient au niveau supérieur du fleuve, et la victime y arriva tout ensanglantée. Un canot d’écorce l’attendait à cent pas de la chute. Elle y fut déposée et attachée par des liens qui lui entraient dans les chairs.
«Vengeance!» s’écria la tribu entière d’une seule et même voix.
Le canot fut entraîné rapidement et tournoya sur lui-même…
Soudain deux hommes parurent sur la rive opposée. C’étaient Martin Paz et don Végal.
«Ma fille! ma fille!» s’écria le père, en tombant à genoux sur la rive.
Le canot courait vers la cataracte.
Martin Paz, debout sur un rocher, balança son lazo, qui siffla autour de sa tête. A l’instant où l’embarcation allait être précipitée, la longue lanière de cuir se déroula et saisit le canot de son nœud coulant.
«A mort!» hurla la horde sauvage des Indiens.
Martin Paz se raidit alors, et le canot, suspendu sur l’abîme, peu à peu, vint à lui…
Soudain, une flèche siffla à travers les airs, et Martin Paz, tombant en avant dans la barque de la victime, alla s’engloutir avec Sarah dans le tourbillon de la cataracte.
Presque au même instant, une seconde flèche atteignait don Végal et lui perçait le cœur.
Martin Paz et Sarah étaient fiancés pour la vie éternelle, car, dans leur suprême réunion, le dernier geste de la jeune fille avait imprimé le sceau du baptême au front de l’Indien régénéré.
FIN
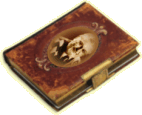
1 Martin Paz est (avec Maître Zacharius, Un Hivernage dans les glaces et Un Drame dans les airs, publiés dans le volume des Œuvres de M. Verne qui a pour titre général le Docteur Ox) une des œuvres de début de l’auteur, antérieures à la publication de Cinq Semaines en ballon. L’auteur n’avait pas encore trouvé le genre qu’il a créé et qui a rendu son nom célèbre. Mais il est curieux de le suivre jusque dans ces essais. Ils contiennent déjà quelques-uns des germes qui font de l’œuvre générale de Jules Verne une œuvre à part dans notre littérature, et à ce titre ils méritaient d’être conservés. J. HETZEL.
2 Cachées.
3 Nom injurieux que les Péruviens donnent aux Européens.