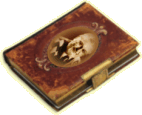Jules Verne
HECTOR SERVADAC
voyages et aventures à travers le monde solaire
(Chapitre XVII-XX)
Dessins de P. Philippoteaux
Bibliothèque D’Éducation et de Récréation
J. Hetzel et Cie
© Andrzej Zydorczak
![]()
Qui traite de la grande question du retour a la terre et de la proposition hardie qui fut faite par le lieutenant Procope
![]() son retour, Hector Servadac fit connaître au comte Timascheff le résultat de sa visite aux Anglais. Il ne lui cacha pas que Ceuta avait été vendu par les Espagnols, qui, d’ailleurs, n’avaient aucun droit de le vendre, et il ne tut que ses projets personnels.
son retour, Hector Servadac fit connaître au comte Timascheff le résultat de sa visite aux Anglais. Il ne lui cacha pas que Ceuta avait été vendu par les Espagnols, qui, d’ailleurs, n’avaient aucun droit de le vendre, et il ne tut que ses projets personnels.
Il fut donc convenu que, puisque les Anglais ne voulaient pas venir à la Terre-Chaude, on se passerait de leur concours. Ils étaient prévenus. A eux de s’en tirer comme ils l’entendraient.
Restait donc à traiter cette grave question de la nouvelle rencontre qui devait se produire entre la comète et le sphéroïde terrestre.
En principe, il fallait regarder comme un véritable miracle que, lors du premier choc, le capitaine Servadac, ses compagnons, les animaux, en un mot tous les êtres enlevés à la terre, eussent survécu. Cela tenait sans doute à ce que le mouvement s’était lentement modifié par suite de circonstances inconnues. Si la terre comptait quelques victimes déjà, on le saurait plus tard. En tout cas, un fait certain, c’est que nul de ceux qui avaient été emportés, aussi bien à l’île Gourbi qu’à Gibraltar, à Ceuta, à Madalena et à Formentera, n’avait personnellement souffert de la collision.
En serait-il de même au retour? Il n’y fallait pas compter, très probablement.
Ce fut dans la journée du 10 novembre que se traita cette importante question. Le comte Timascheff, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope se réunirent dans cette excavation qui leur servait de salle commune. Ben-Zouf fut naturellement admis à la séance. Quant à Palmyrin Rosette, régulièrement convoqué, il avait refusé de venir, cette question ne l’intéressant en aucune manière. Depuis la disparition de sa chère Nérina, il ne pouvait se consoler. Menacé de perdre sa comète, comme il avait perdu son satellite, il désirait qu’on le laissât tranquille. Ce qu’on fit.
Le capitaine Servadac et le comte Timascheff, de plus en plus froids l’un pour l’autre, ne laissèrent rien paraître de leurs secrètes pensées et discutèrent la question dans l’intérêt de tous.
Le capitaine Servadac prit d’abord la parole en ces termes:
«Messieurs, dit-il, nous voici au 10 novembre. Si les calculs de mon ex-professeur sont justes – et ils doivent l’être –, c’est donc exactement dans cinquante et un jours qu’une nouvelle rencontre s’opérera entre la comète et la terre. En prévision de cette éventualité, avons-nous quelque précaution à prendre?
– Évidemment, capitaine, répondit le comte Timascheff; mais est-il en notre pouvoir d’en prendre, et ne sommes-nous pas absolument à la merci de la Providence?
– Elle ne défend pas de s’aider, monsieur le comte, reprit le capitaine Servadac. Au contraire.
– Avez-vous quelque idée de ce que l’on peut faire, capitaine Servadac?
– Aucune, en vérité.
– Comment, messieurs, dit alors Ben-Zouf, des savants comme vous, sauf le respect que je vous dois, ne sont pas capables de diriger cette satanée comète où ils voudront et comme ils le voudront?
– D’abord, nous ne sommes pas des savants, Ben-Zouf, répondit le capitaine Servadac, et, le fussions-nous, nous n’y pourrions rien. Vois si Palmyrin Rosette, qui, lui, est un savant…
– Mal embouché, dit Ben-Zouf.
– Soit, mais savant, peut empêcher sa Gallia de retourner à la terre!
– Mais à quoi sert la science alors?
– A savoir, la plupart du temps, qu’on ne sait pas encore tout! répondit le comte Timascheff.
– Messieurs, dit le lieutenant Procope, il est certain que, dans ce nouveau choc, divers dangers nous menacent. Si vous le voulez bien, je vais les énumérer, et nous verrons s’il est possible de les combattre, ou, tout au moins, d’en atténuer les effets.
– Parle, Procope», répondit le comte Timascheff.
Tous causaient si tranquillement de ces choses, qu’on eût dit vraiment qu’elles ne les regardaient pas.
«Messieurs, reprit le lieutenant Procope, il faut d’abord se demander de quelle façon pourra se produire cette nouvelle rencontre entre la comète et le globe terrestre. Nous verrons ensuite ce qu’il y a à craindre ou à espérer dans chacun des cas possibles.
– Rien de plus logique, répondit le capitaine Servadac; mais n’oublions pas que les deux astres se dirigent l’un vers l’autre, et que leur vitesse, au moment du choc, sera de quatre-vingt-dix mille lieues à l’heure!
– Deux jolis trains! se permit d’ajouter Ben-Zouf.
– Voyons donc comment s’effectuera le choc, reprit le lieutenant Procope. Les deux astres se rencontreront ou obliquement ou normalement. Dans le premier cas, il peut arriver que Gallia ne fasse qu’effleurer la terre, comme la première fois, après en avoir arraché encore quelques morceaux, et qu’elle retourne graviter dans l’espace. Mais son orbite serait sans doute dérangée, et nous aurions peu de chances, si nous avions survécu, de jamais revoir nos semblables.
– Ce qui ferait l’affaire de M. Palmyrin Rosette, mais non la nôtre, fit observer le judicieux Ben-Zouf.
– Laissons donc de côté cette hypothèse, répondit le comte Timascheff. Nous en connaissons suffisamment les avantages et les désavantages. Arrivons au choc direct, c’est-à-dire au cas où, après avoir heurté la terre, Gallia y resterait attachée.
– Comme une verrue sur une figure, dit Ben-Zouf.
– Silence, Ben-Zouf, répondit Hector Servadac.
– Oui, mon capitaine.
– Voyons donc, reprit le lieutenant Procope, quelles sont les hypothèses que présente un choc direct. Avant tout, il faut admettre que la masse de la terre étant de beaucoup supérieure à celle de Gallia, sa vitesse ne sera pas retardée dans cette rencontre et qu’elle emportera la comète avec elle.
– Cela est admis, répondit le capitaine Servadac.
– Eh bien, messieurs, dans l’hypothèse d’un choc direct, ou Gallia accostera la terre par la partie de sa surface que nous occupons à l’équateur, ou par la partie située à nos antipodes, ou, enfin, par l’un ou l’autre de ses pôles. Or, dans ces divers cas, les chances sont pour que pas un des êtres vivants qu’elle porte n’y puisse survivre.
– Expliquez-vous, lieutenant, dit le capitaine Servadac.
– Si nous sommes, au moment de la rencontre, à la partie heurtante de l’équateur, nous serons écrasés.
– Cela va de soi, répondit Ben-Zouf.
– Si nous sommes aux antipodes de cette partie, outre la certitude d’être écrasés encore, puisque la vitesse qui nous animera sera subitement anéantie – ce qui équivaudra à un choc –, nous avons encore la certitude d’être asphyxiés. En effet, l’atmosphère gallienne ira se mêler a l’atmosphère terrestre, et il n’y aura plus d’air respirable sur le sommet de cette montagne, haute de cent lieues, que formera Gallia sur la terre.
– Et si Gallia heurte la terre par l’un ou l’autre de ses pôles?… demanda le comte Timascheff.
– Dans ce cas, répondit le lieutenant Procope, nous serons inévitablement projetés et brisés dans une chute épouvantable
– Très bien, dit Ben-Zouf.
– J’ajoute, au cas impossible où aucune de ces hypothèses ne se produirait, que nous serons infailliblement brûlés.
– Brûlés? dit Hector Servadac.
– Oui, car, lorsque la vitesse de Gallia, venant à être anéantie par l’obstacle, se transformera en chaleur, la comète sera en tout ou en partie incendiée sous l’influence d’une température qui s’élèvera à quelques milliers de degrés!
Tout ce que disait le lieutenant Procope était rigoureusement exact. Ses auditeurs le regardaient et écoutaient, sans être autrement étonnes, le développement de ces différentes hypothèses.
«Mais, monsieur Procope, dit Ben-Zouf. une question. Si Gallia tombe dans la mer?…
– Quelque profonds que soient l’Atlantique ou le Pacifique, répondit le lieutenant Procope – et leur profondeur ne dépasse pas quelques lieues –, le coussin d’eau sera toujours insuffisant pour amortir le choc. Donc, tous les effets que j’ai indiqués tout à l’heure se reproduiraient…
– Et même avec la noyade en plus!… répondit Ben-Zouf.
– Ainsi, messieurs, dit le capitaine Servadac, brisés, noyés, écrasés, asphyxiés ou rôtis, tel est le sort qui nous attend, quelle que soit la manière dont la rencontre se fera!
Oui, capitaine Servadac, répondit sans hésiter le lieutenant Procope.
– Eh bien, dit Ben-Zouf, puisqu’il en est ainsi, je ne vois absolument qu’une chose à faire!
– Laquelle? demanda Hector Servadac.
– C’est de quitter Gallia avant le choc.
– Et le moyen?
– Oh! le moyen est bien simple! répondit tranquillement Ben-Zouf. Il n’y en a pas!
– Peut-être!» dit le lieutenant Procope.
Tous les regards se portèrent sur le lieutenant, qui, la tête dans les mains, réfléchissait à quelque projet audacieux.
«Peut-être, répéta-t-il, et, si extravagant que mon plan puisse vous paraître, je crois qu’il faudra l’exécuter.
– Parle, Procope», répondit le comte Timascheff.
Le lieutenant resta, pendant quelques instants encore, plongé dans ses réflexions. Puis: «Ben-Zouf, reprit-il, a indiqué le seul parti qu’il y eût à prendre: quitter Gallia avant le choc.
– Est-ce donc possible? demanda le comte Timascheff.
– Oui… peut-être… oui!
– Et comment?
– Au moyen d’un ballon!…
– Un ballon! s’écria le capitaine Servadac. Mais c’est bien usé, votre ballon! Même dans les romans, on n’ose plus s’en servir!
– Veuillez m’écouter, messieurs, reprit le lieutenant Procope, en fronçant légèrement le sourcil. A la condition de connaître exactement l’instant où s’effectuera le choc, nous pouvons, une heure auparavant, nous enlever dans l’atmosphère de Gallia. Cette atmosphère nous entraînera nécessairement avec sa vitesse acquise; mais, avant la rencontre, elle pourra se confondre avec l’atmosphère terrestre, et il est possible que, par une sorte de glissement, le ballon passe de l’une à l’autre, en évitant le choc direct, et qu’il se maintienne en l’air, pendant que la collision se produira.
– Bien, Procope, répondit le comte Timascheff, nous te comprenons… et ce que tu as dit là, nous le ferons!
– Sur cent chances, reprit le lieutenant Procope, nous en avons quatre-vingt-dix-neuf contre nous!
– Quatre-vingt dix-neuf!
– Au moins, car il est certain qu’au moment où son mouvement de translation s’arrêtera, le ballon sera brûlé.
– Lui aussi? s’écria Ben-Zouf.
– Lui aussi bien que la comète, répondit Procope… à moins que dans cette fusion entre les deux atmosphères… Je ne sais trop… il me serait difficile de dire… mais mieux vaut, ce me semble, au moment du choc, avoir quitté le sol de Gallia.
– Oui! oui! dit le capitaine Servadac. N’y eût-il qu’une chance bonne sur cent mille, nous la courrons!
– Mais nous n’avons pas d’hydrogène pour gonfler un ballon… dit le comte Timascheff.
– L’air chaud nous suffira, répondit Procope, car il ne sera pas nécessaire de rester plus d’une heure dans l’air.
– Bien, dit le capitaine Servadac… une montgolfière… c’est primitif et plus facile a fabriquer… Mais l’enveloppe?…
– Nous la taillerons dans les voiles de la Dobryna, qui sont en toile légère et résistante…
– Bien parlé, Procope, répondit le comte Timascheff. Tu as vraiment réponse à tout.
– Hurrah! bravo!» cria Ben-Zouf, pour conclure.
C’était, en vérité, un plan hardi que venait de proposer le lieutenant Procope. Toutefois, la perte des colons étant assurée en toute autre hypothèse, il fallait tenter l’aventure et résolument. Pour cela, il importait de connaître exactement, non seulement l’heure, mais la minute, mais, s’il était possible, la seconde à laquelle la collision se produirait.
Le capitaine Servadac se chargea de le demander à Palmyrin Rosette, en prenant toutes sortes de ménagements. Donc, dès cette époque, sous la direction du lieutenant, on commença la construction de la montgolfière. Elle devait être d’assez grande dimension pour enlever tous les habitants de la Terre-Chaude, au nombre de vingt-trois, – car, après leur refus, il n’y avait plus à se préoccuper des Anglais de Gibraltar et de Ceuta.
En outre, le lieutenant Procope résolut d’accroître ses chances en se donnant la possibilité de planer plus longtemps dans l’atmosphère, après le choc, si le ballon avait résisté. Il se pouvait faire qu’il eût à chercher un endroit convenable pour atterrir, et il ne fallait pas que son véhicule lui manquât. De là, cette résolution qu’il prit d’emporter une certaine quantité de combustible, herbe ou paille sèche, pour réchauffer l’air intérieur de la montgolfière. C’est ainsi que procédaient autrefois les premiers aérostiers.
Les voiles de la Dobryna avaient été emmagasinées à Nina-Ruche. Elles étaient faites d’un tissu très serré, qu’il serait facile de rendre plus étanche encore au moyen d’un vernis. Tous ces ingrédients se trouvaient dans la cargaison de la tartane, et par conséquent à la disposition du lieutenant. Celui-ci traça avec soin le gabarit des bandes à découper. Ce travail se fit dans de bonnes conditions, et tout le monde s’employa à la couture de ces bandes, – tous, y compris la petite Nina. Les matelots russes, très exercés à ce genre d’ouvrage, montrèrent aux Espagnols comment ils devaient s’y prendre, et le nouvel atelier ne chôma pas.
On dit tous, – mais en exceptant le juif, dont personne ne regretta l’absence, et Palmyrin Rosette, qui ne voulait seulement pas savoir que l’on construisît une montgolfière!
Un mois se passa dans ces travaux. Le capitaine Servadac n’avait pas encore trouvé l’occasion de poser à son ex-professeur la question relative à la nouvelle rencontre des deux astres. Palmyrin Rosette était inabordable. Des jours se passaient sans qu’on l’aperçût. La température étant redevenue presque supportable pendant le jour, il se confinait dans son observatoire, dont il avait repris possession, et il n’y laissait pénétrer personne. A une première ouverture du capitaine Servadac, il avait fort mal répondu. Plus que jamais désespéré de revenir à la terre, il ne voulait pas se préoccuper des périls du retour, ni rien faire pour le salut commun.
Et, cependant, c’était une chose essentielle que de connaître avec une extrême exactitude cet instant où les deux astres se réuniraient l’un à l’autre avec une vitesse de vingt-sept lieues à la seconde.
Le capitaine Servadac dut donc patienter, et il patienta.
Cependant, Gallia continuait à se rapprocher progressivement du soleil. Le disque terrestre grossissait visiblement aux yeux des Galliens. La comète, pendant le mois de novembre, avait franchi cinquante-neuf millions de lieues, et, au 1er décembre, elle ne s’était plus trouvée qu’à soixante-dix-huit millions de lieues du soleil.
La température se relevait considérablement et provoqua la débâcle avec le dégel. Ce fut un magnifique spectacle que celui de cette mer qui se disloquait et se dissolvait. On entendit cette «grande voix des glaces», comme disent les baleiniers. Sur les pentes du volcan et du littoral, les premiers filets d’eau serpentèrent capricieusement. Des torrents, puis des cascades s’improvisèrent en quelques jours. Les neiges des hauteurs fondaient de toutes parts.
En même temps, les vapeurs commencèrent à s’élever sur l’horizon. Peu à peu des nuages se formèrent et se déplacèrent rapidement sous l’action des vents, qui s’étaient tus pendant le long hiver gallien. On devait compter sur de prochains troubles atmosphériques, mais, en somme, c’était la vie qui revenait avec la chaleur et la lumière à la surface de la comète.
Toutefois, deux accidents prévus se produisirent alors et amenèrent la destruction de la marine gallienne.
Au moment de la débâcle, la goélette et la tartane étaient encore élevées de cent pieds au-dessus du niveau de la mer. Leur énorme piédestal avait légèrement fléchi et s’inclinait avec le dégel. Sa base, minée par les eaux plus chaudes, ainsi que cela arrive aux icebergs de la mer Arctique, menaçait de lui manquer. Il était impossible de sauver les deux bâtiments, et c’était à la montgolfière de les remplacer.
Ce fut pendant la nuit du 12 au 13 décembre que la débâcle s’accomplit. Par suite d’une rupture d’équilibre, le massif de glace culbuta tout d’un bloc. C’en était fait de la Hansa et de la Dobryna, qui se brisèrent sur les récifs du littoral.
Ce malheur, qu’ils attendaient, qu’ils ne pouvaient empêcher, ne laissa pas d’impressionner douloureusement les colons. On eût dit que quelque chose de la terre venait de leur manquer.
Dire ce que furent les lamentations d’Isac Hakhabut devant cette destruction instantanée de sa tartane, les malédictions qu’il lança contre la mauvaise race, c’est impossible. Il accusa le capitaine Servadac et les siens. Si on ne l’avait pas obligé à conduire la Hansa à cette crique de la Terre-Chaude, si on l’eût laissée au port de l’île Gourbi, tout cela ne serait pas arrivé! On avait agi contre sa volonté, on était responsable, et, de retour à la terre, il saurait bien actionner ceux qui lui avaient causé un tel dommage!
«Mordioux! s’écria le capitaine Servadac, taisez-vous, maître Isac, ou je vous fais mettre aux fers!»
Isac Hakhabut se tut et retourna dans son trou.
Le 14 décembre la montgolfière fut achevée. Soigneusement cousue et vernie, elle était d’une solidité remarquable. Le filet avait été fabriqué avec les légers cordages de la Dobryna. La nacelle, faite de claies d’osier qui formaient les compartiments de cale à bord de la Hansa, était suffisante à contenir vingt-trois personnes. Il ne s’agissait, après tout, que d’une courte ascension, – le temps de se glisser avec l’atmosphère de Gallia dans l’atmosphère terrestre. On ne devait pas regarder à ses aises.
Restait donc toujours cette question d’heure, de minute et de seconde, sur laquelle le rébarbatif, l’entêté Palmyrin Rosette ne s’était pas encore prononcé.
A cette époque, Gallia recoupa l’orbite de Mars, qui se trouvait à une distance de cinquante-six millions de lieues environ. Il n’y avait donc rien à craindre.
Cependant, ce jour-là, 15 décembre, pendant la nuit, les Galliens purent croire que leur dernière heure était arrivée. Une sorte de tremblement de «terre» se produisit. Le volcan s’agita comme s’il eût été secoué par quelque convulsion souterraine. Le capitaine Servadac et ses compagnons crurent que la comète se disloquait, et ils quittèrent en toute hâte le massif ébranlé.
En même temps, des cris se firent entendre dans l’observatoire, et l’on vit apparaître sur les roches l’infortuné professeur, un morceau de sa lunette brisée à la main.
Mais on ne s’occupa pas de le plaindre. Dans cette sombre nuit, un second satellite parut graviter autour de Gallia.
C’était un morceau même de la comète!
Sous l’action d’une expansion intérieure, elle s’était dédoublée, ainsi qu’avait fait autrefois la comète Gambart. Un énorme fragment, détaché d’elle-même, avait été lancé dans l’espace, et il emportait avec lui les Anglais de Ceuta et les Anglais de Gibraltar!
![]()
Dans lequel on verra que les galliens se préparent à contempler d’un peu haut l’ensemble de leur astéroïde
![]() uelles pouvaient être les conséquences de ce grave événement au point de vue de Gallia? Le capitaine Servadac et ses compagnons n’osaient encore répondre à cette question.
uelles pouvaient être les conséquences de ce grave événement au point de vue de Gallia? Le capitaine Servadac et ses compagnons n’osaient encore répondre à cette question.
Le soleil revint promptement sur l’horizon, et d’autant plus promptement que le dédoublement avait tout d’abord produit ce résultat: si le sens du mouvement de rotation de Gallia n’était pas modifié, si la comète se mouvait toujours sur son axe de l’orient à l’occident, la durée de cette rotation diurne avait diminué de moitié. L’intervalle entre deux levers du soleil n’était plus que de six heures au lieu de douze. Six heures après avoir paru sur l’horizon, l’astre radieux se couchait sur l’horizon opposé.
«Mordioux! avait dit le capitaine Servadac, cela nous fait une année de deux mille huit cents jours!
– Il n’y aura jamais assez de saints pour ce calendrier-là!» avait répondu Ben-Zouf.
Et de fait, si Palmyrin Rosette voulait réapproprier son calendrier à la nouvelle durée des jours galliens, il en viendrait à parler du 238 juin ou du 325 décembre!
Quant à ce morceau de Gallia qui emportait les Anglais et Gibraltar, il fut manifestement visible qu’il ne gravitait pas autour de la comète. Il s’en éloignait, au contraire. Mais avait-il entraîné avec lui une portion quelconque de la mer et de l’atmosphère galliennes? Se trouvait-il dans des conditions d’habitabilité suffisantes? Et, en dernier compte, reviendrait-il jamais à la terre?
On le saurait plus tard.
Quelles étaient les conséquences du dédoublement sur la marche de Gallia? Voilà ce que le comte Timascheff, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope s’étaient tout d’abord demandé. Ils avaient d’abord senti un accroissement de leurs forces musculaires et constaté une nouvelle diminution de la pesanteur. La masse de Gallia ayant diminué dans une proportion notable, sa vitesse n’en serait-elle pas modifiée, et ne pouvait-on craindre qu’un retard ou une avance dans sa révolution ne lui fissent manquer la terre?
C’eût été là un irréparable malheur!
Mais la vitesse de Gallia avait-elle varié, si peu que ce fût? Le lieutenant Procope ne le pensait pas. Toutefois il n’osait se prononcer, n’ayant pas des connaissances suffisantes en ces matières.
Seul, Palmyrin Rosette pouvait répondre à cette question. Il fallait donc, d’une manière ou d’une autre, par la persuasion ou par la violence, l’obliger à parler, et à dire en même temps quelle était l’heure précise à laquelle la rencontre aurait lieu.
Tout d’abord, pendant les jours suivants, on put constater que le professeur était d’une humeur massacrante. Était-ce la perte de sa fameuse lunette, ou ne pouvait-on en conclure ceci: c’est que le dédoublement n’avait point altéré la vitesse de Gallia, et que, conséquemment, elle rencontrerait la terre au moment précis. En effet, si, par suite du dédoublement, la comète eût avancé ou retardé, si le retour eût été compromis, la satisfaction de Palmyrin Rosette aurait été telle qu’il n’eût pu la contenir. Puisque sa joie ne débordait pas, c’est qu’il n’avait pas sujet d’être joyeux, – au moins de ce chef.
Le capitaine Servadac et ses compagnons tablèrent donc sur cette remarque, mais cela ne suffisait pas. Il fallait arracher son secret à ce hérisson.
Enfin, le capitaine Servadac y parvint. Voici dans quelles circonstances:
C’était le 18 décembre. Palmyrin Rosette, exaspéré, venait de soutenir une violente discussion avec Ben-Zouf. Celui-ci avait insulté le professeur en la personne de sa comète! Un bel astre, ma foi, qui se disloquait comme un joujou d’enfant, qui crevait comme une outre, qui se fendait comme une noix sèche! Autant vivre sur un obus, sur une bombe, dont la mèche est allumée! etc. Enfin, on imagine aisément ce que Ben-Zouf avait pu broder sur ce thème. Les deux interlocuteurs s’étaient réciproquement jeté, l’un Gallia, l’autre Montmartre, à la tête.
Le hasard fit que le capitaine Servadac intervint au plus chaud de la discussion. Fût-ce une inspiration d’en haut? mais il se dit que puisque la douceur ne réussissait pas avec Palmyrin Rosette, peut-être la violence agirait-elle plus efficacement, et il prit le parti de Ben-Zouf.
Colère du professeur, qui se traduisit instantanément par les paroles les plus aigres.
Colère, mais colère feinte, du capitaine Servadac, qui finit par dire:
«Monsieur le professeur, vous avez une liberté de langage qui ne me convient pas et que je suis résolu à ne plus supporter! Vous ne vous souvenez pas assez que vous parlez au gouverneur général de Gallia!
– Et vous, riposta l’irascible astronome, vous oubliez beaucoup trop que vous répondez à son propriétaire!
– Il n’importe, monsieur! Vos droits de propriété sont, après tout, très contestables!
– Contestables?
– Et puisqu’il nous est impossible, maintenant, de revenir à la terre, vous vous conformerez désormais aux lois qui régissent Gallia!
– Ah! vraiment! répondit Palmyrin Rosette, je devrai me soumettre à l’avenir!
– Parfaitement.
– Maintenant surtout que Gallia ne doit pas revenir à la terre?…
– Et que, par conséquent, nous sommes destinés à y vivre éternellement, répondit le capitaine Servadac.
– Et pourquoi Gallia ne doit-elle plus revenir à la terre? demanda le professeur avec l’accent du plus profond mépris.
– Parce que depuis qu’elle s’est dédoublée, répondit le capitaine Servadac, sa masse a diminué, et que, par conséquent, un changement a dû se produire dans sa vitesse.
– Et qui a dit cela?
– Moi, tout le monde!
– Eh bien, capitaine Servadac, tout le monde et vous, vous êtes des…
– Monsieur Rosette!
– Des ignorants, des ânes bâtés, qui ne connaissez rien à la mécanique céleste!
– Prenez garde!
– Ni à la physique la plus élémentaire…
– Monsieur!…
– Ah! mauvais élève! reprit le professeur, dont la colère atteignait au paroxysme. Je n’ai point oublié qu’autrefois vous déshonoriez ma classe!…
– C’en est trop!…
– Que vous étiez la honte de Charlemagne!…
– Vous vous tairez, sinon…
– Non, je ne me tairai pas, et vous m’écouterez, tout capitaine que vous êtes! Vraiment! Les beaux physiciens! Parce que la masse de Gallia a diminué, ils se figurent que cela a pu modifier sa vitesse tangentielle! Comme si cette vitesse ne dépendait pas uniquement de sa vitesse primordiale combinée avec l’attraction solaire! Comme si les perturbations ne s’obtenaient pas sans qu’on tînt compte des masses des astres troublés! Est-ce qu’on connaît la masse des comètes? Non! Est-ce qu’on calcule leurs perturbations? Oui! Ah! vous me faites pitié!»
Le professeur s’emportait. Ben-Zouf, prenant la colère du capitaine Servadac au sérieux, lui dit:
«Voulez-vous que je le casse en deux, mon capitaine, que je le dédouble comme sa fichue comète?
– Eh bien, touchez-moi seulement! s’écria Palmyrin Rosette en se redressant de toute sa petite taille.
– Monsieur, répliqua vivement le capitaine Servadac, je saurai vous mettre à la raison!
– Et moi, vous traduire pour menaces et voies de fait devant les tribunaux compétents!
– Les tribunaux de Gallia?
– Non, monsieur le capitaine, mais ceux de la terre!
– Allons donc! La terre est loin! repartit le capitaine Servadac.
– Si loin qu’elle soit, s’écria Palmyrin Rosette, emporté au-delà de toute mesure, nous n’en couperons pas moins son orbite au nœud ascendant, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et nous y arriverons à deux heures quarante-sept minutes trente-cinq secondes et six dixièmes du matin!…
– Mon cher professeur, répondit le capitaine Servadac avec un salut gracieux, je ne vous en demandais pas davantage!»
Et il quitta Palmyrin Rosette, absolument interloqué, auquel Ben-Zouf crut devoir adresser un salut non moins gracieux que celui de son capitaine.
Hector Servadac et ses compagnons savaient enfin ce qu’ils avaient tant intérêt à savoir. A deux heures quarante-sept minutes trente-cinq secondes et six dixièmes du matin s’effectuerait la rencontre.
Donc, encore quinze jours terrestres, soit trente-deux jours galliens de l’ancien calendrier, soit soixante-quatre du nouveau!
Cependant, les préparatifs de départ s’accomplissaient avec une ardeur sans pareille. C’était pour tous une hâte d’avoir quitté Gallia. La montgolfière du lieutenant Procope semblait être un moyen assuré de rallier le globe terrestre. Se glisser avec l’atmosphère gallienne dans l’atmosphère terrestre, cela paraissait être la chose la plus facile du monde. On oubliait les mille dangers de cette situation sans précédent dans les voyages aérostatiques! Rien n’était plus naturel! Et, pourtant, le lieutenant Procope répétait avec raison que la montgolfière, brusquement arrêtée dans son mouvement de translation, serait brûlée avec tous ceux qu’elle porterait, – à moins de miracle. Le capitaine Servadac se montrait, à dessein, enthousiasmé. Quant à Ben-Zouf, il avait toujours voulu faire une promenade en ballon. Il était donc au comble de ses vœux.
Le comte Timascheff, plus froid, et le lieutenant Procope, plus réservé, envisageaient seuls tout ce que cette tentative offrait de dangers. Mais ils étaient prêts à tout.
A cette époque, la mer, délivrée de ses glaçons, était redevenue praticable. La chaloupe à vapeur fut mise en état, et, avec ce qui restait de charbon, on fit plusieurs voyages à l’île Gourbi.
Le capitaine Servadac, Procope et quelques Russes furent du premier voyage. Ils retrouvèrent l’île, le gourbi, le poste, respectés par ce long hiver. Des ruisseaux coulaient à la surface du sol. Les oiseaux, ayant quitté la Terre-Chaude à tire-d’aile, étaient revenus à ce bout de terre fertile, où ils revoyaient la verdure des prairies et des arbres. Des plantes nouvelles apparaissaient sous l’influence de cette chaleur équatoriale des jours de trois heures. Le soleil leur versait ses rayons perpendiculaires avec une extraordinaire intensité. C’était l’été brûlant, succédant presque inopinément à l’hiver.
Ce fut à l’île Gourbi que l’on fit la récolte de l’herbe et de la paille qui devaient servir au gonflement de la montgolfière. Si cet énorme appareil n’eût pas été si encombrant, peut-être l’aurait-on transporté par mer à l’île Gourbi. Mais il parut préférable de s’enlever de la Terre-Chaude et d’y apporter le combustible destiné à opérer la raréfaction de l’air.
Déjà, pour les besoins journaliers, on brûlait le bois provenant des débris des deux navires. Lorsqu’il fut question d’utiliser ainsi les bordages de la tartane, Isac Hakhabut voulut s’y opposer. Mais Ben-Zouf lui fit entendre qu’on lui ferait payer cinquante mille francs sa place dans la nacelle, s’il s’avisait seulement d’ouvrir la bouche.
Isac Hakhabut soupira et se tut.
Le 25 décembre arriva. Tous les préparatifs de départ étaient terminés. On fêta la Noël comme on l’avait fêtée un an auparavant, mais avec un plus vif sentiment religieux. Quant au prochain jour de l’an, c’était sur terre que tous ces braves gens comptaient bien le célébrer, et Ben-Zouf alla jusqu’à promettre de belles étrennes au jeune Pablo et à la petite fille.
«Voyez-vous, leur dit-il, c’est comme si vous les teniez!»
Bien que cela soit peut-être difficile à admettre, à mesure que le moment suprême approchait, le capitaine Servadac et le comte Timascheff pensaient à toute autre chose qu’aux dangers de l’atterrissage. La froideur qu’ils se témoignaient n’était point feinte. Ces deux années qu’ils venaient de passer ensemble loin de la terre, c’était pour eux comme un rêve oublié, et ils allaient se retrouver sur le terrain de la réalité, en face l’un de l’autre. Une image charmante se plaçait entre eux et les empêchait de se voir comme autrefois.
Et c’est alors que vint au capitaine Servadac la pensée d’achever ce fameux rondeau, dont le dernier quatrain était resté inachevé. Quelques vers encore, et ce délicieux petit poème serait complet. C’était un poète que Gallia avait enlevé à la terre, ce serait un poète qu’elle lui rendrait!
Et, entre-temps, le capitaine Servadac repassait toutes ses malencontreuses rimes dans sa tête.
Quant aux autres habitants de la colonie, le comte Timascheff et le lieutenant Procope avaient hâte de revoir la terre, et les Russes n’avaient qu’une pensée: suivre leur maître partout où il lui plairait de les mener.
Les Espagnols, eux, s’étaient si bien trouvés sur Gallia, qu’ils y auraient volontiers passé le reste de leurs jours. Mais enfin Negrete et les siens ne reverraient pas les campagnes de l’Andalousie sans quelque plaisir.
Pour Pablo et Nina, ils étaient enchantés de revenir avec tous leurs amis, mais à la condition de ne plus jamais se quitter.
Restait donc un seul mécontent, le rageur Palmyrin Rosette. Il ne décolérait pas. Il jurait qu’il ne s’embarquerait pas dans la nacelle. Non! il prétendait ne pas abandonner sa comète. Il continuait jour et nuit ses observations astronomiques. Ah! combien sa regrettable lunette lui faisait défaut! Voilà que Gallia allait pénétrer dans cette étroite zone des étoiles filantes! N’y avait-il pas là des phénomènes à observer, quelque découverte à faire?
Palmyrin Rosette, désespéré, employa alors un moyen héroïque en augmentant la pupille de ses yeux, afin de remplacer tant soit peu la puissance optique de sa lunette. Il se soumit à l’action de la belladone, ingrédient qu’il emprunta à la pharmacie de Nina-Ruche, et alors il regarda, il regarda à se rendre aveugle! Mais, bien qu’il eût ainsi accru l’intensité de la lumière qui se peignait sur sa rétine, il ne vit rien, il ne découvrit rien!
Les derniers jours se passèrent dans une surexcitation fébrile dont personne ne fut exempt. Le lieutenant Procope surveillait les derniers détails. Les deux bas-mâts de la goélette avaient été plantés sur la grève et servaient de support à l’énorme montgolfière, non encore gonflée, mais revêtue du réseau de son filet. La nacelle était là, suffisante à contenir ses passagers. Quelques outres, attachées à ses montants, devaient lui permettre de surnager un certain temps, pour le cas où la montgolfière atterrirait en mer, près d’un littoral. Évidemment, si elle tombait en plein Océan, elle coulerait bientôt avec tous ceux qu’elle portait, à moins que quelque navire ne se trouvât à point pour les recueillir.
Les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre s’écoulèrent. Il n’y avait plus que quarante-huit heures terrestres à passer sur Gallia.
Le 31 décembre arriva. Encore vingt-quatre heures, et la montgolfière, enlevée par l’air chaud raréfié dans ses flancs, planerait dans l’atmosphère gallienne. Il est vrai que cette atmosphère était moins dense que celle de la terre; mais il faut considérer aussi que l’attraction étant moindre, l’appareil serait moins lourd à enlever.
Gallia se trouvait alors à quarante millions de lieues du soleil, distance un peu supérieure à celle qui sépare le soleil de la terre. Elle s’avançait avec une excessive vitesse vers l’orbite terrestre qu’elle allait couper à son nœud ascendant, précisément au point de l’écliptique qu’occuperait le sphéroïde.
Quant à la distance qui séparait la comète de la terre, elle n’était plus que de deux millions de lieues. Or, les deux astres marchant l’un vers l’autre, cette distance allait être franchie à raison de quatre-vingt-sept mille lieues à l’heure. Gallia en faisant cinquante-sept mille, et la terre vingt-neuf mille environ.
Enfin, à deux heures du matin, les Galliens se préparèrent à partir. La rencontre allait s’effectuer dans quarante-sept minutes et trente-cinq secondes.
Par suite de la modification du mouvement de rotation de Gallia sur son axe, il faisait jour alors, – jour aussi sur ce côté du globe terrestre que la comète allait heurter.
Depuis une heure, le gonflement de la montgolfière était complet. Il avait parfaitement réussi. L’énorme appareil, se balançant entre les mâts, était prêt à partir. La nacelle, accrochée au filet, n’attendait que ses passagers.
Gallia n’était plus qu’à soixante-quinze mille lieues de la terre.
Isac Hakhabut, le premier, prit place dans la nacelle.
Mais, à ce moment, le capitaine Servadac remarqua qu’une ceinture, énormément gonflée, ceignait la taille du juif.
«Qu’est cela? demanda-t-il.
– Ça, monsieur le gouverneur, répondit Isac Hakhabut, c’est ma modeste fortune que j’emporte avec moi!
– Et que pèse-t-elle, votre modeste fortune?
– Oh! une trentaine de kilos seulement.
– Trente kilos, et notre montgolfière n’a que la force ascensionnelle suffisante pour nous enlever! Débarrassez-vous, maître Isac, de cet inutile fardeau.
– Mais, monsieur le gouverneur…
– Inutile, vous dis-je, puisque nous ne pouvons surcharger ainsi la nacelle!
– Dieu de l’univers! s’écria Isac, toute ma fortune, tout mon bien, si péniblement amassé!
– Eh! maître Isac, vous savez bien que votre or n’aura plus aucune valeur sur la terre, puisque Gallia vaut deux cent quarante-six sextillions!…
– Mais, monseigneur, par pitié!…
– Allons, Mathathias, dit alors Ben-Zouf, délivre-nous de ta présence ou de ton or, – à ton choix!»
Et le malheureux Isac dut se délester de son énorme ceinture, au milieu de lamentations et d’objurgations dont on n’essayera même pas de donner une idée.
Quant à Palmyrin Rosette, ce fut une bien autre affaire. Le savant rageur prétendait ne pas quitter le noyau de sa comète. C’était l’arracher de son domaine! D’ailleurs, cette montgolfière, c’était un appareil absurdement imaginé! Le passage d’une atmosphère à l’autre ne pourrait s’opérer sans que le ballon flambât comme une simple feuille de papier! Il y avait moins de danger à rester sur Gallia, et dans le cas où, par impossible, Gallia ne ferait qu’effleurer la terre, au moins Palmyrin Rosette continuerait à graviter avec elle! Enfin, mille raisons accompagnées d’imprécations furibondes ou grotesques, – telles que menaces d’accabler de pensums l’élève Servadac.
Quoi qu’il en soit, le professeur fut introduit le second dans la nacelle, mais garrotté et maintenu par deux robustes matelots. Le capitaine Servadac, bien déterminé à ne point le laisser sur Gallia, l’avait embarqué de cette façon un peu vive.
Il avait fallu abandonner les deux chevaux et la chèvre de Nina! Ce fut un crèvecœur pour le capitaine, Ben-Zouf et la petite fille, mais on ne pouvait les prendre. Seul de tous les animaux, le pigeon de Nina avait une place réservée. Qui sait, d’ailleurs, si ce pigeon ne servirait pas de messager entre les passagers de la nacelle et quelque point de la surface terrestre?
Le comte Timascheff et le lieutenant Procope s’embarquèrent sur une invitation du capitaine.
Celui-ci foulait encore le sol gallien avec son fidèle Ben-Zouf.
«Allons, Ben-Zouf, à ton tour, dit-il.
– Après vous, mon capitaine!
– Non. Je dois rester le dernier à bord, comme un commandant qui est forcé d’abandonner son navire!
– Cependant…
– Fais, te dis-je.
– Par obéissance, alors!» répondit Ben-Zouf.
Ben-Zouf enjamba le bord de la nacelle. Le capitaine Servadac y prit place après lui.
Les derniers liens furent alors coupés, et la montgolfière s’éleva majestueusement dans l’atmosphère.
![]()
Dans lequel on chiffre, minute par minute, les sensations et impressions des passagers de la nacelle
![]() a montgolfière atteignit une hauteur de deux mille cinq cents mètres. Le lieutenant Procope résolut de la maintenir dans cette zone. Un foyer en fil de fer, suspendu à l’appendice inférieur de l’appareil et chargé d’herbe sèche, pouvait être allumé facilement et conserver l’air intérieur au degré de raréfaction voulue pour que la montgolfière ne s’abaissât pas.
a montgolfière atteignit une hauteur de deux mille cinq cents mètres. Le lieutenant Procope résolut de la maintenir dans cette zone. Un foyer en fil de fer, suspendu à l’appendice inférieur de l’appareil et chargé d’herbe sèche, pouvait être allumé facilement et conserver l’air intérieur au degré de raréfaction voulue pour que la montgolfière ne s’abaissât pas.
Les passagers de la nacelle regardèrent sous eux, autour d’eux, au-dessus d’eux.
Au-dessous s’étendait une large partie de la mer Gallienne, qui semblait former un bassin concave. Dans le nord, un point isolé, c’était l’île Gourbi.
En vain eût-on cherché, dans l’ouest, les îlots de Gibraltar et de Ceuta. Ils avaient disparu.
Au sud se dressait le volcan, dominant le littoral et le vaste territoire de la Terre-Chaude. Cette presqu’île se raccordait au continent, qui encadrait la mer Gallienne. Partout cet étrange aspect, cette contexture lamelleuse, alors irisée sous les rayons solaires. Partout cette matière minérale du tellurure d’or, qui semblait uniquement constituer la charpente de la comète, le noyau dur de Gallia.
Autour de la nacelle, au-dessus de l’horizon, qui semblait s’être relevé avec le mouvement ascensionnel de la montgolfière, le ciel se développait avec une extrême pureté. Mais vers le nord-ouest, en opposition avec le soleil, gravitait un astre nouveau, moins qu’un astre, moins qu’un astéroïde, – ce que serait une sorte de bolide. C’était le fragment qu’une force intérieure avait rejeté des flancs de Gallia. Cet énorme bloc s’éloignait suivant une nouvelle trajectoire, et sa distance se mesurait alors par plusieurs milliers de lieues. Il était peu visible, d’ailleurs; mais, la nuit venue, il se fût montré comme un point lumineux dans l’espace.
Enfin, au-dessus de la nacelle, un peu obliquement, apparaissait le disque terrestre dans toute sa splendeur. Il semblait se précipiter sur Gallia et occultait une portion considérable du ciel.
Ce disque, splendidement éclairé, éblouissait le regard. La distance était déjà trop courte, relativement, pour qu’il fût possible d’en distinguer à la fois les deux pôles. Gallia s’en trouvait moitié plus rapprochée que n’en est la lune à sa distance moyenne, qui diminuait avec chaque minute dans une énorme proportion. Diverses taches brillaient à sa surface, les unes avec éclat, c’étaient les continents, les autres, plus sombres, par cela même qu’elles absorbaient les rayons solaires, c’étaient les océans. Au-dessus se déplaçaient lentement de grandes bandes blanches, que l’on sentait obscures sur leur face opposée: c’étaient les nuages répandus dans l’atmosphère terrestre.
Mais bientôt, avec une telle vitesse de vingt-neuf lieues à la seconde, l’aspect un peu vague du disque terrestre se dessina plus nettement. Les vastes cordons littoraux se détachèrent, les reliefs s’accentuèrent. Montagnes et plaines ne se laissèrent plus confondre. La carte plate s’accidenta, et il semblait aux observateurs de la nacelle qu’ils fussent penchés sur une carte en relief.
A deux heures vingt-sept minutes du matin, la comète n’était pas à trente mille lieues du sphéroïde terrestre. Les deux astres volaient l’un vers l’autre. A deux heures trente-sept, quinze mille lieues restaient encore à franchir.
Les grandes lignes du disque se distinguaient nettement alors, et trois cris échappèrent au lieutenant Procope, au comte Timascheff et au capitaine Servadac:
«L’Europe!
– La Russie!
– La France!»
Et ils ne se trompaient pas. La terre tournait vers Gallia cette face où s’étalait le continent européen, en plein midi. La configuration de chaque pays était aisément reconnaissable.
Les passagers de la nacelle regardaient avec une vive émotion cette terre prête à les absorber. Ils ne songeaient qu’à atterrir et non plus aux dangers de l’atterrissement. Ils allaient enfin rentrer dans cette humanité qu’ils avaient cru ne jamais revoir.
Oui, c’était bien l’Europe qui s’étalait visiblement sous leurs yeux! Ils voyaient ses divers États avec la configuration bizarre que la nature ou les conventions internationales leur ont donnée.
L’Angleterre, une lady qui marche vers l’est, dans sa robe aux plis tourmentés et sa tête coiffée d’îlots et d’îles.
La Suède et la Norvège, un lion magnifique, développant son échine de montagnes et se précipitant sur l’Europe du sein des contrées hyperboréennes.
La Russie, un énorme ours polaire, la tête tournée vers le continent asiatique, la patte gauche appuyée sur la Turquie, la patte droite sur le Caucase.
L’Autriche, un gros chat pelotonné sur lui-même et dormant d’un sommeil agité.
L’Espagne, déployée comme un pavillon au bout de l’Europe et dont le Portugal semble former le yacht.
La Turquie, un coq qui se rebiffe, se cramponnant d’une griffe au littoral asiatique, de l’autre étreignant la Grèce.
L’Italie, une botte élégante et fine qui semble jongler avec la Sicile, la Sardaigne et la Corse.
La Prusse, une hache formidable profondément enfoncée dans l’empire allemand et dont le tranchant effleure la France.
La France enfin, un torse vigoureux, avec Paris au cœur.
Oui, tout cela se voyait, se sentait. L’émotion était dans la poitrine de tous. Et cependant une note comique éclata au milieu de cette impression générale.
«Montmartre!» s’écria Ben-Zouf.
Et il n’aurait pas fallu soutenir à l’ordonnance du capitaine Servadac qu’il ne pouvait apercevoir de si loin sa butte favorite!
Quant à Palmyrin Rosette, la tête penchée hors de la nacelle, il n’avait de regards que pour cette abandonnée Gallia, qui flottait à deux mille cinq cents mètres au-dessous de lui. Il ne voulait même pas voir cette terre qui le rappelait à elle, et il n’observait que sa comète, vivement éclairée dans l’irradiation générale de l’espace.
Le lieutenant Procope, son chronomètre à la main, comptait les minutes et les secondes. Le foyer, de temps en temps ravivé par son ordre, maintenait la montgolfière dans la zone convenable.
Cependant, on parlait peu dans la nacelle. Le capitaine Servadac, le comte Timascheff observaient avidement la terre. La montgolfière, par rapport à elle, se trouvait un peu sur le côté, mais en arrière de Gallia, c’est-à-dire que la comète devait précéder dans sa chute l’appareil aérostatique, – circonstance favorable, puisque celui-ci, en se glissant dans l’atmosphère terrestre, n’aurait pas à effectuer un revirement bout pour bout.
Mais où tomberait-il?
Serait-ce sur un continent? Et, dans ce cas, ce continent offrirait-il quelques ressources? Les communications seraient-elles faciles avec une portion habitée du globe?
Serait-ce sur un océan? Et, dans ce cas, pouvait-on compter sur le miracle d’un navire, venant sauver les naufragés en mer?
Que de périls de toutes parts, et le comte Timascheff n’avait-il pas eu raison de dire que ses compagnons et lui étaient absolument dans la main de Dieu?
«Deux heures quarante-deux minutes», dit le lieutenant Procope au milieu du silence général.
Cinq minutes trente-cinq secondes six dixièmes encore, et les deux astres se heurteraient!… Ils étaient à moins de huit mille lieues l’un de l’autre.
Le lieutenant Procope observa alors que la comète suivait une direction un peu oblique à la terre. Les deux mobiles ne couraient pas sur la même ligne. Cependant, on devait croire qu’il y aurait arrêt subit et complet de la comète, et non pas un simple effleurement, comme cela s’était effectué deux ans auparavant. Si Gallia ne choquait pas normalement le globe terrestre, néanmoins, semblait-il, «elle s’y collerait vivement», dit Ben-Zouf.
Enfin, si aucun des passagers de la nacelle ne devait survivre à cette rencontre, si la montgolfière, prise dans les remous atmosphériques au moment où se fusionneraient les deux atmosphères, était déchirée et précipitée sur le sol, si aucun de ces Galliens ne devait revenir parmi ses semblables, tout souvenir d’eux-mêmes, de leur passage sur la comète, de leur pérégrination dans le monde solaire, allait-il donc être à jamais anéanti?
Non! le capitaine Servadac eut une idée. Il déchira une feuille de son carnet. Sur cette feuille, il inscrivit le nom de la comète, celui des parcelles enlevées au globe terrestre, les noms de ses compagnons, et le tout, il le signa du sien.
Puis il demanda à Nina le pigeon voyageur qu’elle tenait pressé sur sa poitrine.
Après l’avoir baisé tendrement, la petite fille donna son pigeon, sans hésiter.
Le capitaine Servadac prit l’oiseau, lui attacha au cou sa notice, et il le lança dans l’espace.
Le pigeon descendit en tournoyant dans l’atmosphère gallienne, et se tint dans une zone moins élevée que la montgolfière.
Encore deux minutes, et environ trois mille deux cents lieues! Les deux astres allaient s’aborder avec une vitesse trois fois plus grande que celle qui anime la terre le long de l’écliptique.
Inutile d’ajouter que les passagers de la nacelle ne sentaient rien de celte effroyable vitesse, et que leur appareil semblait rester absolument immobile au milieu de l’atmosphère qui l’entraînait.
«Deux heures quarante-six minutes», dit le lieutenant Procope.
La distance était réduite à dix-sept cents lieues. La terre semblait se creuser comme un vaste entonnoir au-dessous de la comète. On eût dit qu’elle s’ouvrait pour la recevoir!
«Deux heures quarante-sept minutes», dit encore une fois le lieutenant Procope.
Plus que trente-cinq secondes six dixièmes, et une vitesse de deux cent soixante-dix lieues par seconde!
Enfin, une sorte de frémissement se fit entendre. C’était l’air gallien que soutirait la terre, et avec lui la montgolfière, allongée à faire croire qu’elle allait se rompre!
Tous s’étaient cramponnés aux rebords de la nacelle, épouvantés, effarés…
Alors les deux atmosphères se confondirent. Un énorme amas de nuages se forma. Des vapeurs s’accumulèrent. Les passagers de la nacelle ne virent plus rien ni au-dessus ni au-dessous d’eux. Il leur sembla qu’une flamme immense les enveloppait, que le point d’appui manquait sous leurs pieds, et sans savoir comment, sans pouvoir l’expliquer, ils se retrouvèrent sur le sol terrestre. C’était dans un évanouissement qu’ils avaient quitté le globe, c’était dans un évanouissement qu’ils y revenaient!
Quant au ballon, plus de vestige!
En même temps, Gallia fuyait obliquement par la tangente, et, contre toute prévision, après avoir effleuré seulement le globe terrestre, elle disparaissait dans l’est du monde.
![]()
Qui, contrairement a toutes les règles du roman, ne se termine pas par le mariage du héros
![]() h! mon capitaine, l’Algérie!
h! mon capitaine, l’Algérie!
– Et Mostaganem, Ben-Zouf!»
Telles furent les deux exclamations qui s’échappèrent à la fois de la bouche du capitaine Servadac et de celle de son ordonnance, dès que leurs compagnons et eux eurent repris connaissance.
Par un miracle, impossible à expliquer comme tous les miracles, ils étaient sains et saufs.
«Mostaganem! l’Algérie!» avaient dit le capitaine Servadac et son ordonnance. Et ils ne pouvaient se tromper, ayant été pendant plusieurs années en garnison dans cette partie de la province.
Ils revenaient donc presque à l’endroit d’où ils étaient partis, après un voyage de deux ans à travers le monde solaire!
Un hasard étonnant – est-ce bien un hasard, puisque Gallia et la terre se rencontraient à la même seconde sur le même point de l’écliptique? – les ramenait presque à leur point de départ.
Ils n’étaient pas à deux kilomètres de Mostaganem!
Une demi-heure plus tard, le capitaine Servadac et tous ses compagnons faisaient leur entrée dans la ville.
Ce qui dut leur paraître surprenant, c’est que tout paraissait être calme à la surface de la terre. La population algérienne vaquait tranquillement à ses occupations ordinaires. Les animaux, nullement troublés, paissaient l’herbe un peu humide de la rosée de janvier. Il devait être environ huit heures du matin. Le soleil se levait sur son horizon accoutumé. Non seulement il ne semblait pas que rien d’anormal se fût accompli sur le globe terrestre, mais aussi que rien d’anormal n’eût été attendu par ses habitants.
«Ah ça! dit le capitaine Servadac, ils n’étaient donc pas prévenus de l’arrivée de la comète?
– Faut le penser, mon capitaine, répondit Ben-Zouf. Et moi qui comptais sur une entrée triomphale!»
Bien évidemment, le choc d’une comète n’était pas attendu. Autrement, la panique eût été extraordinaire en toutes les parties du globe, et ses habitants se seraient crus plus près de la fin du monde qu’en l’an 1000!
A la porte de Mascara, le capitaine Servadac rencontra précisément ses deux camarades, le commandant du 2e tirailleurs et le capitaine du 8e d’artillerie. Il tomba littéralement dans leurs bras.
«Vous, Servadac! s’écria le commandant.
– Moi-même!
– Et d’où venez-vous, mon pauvre ami, après cette inexplicable absence?
– Je vous le dirais bien, mon commandant, mais si je vous le disais, vous ne me croiriez pas!
– Cependant…
– Bah! mes amis! Serrez la main à un camarade qui ne vous a point oubliés, et mettons que je n’ai fait qu’un rêve!»
Et Hector Servadac, quoi qu’on fît, ne voulut pas en dire davantage.
Toutefois, une question fut encore adressée par lui aux deux officiers:
«Et Mme de…?»
Le commandant de tirailleurs, qui comprit, ne le laissa pas achever.
«Mariée, remariée, mon cher! dit-il. Que voulez-vous? Les absents ont toujours tort…
– Oui! répondit le capitaine Servadac, tort d’aller courir pendant deux ans dans le pays des chimères!»
Puis, se retournant vers le comte Timascheff:
«Mordioux! monsieur le comte, dit-il, vous avez entendu! En vérité, je suis enchanté de ne point avoir à me battre avec vous.
– Et moi, capitaine, je suis heureux de pouvoir, sans arrière-pensée, vous serrer cordialement la main!
– Ce qui me va aussi, murmura Hector Servadac, c’est de ne pas avoir à finir mon horrible rondeau!»
Et les deux rivaux, qui n’avaient plus aucune raison d’être en rivalité, scellèrent, en se donnant la main, une amitié que rien ne devait jamais rompre.
Le comte Timascheff, d’accord avec son compagnon, fut aussi réservé que lui sur les événements extraordinaires dont ils avaient été témoins, et dont les plus inexplicables étaient leur départ et leur arrivée. Ce qui leur paraissait absolument inexplicable, c’est que tout était à sa place sur le littoral méditerranéen.
Décidément, mieux valait se taire.
Le lendemain, la petite colonie se séparait. Les Russes retournèrent en Russie avec le comte Timascheff et le lieutenant Procope, les Espagnols en Espagne, où la générosité du comte devait les mettre pour jamais à l’abri du besoin. Tous ces braves gens ne se quittèrent pas sans s’être prodigué les marques de la plus sincère amitié.
En ce qui concerne Isac Hakhabut, ruiné par la perte de la Hansa, ruiné par l’abandon qu’il avait dû faire de son or et de son argent, il disparut. La vérité oblige à avouer que personne ne le réclama.
«Le vieux coquin, dit un jour Ben-Zouf, il doit s’exhiber en Amérique comme un revenant du monde solaire!»
Il reste à parler de Palmyrin Rosette.
Celui-là, aucune considération, on le croira sans peine, n’avait pu le faire taire! Donc, il avait parlé!… On lui nia sa comète, qu’aucun astronome n’avait jamais aperçue sur l’horizon terrestre. Elle ne fut point inscrite au catalogue de l’Annuaire. A quel point atteignit alors la rage de l’irascible professeur, c’est à peine si l’on peut l’imaginer. Deux ans après son retour, il fit paraître un volumineux mémoire qui contenait, avec les éléments de Gallia, le récit des propres aventures de Palmyrin Rosette.
Alors, les avis se partagèrent dans l’Europe savante. Les uns, en grand nombre, furent contre. Les autres, en petit nombre, furent pour.
Une réponse à ce mémoire – et c’était probablement la meilleure que l’on pût faire – réduisit tout le travail de Palmyrin Rosette à de justes mesures, en l’intitulant: Histoire d’une hypothèse.
Cette impertinence porta à son comble la colère du professeur, qui prétendit alors avoir revu, gravitant dans l’espace, non seulement Gallia, mais le fragment de la comète qui emportait treize Anglais dans les infinis de l’univers sidéral! Jamais il ne devait se consoler de ne pas être leur compagnon de voyage!
Enfin, qu’ils eussent ou non réellement accompli cette exploration invraisemblable du monde solaire, Hector Servadac et Ben-Zouf restèrent plus que jamais, l’un le capitaine, l’autre l’ordonnance, que rien ne pouvait séparer.
Un jour, ils se promenaient sur la butte Montmartre, et, bien certains de ne point être entendus, ils causaient de leurs aventures.
«Ce n’est peut-être pas vrai, tout de même! disait Ben-Zouf.
– Mordioux! je finirai par le croire!» répondit le capitaine Servadac.
Quant à Pablo et à Nina, adoptés, l’un par le comte Timascheff, l’autre par le capitaine Servadac, ils furent élevés et instruits sous leur direction.
Un beau jour, le colonel Servadac, dont les cheveux commençaient à grisonner, maria le jeune Espagnol, devenu un beau garçon, avec la petite Italienne, devenue une belle jeune fille. Le comte Timascheff avait voulu apporter lui-même la dot de Nina.
Et cela fait, les deux jeunes époux n’en furent pas moins heureux, pour n’avoir point été l’Adam et l’Ève d’un nouveau monde.
FIN DE LA DEUXIÈME ET DERNIÈRE PARTIE